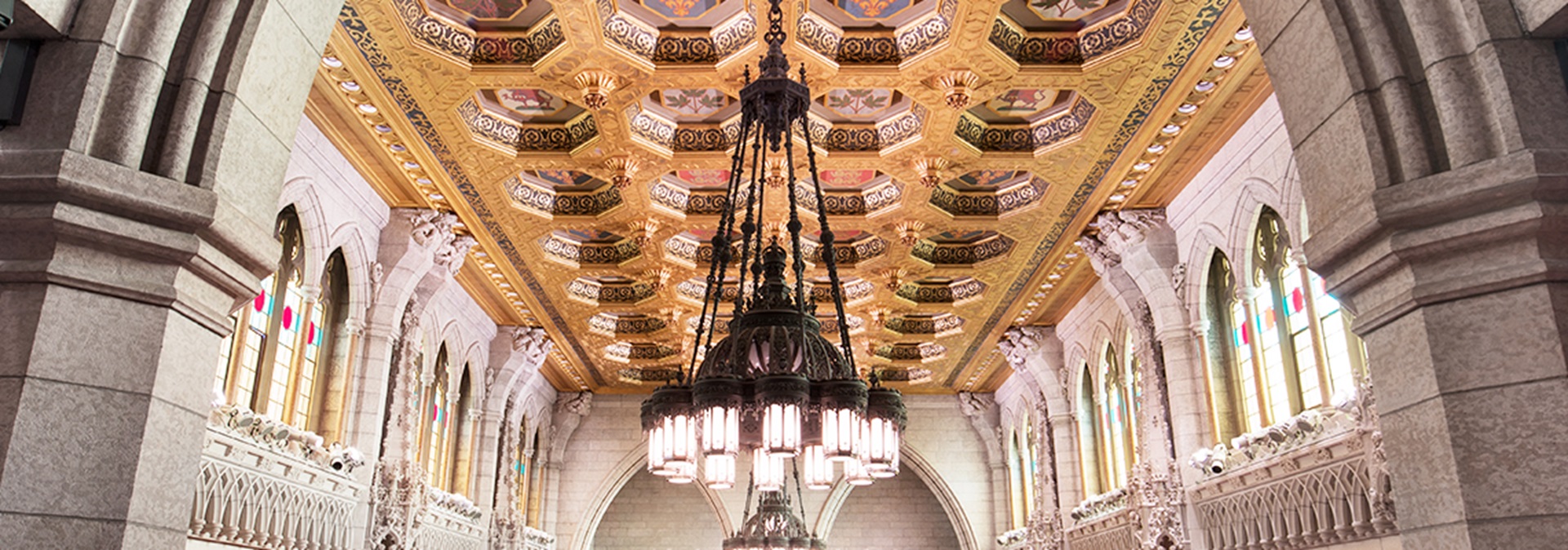Délibérations du Sous-comité des Anciens combattants
Fascicule 9 - Témoignages du 15 décembre 2010
OTTAWA, le mercredi 15 décembre 2010
Le Sous-comité des anciens combattants du Comité sénatorial permanent de la sécurité nationale et de la défense se réunit aujourd'hui, à 12 h 2, pour étudier les services et les prestations dispensés aux membres des Forces canadiennes; aux anciens combattants; aux membres et anciens membres de la Gendarmerie royale du Canada et à leurs familles.
Le sénateur Roméo Antonius Dallaire (président) occupe le fauteuil.
[Traduction]
Le président : Le Sous-comité des anciens combattants étudie la nouvelle Charte des anciens combattants et les progrès réalisés relativement à son application, en particulier, à la nouvelle génération d'anciens combattants.
Aujourd'hui, nous accueillons Mme Deborah Norris, qui est professeure agrégée et présidente du département des études de la famille et gérontologie de l'Université Mount Saint Vincent. Elle est titulaire d'un doctorat en éducation, elle a fait des études de premier cycle en sciences familiales, et elle a obtenu une maîtrise dans ce domaine. Elle participe à des recherches dans les domaines de la famille et des relations familiales, de l'éducation familiale, du soutien familial et de la violence familiale.
Mme Norris a participé à une étude sur la violence familiale au sein des Forces canadiennes, dont je me souviens bien. J'étais un des destinataires de l'étude. Elle a aussi participé à des études sur les relations de soutien familial dans l'armée, l'expérience des partenaires de femmes militaires et les parents âgés qui s'occupent d'un fils ou d'une fille ayant une déficience permanente.
Elle s'occupe de recherche appliquée, ce qui est très pertinent. Elle collabore régulièrement avec des intervenants clés de la collectivité. Ses travaux ont éclairé l'élaboration de programmes et de politiques de soutien social pour la famille.
Dans le cadre de cette étude de la nouvelle Charte des anciens combattants, nous sommes impatients de savoir quelle sera l'incidence de la charte sur les familles et les blessés. Nous voulons aussi savoir comment nous gérons cette interdépendance, particulièrement au sein d'Anciens Combattants Canada et aussi au ministère de la Défense nationale.
Madame Norris, avez-vous une déclaration préliminaire?
Deborah Norris, professeure agrégée, Études de la famille et gérontologie, Université Mount Saint Vincent, à titre personnel : Oui.
Merci, sénateur Dallaire, de cette merveilleuse présentation; et merci à tous de me donner l'occasion de vous parler aujourd'hui.
Comme le sénateur l'a indiqué, je joue de longue date un rôle actif au sein de la collectivité militaire et j'ai pensé qu'il serait important de commencer par vous faire part de mes hypothèses de départ concernant mes liens avec la recherche et mon expérience au sein de la collectivité des militaires et des anciens combattants.
Il y a trois hypothèses de base. Premièrement, il y a la réciprocité qui existe entre, d'une part, les militaires, les anciens combattants et leur famille et, d'autre part, l'institution militaire. Les deux sont indissociables.
Deuxièmement, dans le cadre de notre recherche avec les familles militaires, la définition de « famille » que nous utilisons est large et comprend à la fois le « noyau familial », soit le militaire, l'ancien combattant et les membres de la famille immédiate — les conjoints et toutes les personnes à charge, en particulier — et la « famille immédiate », où sont inclus les enfants, les personnes à charge, les frères et sœurs et les parents du militaire ou de l'ancien combattant.
J'ai pensé qu'il pourrait être pertinent de noter que c'est cette définition que nous utilisons dans le cadre de notre programme de recherches, malgré le fait que la définition de ce qu'est une « famille » demeure controversée et sujette à débat.
La troisième hypothèse — et c'est probablement celle qui se rapporte le plus à la discussion d'aujourd'hui —, c'est que le militaire et sa famille ont une grande capacité de résilience. Nous adoptons aussi le point de vue que la résilience n'est pas nécessairement un résultat, mais un processus. Il s'agit d'une façon d'être qui demande un effort quotidien et un engagement de tous les jours afin d'affronter les pressions de la vie et tirer parti des occasions qui se présentent.
Pour ce qui est de la charte, le fait que la résilience — mais aussi la résilience en tant que processus — était au centre des préoccupations pour beaucoup d'aspects de la charte m'a réconfortée. Je vois aussi un lien avec les déterminants sociaux de la santé et le modèle écologique, qui semblent être les cadres de travail d'ordre pratique utilisés pour la création de la charte.
Il convient de souligner qu'à l'Université Mount Saint Vincent, notre façon d'aborder le travail avec la collectivité militaire est aussi fondée sur ces deux cadres de travail : les déterminants sociaux de la santé et l'approche écologique.
Pour ce qui est de la résilience, la développer et la conserver peut, bien entendu, être difficile pour les militaires, les anciens combattants et leur famille. Dans le cadre de mes recherches, au fil des ans, j'ai d'abord mis l'accent sur le cycle de déploiement, particulièrement en fonction de l'expérience qu'en ont les partenaires de femmes militaires. Avec le temps, j'ai modifié mon point de vue, qui est passé de celui de la gestion du déploiement par la partenaire qui restait à la maison aux ajustements psychologiques nécessaires à l'établissement d'un équilibre entre la maternité et les attentes des militaires envers les partenaires de femmes militaires. Nous avons présenté un rapport sur cette étude il y a environ un mois, à Kingston, au Forum de recherche sur la santé des militaires et des anciens combattants. Je sais que certains sénateurs y étaient aussi.
Il est important de souligner qu'il y a peu d'études au Canada sur les répercussions du service militaire sur les membres de la famille des militaires. La plupart des recherches à ce sujet ont été menées aux États-Unis, en Australie, au Royaume- Uni et en Israël.
Dans le contexte canadien, cela comporte d'importantes répercussions pour les anciens combattants et leur famille. Ces dernières années, nous avons consacré beaucoup de temps à étudier les conséquences — sur les finances, la santé et la vie sociale — subies par ceux qui ont reçu un diagnostic d'invalidité liée au service, et plus particulièrement le trouble de stress post-traumatique, ou TSPT.
À l'Université Mount Saint Vincent, nous avons axé nos recherches sur les soins fournis tout au long de leur vie aux enfants et aux membres vieillissants de la famille tout en ayant à s'occuper et à appuyer un adulte ou un membre vulnérable de la famille. Ces tâches sont rendues plus complexes par les conséquences du service militaire qui, comme nous le savons maintenant, pourraient aussi inclure un diagnostic de TSPT.
Pour le militaire et l'ancien combattant, les conséquences du TSPT peuvent être graves. Une étude sur les répercussions d'un diagnostic d'invalidité due au service auprès des vétérans de la guerre du Vietnam a révélé des problèmes durables liés à la famille et au couple. Ces résultats ont été corroborés par d'autres études, et dans certains que j'ai fournis comme contexte pour mon exposé, j'ai cité certaines de ces études. Il faut souligner que jusqu'à maintenant, peu de ces documents sont canadiens.
Les études ont révélé des problèmes sur le plan de la communication, de la capacité de s'exprimer, de la création ou du rétablissement de liens intimes au sein de la relation primaire pendant que l'ancien combattant cherche à accepter le diagnostic et les répercussions du diagnostic de TSPT. D'autres chercheurs, particulièrement dans une des plus importantes études sur les problèmes de santé mentale des anciens combattants de la guerre du Vietnam, ont constaté que le taux de divorce est deux fois plus élevé chez les anciens combattants atteints du TSPT. Encore une fois, j'indiquerais que ce ne sont pas des données canadiennes; à ma connaissance, nous ne savons pas encore ce qu'il en est au Canada.
Je tiens à ce qu'il soit clairement établi que les recherches que nous faisons à Halifax à ce sujet ne font que débuter. Jusqu'à présent, cependant, nous constatons qu'il y a une réaction en chaîne dans la famille de ceux qui sont atteints du TSPT. Dans les couples où l'homme a subi une blessure de stress opérationnel — le TSPT en particulier —, on rapporte davantage de conflits et un manque d'intimité, de consensus, de cohésion et de communication par rapport aux autres couples. Les partenaires des anciens combattants souffrant du TSPT ont aussi un taux plus élevé de troubles émotionnels, s'adaptent moins bien à la vie conjugale, et ont davantage de problèmes de santé mentale; cela peut être observé non seulement chez l'ancien combattant qui a un problème de santé, mais aussi chez la partenaire. Nous l'avons consigné.
Lundi, soit dit en passant, j'ai assisté à une réunion à Halifax avec quelques collègues de l'Université Dalhousie qui étudient l'invalidité, au sens large. Ils font aussi état de résultats préoccupants. Non seulement on relève des problèmes de santé mentale liés à la prestation de soins à un membre de la famille ayant une déficience, mais il semble aussi y avoir des conséquences qui se présentent sous forme de manifestations physiques réelles. Le lien entre le corps et l'esprit semble faire partie de l'équation, au point où nous sommes en mesure de le consigner.
Les conséquences s'étendent aux enfants. Les enfants des anciens combattants atteints du TSPT sont plus susceptibles d'avoir des problèmes de comportement. C'est ce que révèle la recherche faite aux États-Unis. Certains de ces problèmes comprennent à la fois ce que les psychologues appellent des problèmes comportementaux d'intériorisation — retrait, dépression, modification du rendement scolaire et du comportement à l'école — et des problèmes comportementaux d'extériorisation comme un passage à l'acte et un changement soudain de comportement.
Les travaux israéliens que j'ai cités plus tôt montrent que les membres de l'unité familiale, y compris les enfants et de leurs partenaires ainsi que d'autres membres de la famille, risquent d'être accablés par ce qu'on appelle le fardeau des aidants naturels associé à la maladie et à la lutte pour le maintien de leur indépendance et de leur autonomie. Pour revenir encore une fois à la recherche israélienne, les conjointes des anciens combattants atteints du TSPT ont déclaré que leur vie était centrée sur leur mari. La phrase que les chercheurs ont utilisée était « la maladie comme mode de vie ». La maladie est devenue l'élément central de l'organisation de la vie familiale, modelant à la fois les aspects physique et affectif de la vie des femmes concernées.
Les femmes qui ont participé à l'étude israélienne ont également signalé des tensions entre la fusion et la perte de leur identité dans la maladie de leur mari et de la lutte pour conserver une certaine indépendance. Dans l'étude, on parle de « la tension entre la fusion et de l'individualisation ». On observe une tendance à l'implication totale dans la maladie, de sorte qu'il en résulte une perte de soi. Les femmes de cette étude ont parlé du travail acharné qu'elles ont dû faire pour conserver leur identité dans ces circonstances.
Le travail — toujours à une étape préliminaire — qu'un de mes étudiants diplômés et moi avons fait et sur lequel nous avons fait rapport le mois dernier au forum reprend une partie des résultats de cette recherche. Dans le cadre de notre petite étude qualitative sur des femmes d'Halifax mariées à d'anciens combattants, que nous avons publiée ces deux dernières années, ces femmes ont indiqué qu'elles avaient commencé à imiter certains des symptômes du TSPT; un de ceux qui leur venaient à l'esprit est une réaction de sursaut exagérée.
Les femmes avec lesquelles nous avons travaillé ont fait remarquer qu'elles ont travaillé très fort pour redéfinir leur relation. Elles doivent s'habituer à devoir constamment être extrêmement vigilantes, toujours sur le qui-vive, et à être conscientes des signes qui indiquent que leur partenaire est en détresse ou que quelque chose ne va pas.
Une conclusion très intéressante que nous aimerions approfondir est la notion de perte ambiguë. Les femmes d'Halifax avec lesquelles nous avons travaillé ont indiqué qu'à l'origine, elles étaient mariées ou avaient une relation avec une personne totalement différente; à la suite du diagnostic, qui est manifestement attribuable au service, elles étaient confrontées à la perte de la personne de qui elles étaient tombées amoureuses, avec laquelle elles s'étaient mariées et s'étaient fait une vie. À l'instar des chercheurs israéliens, nous appelons cela une perte ambiguë.
Une des femmes dans notre étude a parlé de ce phénomène comme une absence présente. La personne que le conjoint était n'est plus là. Même si la personne est toujours là physiquement et que les femmes peuvent les voir, la personne qui existait avant n'est plus là pour elles, tant sur le plan émotif que psychologique.
Les psychologues appellent cela le trouble de stress post-traumatique secondaire. Le Dr Charles Figley, un psychologue américain, a inventé ce terme. En fait, le TSPTS — le trouble de stress post-traumatique secondaire — est maintenant reconnu comme un problème de santé pour les partenaires et les membres de la famille des militaires et des anciens combattants atteints du TSPT.
En conclusion, avant de commencer la discussion avec vous, on sait peu de choses sur la façon dont les membres de la famille des militaires et des anciens combattants atteints de TSPT vivent le traumatisme secondaire, et on ne connaît pas ce qui le déclenche. Les recherches que j'ai citées nous donnent des pistes, mais, là encore, très peu de données sont canadiennes et beaucoup de questions demeurent sans réponse. Je pense que certaines de ces questions ont une incidence sur la charte, ce qui nous ramène au point de départ.
Malgré tout, l'étude israélienne et le travail préliminaire effectué à Halifax indiquent que certaines femmes sont valorisées par leur rôle de soignantes principales. Ces femmes ont dit qu'elles faisaient ce qui était attendu d'elles et qu'elles trouvaient des forces, des capacités et des occasions nouvelles pour développer et maintenir la résilience. Même si c'était difficile dans les circonstances, elles se découvraient des qualités, qui les avantageaient et dont profitaient les autres.
Au fond, comme l'a mentionné une femme dans notre étude, il est stimulant d'être la personne forte; dans certains cas, les femmes ont puisé des forces dans l'énergie mise par leur partenaire au quotidien pour assurer leur bien-être et maintenir une bonne santé.
Il faut tirer des choses au clair. J'ai constaté dans le rapport du comité consultatif, chargé de s'occuper de la nouvelle Charte des anciens combattants, qu'on recommandait d'axer les services sur les besoins. Il faut se poser de plus amples questions et effectuer davantage de recherche pour favoriser l'atteinte de l'objectif, qui est bien sûr essentiel à la charte.
Je pense qu'il faut régler d'autres questions pour encourager la mise en œuvre de la charte. Il faut connaître l'influence à long terme du service militaire sur les soldats, les anciens combattants et les familles. En particulier, il importe d'en savoir plus sur les conséquences négatives et les conséquences positives. Les conséquences apparaissent- elles et augmentent-elles avec le temps et, dans l'affirmative, de quelle façon? Nous devons apprendre comment les qualités personnelles, les relations interpersonnelles, les ressources, les politiques et les droits modifient le cours de la vie et les enjeux liés au combat pour les militaires, les anciens combattants et les familles.
Dans les recherches menées à Halifax, nous voulons comprendre de quelle façon les militaires, les anciens combattants et les familles parviennent à la résilience au cours de leur vie. Quelles forces s'éveillent et quels problèmes se présentent au fil du temps? Que faut-il à ces gens pour acquérir et conserver la résilience?
Bien sûr, il importe avant tout de se demander s'il vaut la peine de concevoir des politiques et des programmes fondés sur un modèle de résilience pour que les familles puissent chercher et reconnaître leurs aptitudes et leurs forces et en profiter. Évidemment, je pense que, grosso modo, il s'agit d'un objectif digne d'intérêt, qu'on peut poursuivre grâce au travail des chercheurs, des spécialistes, et cetera.
Je suis heureuse que, dans le rapport sur la nouvelle Charte des anciens combattants, le comité consultatif ait recommandé de prendre en compte les déterminants de la santé et un modèle écologique pour élaborer des programmes et des politiques, effectuer de la recherche et apporter des améliorations dans tous ces domaines.
Je vous remercie de votre attention et je vous invite à faire des commentaires ou à poser des questions.
Le président : Merci beaucoup. Étant donné que nous avons commencé un peu en retard, je signale à mes collègues que nous devons mettre fin à la présente partie de la séance au plus tard à 12 h 45. Je vais maintenant vous faire part de trois remarques formulées par mes collègues.
Vous avez souvent dit que les blessures de stress opérationnel étaient des maladies. J'imagine que c'est un terme technique. Cependant, il rend mal à l'aise les soldats, les marins ou les aviateurs. J'estime que je vis avec une blessure, pas une maladie. Je suppose qu'il y a une certaine différence.
La nouvelle Charte des anciens combattants est vague concernant l'aide accordée à la famille. J'aimerais connaître votre définition de la famille et le soutien qu'elle doit recevoir selon vous.
Concernant la recherche, je dirai brièvement que la charte comporte un autre défaut caché, mais qu'elle propose tout de même d'utiliser des instruments complexes, que nous ne connaissons pas nécessairement.
Je cède la parole au vice-président, le sénateur Manning.
Le sénateur Manning : Merci de votre exposé d'aujourd'hui. Concernant le temps dont nous disposons, vous avez donné beaucoup d'informations dans l'exposé. Il serait agréable de discuter bien plus longtemps.
Je veux revenir sur la dernière remarque de la présidence. Vous avez parlé d'études, notamment celle menée en Israël, et vous avez dit qu'on n'effectuait pas assez de recherche sur les familles de militaires au Canada. Savez-vous s'il y a des recherches effectuées au pays dont nous pouvons examiner le rapport? Pour que nous sachions ce qui se fait et surtout ce qui ne se fait pas, pouvez-vous nous dire si des travaux ont été effectués, auxquels vous avez participé ou non, qui pourraient nous éclairer?
Mme Norris : Si vous pensez aux recherches canadiennes, mes consœurs Janet Fast et Norah Keating de l'Université de l'Alberta ont mené une recherche pour laquelle on a appelé plus de 200 membres de la famille d'anciens combattants grièvement blessés, pour prendre l'expression du sénateur Dallaire. Le rapport est intitulé Wounded Veterans, Wounded Families. Vous l'avez peut-être consulté. À juste titre, le ministère des Anciens Combattants s'est beaucoup intéressé au rapport, car c'est une recherche crédible, que je recommande fortement d'examiner.
Au fil des ans, Mme Deborah Harrison a fait des recherches sur les familles de militaires. Notamment, elle a étudié le cycle de déploiement et la violence familiale. Si je ne m'abuse, des recommandations ont été faites à la Direction de la qualité de la vie, qu'on appelle peut-être encore la DQV.
Le président : On recommence à employer le sigle.
Mme Norris : Je sais que les chercheurs et les responsables de l'élaboration des politiques à la DQV ont collaboré pour appliquer les recommandations. Le travail de Mme Harrison est tout à fait digne de mention. Les recherches de cette ancienne professeure de l'Université du Nouveau-Brunswick, maintenant à la retraite, qui portent essentiellement sur les militaires canadiens, et non sur les anciens combattants, sont toujours pertinentes. Par exemple, elles aident Mmes Keating et Fast, en Alberta.
Le président : Parlez-vous des domaines à défricher qu'a évoqués le sénateur?
Mme Norris : Je parle des domaines dont nous savons peu de choses. Nous n'en savons pas beaucoup sur l'incidence du service militaire pour les anciens combattants, les soldats et les familles. Dans la mesure où il est question de traumatisme secondaire, nous ne savons pas ce que vivent ou ce qu'en pensent les familles ou ceux qui offrent du soutien. Sur le plan pratique, les modèles de soins ne nous sont pas familiers.
Ce que je voulais voir dans la charte et dont j'ai parlé au sénateur Pépin avant la séance, c'est dans quelle mesure le réseau bien établi de ressources accessibles aux familles de militaires peut offrir du soutien, au moins pour passer du service actif à la retraite à titre d'ancien combattant.
Je répète qu'en tant que chercheur, décideur et chargé de l'élaboration des programmes, nous devons discuter des modèles de soins et des stratégies qu'il faut employer pour tirer profit des infrastructures existantes. Nous pourrions améliorer ce qui est déjà là, mais il importe de commencer par voir ce qui fonctionne.
Le sénateur Manning : Je m'intéresse à ce que vous avez dit sur qui doit offrir des soins et le maintien de l'indépendance. Je suis presque certain que tous les soldats qui ont témoigné ces derniers mois se préoccupaient d'abord de leur famille, au lieu d'eux-mêmes. Par exemple, les militaires qui reviennent d'Afghanistan grièvement blessés veulent surtout le bien de leur conjoint ou de leur conjointe, de leurs enfants et de tous leurs proches.
Je n'ai pas de formation, mais dans bien cas, je considérais que les blessures n'étaient pas visibles, que la souffrance allait au-delà des blessures physiques.
Ai-je bien compris qu'il s'agit de la principale préoccupation à laquelle vous êtes confrontée dans le cadre de votre travail? Si oui, savez-vous si on a mené des recherches sur cette question?
Mme Norris : Parlez-vous de la stigmatisation des personnes souffrant d'une blessure qui n'est pas apparente? La communauté de la santé mentale en général essaie de remédier à la situation.
Je ne suis pas une psychologue; je suis plutôt une sociologue. Par conséquent, je ne suis pas ferrée sur les stratégies visant à lutter contre la stigmatisation. Je dis cela dans le plus grand respect, parce qu'à part le fait d'être chercheuse dans le domaine depuis 20 ans, il n'y a rien qui me rattache à l'armée. Tout le monde me demande pourquoi j'effectue ces recherches. C'est un milieu qui m'intéresse énormément. Quoi qu'il en soit, lorsque je rencontre des familles et du personnel, il est encore souvent question de la réticence des militaires, hommes ou femmes, à parler d'une blessure invisible, telle que le TSPT, qu'elle soit diagnostiquée ou potentielle.
D'autant que je sache, tous les problèmes que nous observons dans notre culture en général en ce qui a trait à la stigmatisation sont encore plus graves dans l'armée, et je le dis dans le plus grand respect de ceux ici qui sont militaires ou qui l'ont été, à cause de la philosophie selon laquelle les gens qui revêtent l'uniforme doivent être prêts au combat, forts et solides.
Le sénateur Pépin : Je vous souhaite la bienvenue et je vous remercie d'être venue aujourd'hui. Je sais qu'il y a un réseau de spécialistes, de psychologues et de psychiatres partout au pays qui se penchent sur la situation des anciens combattants. Pouvez-vous nous dire qui sont ces experts et si le réseau est bien établi partout au pays?
Mme Norris : À ma connaissance, le réseau et le système de soutien sont très prometteurs. D'après des renseignements recueillis ici et là auprès des familles, principalement auprès des conjointes ou anciennes conjointes de militaires, le modèle d'entraide par les pairs semble être ce qui fonctionne le mieux, particulièrement celui mis en œuvre par le groupe de SSBSO, ce qui est fascinant à certains égards parce qu'il sert d'intermédiaire entre le MDN et ACC.
Le sénateur Pépin : On dit qu'il y a une ligne 1-800 qui permet aux anciens combattants et à leurs familles de parler à quelqu'un tous les jours 24 heures sur 24.
Mme Norris : Absolument, et c'est par l'entremise du programme de SSBSO et des séances individuelles d'entraide par les pairs.
Le sénateur Pépin : En 2007, on a annoncé l'ouverture de cliniques, et seulement cinq à 10 cliniques ont vu le jour. En 2009, on en comptait dix partout au pays. Savez-vous combien il y en a en 2010?
Mme Norris : Je l'ignore. Parlez-vous uniquement des cliniques qui se concentrent sur le TSPT?
Le sénateur Pépin : Oui, les cliniques où peuvent se rendre les militaires et leurs familles lorsque c'est très important et urgent.
Mme Norris : Je n'ai pas cette information.
Le sénateur Pépin : On a tenu une réunion avec l'ombudsman des anciens combattants, et une personne a indiqué que la nouvelle Charte des anciens combattants ne favorisait pas les célibataires ou certaines catégories de veuves.
Qu'en pensez-vous? Êtes-vous d'accord? Si c'est vrai, que peut-on faire pour que ce soit mieux organisé et plus accessible?
Mme Norris : C'est intéressant, parce qu'il y a souvent un écart entre l'esprit de la politique, telle que la charte, et la façon dont elle est mise en œuvre. Quand on lit la charte, quand on lit le rapport du groupe consultatif, on semble donner un sens très large à la famille. Comme je l'ai dit au début de ma déclaration aujourd'hui, la définition de « famille » doit être plus englobante. Il faut toutefois faire attention de ne pas trop élargir la définition afin que les gens qui ont réellement besoin d'aide ne soient pas laissés pour compte.
Le sénateur Wallin : Le sénateur Dallaire et moi avons été enchantés de voir ce qui se passe à Kingston et d'apprendre qu'il y a une réelle possibilité que les universités collaborent dans le cadre de cette étude, étant donné qu'il y a visiblement un manque du côté des études proprement canadiennes.
J'aimerais poser une question, et je fais toujours preuve de prudence lorsque j'aborde l'envers de la médaille. Puisque nous approfondissons cette question, je suis préoccupée par la « médicalisation » ou la « psychologisation », ou peu importe comment vous appelez ça, des services qu'on offre aux familles. Nous pouvons tous nommer 14 autres professions stressantes, qui brisent des mariages et qui font souffrir des enfants. Des journalistes parcourent le monde et doivent quitter leurs familles à une minute d'avis.
Même si je veux m'assurer qu'on ne laisse personne pour compte, je ne veux pas non plus qu'on accole une étiquette aux gens qui ont servi leur pays, qui ont été déployés en Afghanistan ou qui ont connu la guerre. Je ne veux pas qu'on pense tout de suite à ce qui ne va pas chez ces gens.
Je sais que vous devez ratisser large lorsque vous effectuez vos recherches. Comment parvenons-nous à atteindre cet équilibre?
Mme Norris : J'ai tenté d'examiner cette question sous plusieurs angles — dans certains cas, cela pourrait être justifié, mais au risque de paraître trop optimiste —, je me suis plutôt interrogée sur les forces et les capacités des personnes avec qui je travaille.
Je peux dire, sans exagérer, que les conjointes des militaires font partie des personnes les plus fortes que j'ai rencontrées dans ma vie. Ce sont des femmes incroyablement fortes et autonomes, qui s'occupent de leurs enfants, pellettent la neige et déménagent au milieu du déploiement de six mois. Ces femmes peuvent vivre à Halifax, et ce sont peut-être des francophones qui vivent loin de leur famille d'origine. La force de ces femmes m'a beaucoup inspirée.
N'empêche qu'il ne faut pas minimiser les problèmes pour autant. J'ai eu la chance de travailler avec des femmes de la communauté militaire qui se sont battues et qui continuent de le faire.
Cependant, il y a un intérêt, pas seulement selon mon expérience, mais de façon plus générale, et je pense que je l'ai observé à la conférence, au forum de Kingston, à l'égard d'un cadre de résilience, un modèle axé sur les capacités et les forces.
Le sénateur Wallin : Effectivement. J'ai reçu une formation en psychologie, et j'aimerais que cet aspect soit également reflété dans la recherche. Je considère qu'il s'agit d'une force très importante.
Le sénateur Plett : Si vous me le permettez, j'aimerais faire quelques observations avant de poser une question, et je tâcherai d'être bref, monsieur le président. J'aimerais revenir sur le mot d'ouverture du président au sujet de la nouvelle Charte des anciens combattants. J'aimerais brièvement parler des mesures qu'a prises le gouvernement.
Nous avons rétabli les prestations et les services aux anciens combattants alliés qui avaient été interrompus en 1995 et nous avons élargi leur portée pour inclure les anciens combattants de la guerre de Corée et leurs familles. Nous avons mis en œuvre la nouvelle Charte des anciens combattants avec succès, ce qui constitue le changement le plus important dans le traitement de nos anciens combattants depuis 60 ans.
En plus d'accorder un plein soutien financier aux anciens combattants d'aujourd'hui, la charte innove en veillant au bien-être de nos anciens combattants et de leurs familles. En date du 31 décembre 2009, près de 20 000 anciens combattants avaient touché des prestations dans le cadre de la nouvelle Charte des anciens combattants. À cet égard, notre gouvernement a versé des prestations de décès forfaitaires de l'ordre de 250 000 $ aux survivants des quatre soldats canadiens décédés entre le 13 mai 2005, date de l'adoption de la nouvelle Charte des anciens combattants, et le 1er avril 2006, le jour précédant son entrée en vigueur.
Le ministère des Anciens Combattants est en train de doubler le nombre de cliniques pour traumatismes liés au stress opérationnel, qui passera à 10.
Ce ne sont là que quelques-unes des initiatives du gouvernement pour les anciens combattants.
Ma question porte sur une visite à Edmonton à laquelle bon nombre d'entre nous ont participé, la semaine dernière. Nous avons vu de nombreux anciens combattants, qui avaient subi soit des blessures physiques, soit des blessures psychologiques.
Nous avons visité un établissement merveilleux et discuté avec des anciens combattants. J'oublie comment s'appelle cet établissement, mais c'est là où les anciens combattants vont pour obtenir de l'aide et ajouter leur nom à la liste. Un des anciens combattants que j'ai rencontrés m'a dit qu'il avait attendu six mois avant d'obtenir de l'aide. Lors de notre visite, j'ai posé une question sur le temps qu'a dû attendre cet homme. . Les responsables connaissaient l'homme en question. Il n'avait pas besoin d'attendre six mois avant d'obtenir de l'aide ou d'avoir une consultation. Toutefois, puisque sa blessure n'était pas visible, il a été inscrit à un programme de six mois au cours duquel on a évalué l'étendue de sa blessure avant de pouvoir l'aider correctement.
Ce qui m'a frappé le plus — et je me demande si toutes les familles vivent la même situation —, c'est le manque d'informations. Pendant le repas, j'ai posé la même question à plusieurs anciens combattants de la nouvelle génération. Ils m'ont dit que oui, mais je m'adressais à des jeunes hommes et à des jeunes femmes de 25 ans qui se croyaient invincibles et qui ne pensaient jamais avoir de problèmes. Ils étaient des anciens combattants, mais ils ne portaient aucune blessure. Ils m'ont dit qu'ils préféraient faire autre chose que de participer à ces séminaires ennuyeux.
Les familles reçoivent-elles l'information dont elles ont besoin? Je suis convaincu qu'elles reçoivent de l'aide, mais est-ce qu'on leur dit où aller et est-ce qu'on les informe du genre d'aide qu'elles peuvent obtenir?
Mme Norris : Je suis d'accord avec vous. Je crois qu'on leur offre de l'aide. Cependant, il ne fait aucun doute qu'on doit en faire davantage. C'est pourquoi je dis que, pour combler les lacunes, il faut adopter des modèles de soins et déterminer ce que nous faisons de bien ainsi que les améliorations que nous pouvons apporter.
Je crois que nous pouvons mieux informer nos militaires, leurs familles et les anciens combattants sur ce qui se passe et ce qu'ils ont à leur disposition.
Le sénateur Plett : Comment corriger la situation? Avant notre visite à Edmonton, je croyais que tout était de notre faute. Puis, les jeunes m'ont dit que ce n'était pas le cas. Ils ont accès à des programmes; ils peuvent obtenir de l'information; ils préfèrent sortir prendre une bière plutôt que de participer au séminaire.
C'est un jeune homme de 25 ans qui m'a dit cela.
Comment nous assurer qu'ils reçoivent l'information dont ils ont besoin?
Mme Norris : Un des avantages ou désavantages d'être jeune, c'est qu'on pense que ce genre de chose ne nous arrivera jamais. Lorsque la blessure est invisible, c'est encore plus difficile à accepter.
Selon mes amis qui travaillent en psychologie, il peut s'écouler des mois, voire des années, avant que ces blessures n'apparaissent. Ce délai vient également compliquer la situation. Ce n'est pas comme un bras cassé ou une autre blessure physique.
Comment faire? Au risque d'avoir l'air de prêcher pour ma paroisse, peut-être est-ce exactement ce que je fais d'ailleurs, j'affirme que nous devons mener des recherches. En tant que chercheurs — et je fais moi-même de la recherche appliquée — et en tant que praticiens, c'est notre responsabilité d'aider les autres et de faire passer les bons messages non seulement sur les problèmes, mais aussi sur les solutions possibles.
Nous avons besoin de chercheurs, de décideurs et de praticiens, tant chez les militaires que chez les civils, des gens comme moi, qui travaillent ensemble avec un plan de communication bien élaboré pour faire comprendre aux gens que, premièrement, on reconnaît leur situation. Ça ne veut pas dire que nous n'aurons plus à traiter avec des jeunes de 25 ans qui s'imagineront n'avoir jamais besoin d'aide pour une blessure psychologique.
Je crois que ce qu'il faut, c'est un effort concerté de la part de gens qui ont le même objectif, soit offrir une aide positive pour la croissance et la résilience des militaires, les anciens combattants et leurs familles. Nous n'arriverons pas à résoudre ce problème du jour au lendemain, mais nous pouvons commencer à y travailler.
Le président : On ne peut communiquer comme si de rien n'était avec un militaire de 25 ans qui revient blessé d'une mission. Nous avons vu que certains commettent de très graves erreurs lorsqu'ils retournent à la vie civile. Les centres de soutien des familles ou les groupes d'appui conjoints cherchent encore à établir les bonnes façons de communiquer avec ces personnes qui ont subi des blessures psychologiques pour leur faire connaître les services offerts et voir à ce qu'elles reçoivent l'aide dont elles ont besoin.
Convenez-vous avec moi que ces gens ne sont pas nécessairement capables de comprendre ce qui leur arrive et que nous n'avons pas vraiment les outils pour le leur faire comprendre?
Mme Norris : Je suis d'accord avec vous. À mon avis, cela montre qu'il faut augmenter la recherche. Comment comprendre un jeune de 25 ans dans cette situation et l'aider à briser le cycle, et quels sont les meilleurs modèles de prévention et d'intervention?
Le président : Pour chaque militaire ayant des blessures physiques, il y en a six qui ont des blessures psychologiques. La nouvelle Charte des anciens combattants comprend des programmes pour adapter les maisons des anciens combattants, et cetera. La charte prévoit-elle, pour les familles dont les maisons sont adaptées pour accommoder un militaire qui a subi des blessures physiques, un soutien équivalent à celui offert aux militaires ayant subi des blessures psychologiques? Autrement dit, même si leur maison n'est pas modifiée, les besoins des familles de militaires blessés psychologiquement sont-ils suffisamment définis pour qu'on puisse les aider?
Mme Norris : Je remarque qu'on s'intéresse beaucoup à la définition de ces besoins, comme on peut le constater notamment dans le rapport de 2009 du groupe consultatif. Ce rapport parle des familles avec beaucoup de sensibilité. On y dit également que les familles peuvent et devraient jouer un rôle dans les soins que reçoit leur proche blessé, mais qu'elles devraient elles aussi avoir accès à des soins. Encore une fois, il peut y avoir des écarts entre l'intention et la réalité.
Il est bon de savoir que l'on considère la charte comme un document évolutif. Selon moi, même ceux qui travaillent à l'élaboration du document le perçoivent de cette façon. Il semble donc qu'on s'intéresse à certains de ces problèmes et qu'on considère qu'il faut maintenant prendre ce qui existe et l'améliorer pour le bien de tous, y compris les familles.
Le président : Le sénateur Wallin et moi avons participé à ce forum où les gens ont dit espérer que le gouvernement mette sur pied un institut de recherche sur le sujet. Si nous créons une charte en nous basant sur la résilience des familles, mais que nous n'avons pas de données de recherche sur lesquelles nous appuyer, devrions-nous inclure dans la charte une obligation de mener des recherches, de les financer et d'y consacrer les ressources nécessaires?
Mme Norris : Oui.
Le sénateur Wallin : De qui parlez-vous lorsque vous dites « nous »?
Le président : Je parle du gouvernement, qui administre la charte. Devrait-on exiger dans la charte que des recherches soient menées pour obtenir des données sur la résilience afin de pouvoir offrir les services nécessaires?
Mme Norris : À mon avis, oui. Vers la fin de son rapport, le groupe consultatif parle brièvement de la nécessité de mener des recherches.
Le sénateur Pépin : Si j'ai bien compris, vous avez dit qu'il peut s'écouler un ou deux ans avant que les jeunes soldats qui reviennent de missions montrent des signes de blessures psychologiques?
Mme Norris : C'est le cas aussi pour tout le monde, peu importe l'âge, pas seulement pour les jeunes militaires ou les anciens combattants de la nouvelle génération. C'est ce que j'ai appris en lisant des textes de psychologie. Les symptômes liés au trouble de stress post-traumatique en particulier peuvent prendre un certain temps avant de se manifester.
Le président : Merci beaucoup, madame Norris, et merci pour les renvois que vous avez faits au travail du Dr Harrison. Nous obtiendrons une copie des documents dont vous avez parlé , ainsi que de l'étude du groupe de l'Alberta. Merci énormément pour ces renseignements.
Chers collègues, vous avez reçu une ébauche, dans les deux langues officielles, du plan de travail de la prochaine année. Nous allons maintenant poursuivre notre réunion à huis clos pour examiner ensemble ce plan de travail et y mettre la touche finale.
(La séance se poursuit à huis clos.)