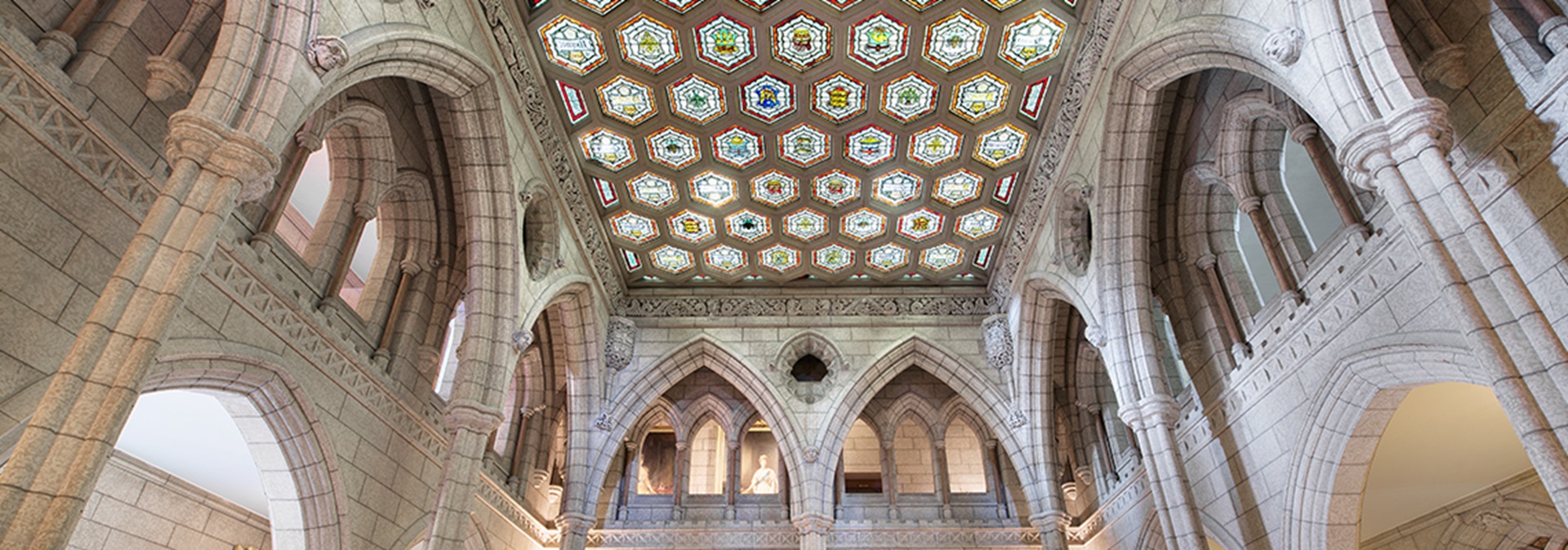Délibérations du sous-comité de
mise à jour de «De la vie et de la mort»
Fascicule 1 - Témoignages
OTTAWA, le mardi 30 novembre 1999
Le sous-comité de mise à jour de «De la vie et de la mort» du comité sénatorial permanent des affaires sociales, des sciences et de la technologie se réunit aujourd'hui à 11 heures pour organiser ses activités.
Mme Heather Lank, greffière du comité: Honorables sénateurs, nous avons quorum. En tant que greffière de votre sous-comité, il est de mon devoir de présider à l'élection de la présidence. Je suis prête à accueillir des motions.
[Traduction]
Le sénateur Kirby: Je propose que le sénateur Carstairs assume la présidence.
Mme Lank: Y a-t-il d'autres motions? Comme il n'y en a pas d'autres, êtes-vous d'accord, honorables sénateurs, pour adopter la motion?
Des voix: D'accord.
Mme Lank: La motion est adoptée. J'invite le sénateur Carstairs à occuper le fauteuil.
Le sénateur Sharon Carstairs (présidente) occupe le fauteuil.
La présidente: Honorables sénateurs, je vous remercie de m'avoir confié la présidence du comité.
Vous avez devant vous des documents: un exemplaire du rapport «De la vie et de la mort» ainsi qu'une note d'information préparée par Mollie Dunsmuir au sujet de la mise à jour de «De la vie et de la mort». Ceux d'entre vous qui siégiez au comité avec moi se souviendront qu'elle était notre attachée de recherche à l'époque. Elle a continué de s'intéresser à ce dossier et a effectué une mise à jour en 1998. Je lui ai demandé d'en faire une autre cette année. Cette dernière version vient tout juste d'être imprimée, le 25 novembre dernier. Le document d'information fait le point sur un certain nombre de situations qui sont survenues depuis la rédaction du rapport original. Vous avez également en main une ébauche de budget pour l'exercice financier se terminant le 31 mars 2000 et un autre pour l'exercice financier se terminant le 6 juin 2000.
Commençons par un certain nombre de motions qu'il nous faut adopter pour assurer le bon fonctionnement du sous-comité.
Sénateur Beaudoin, êtes-vous disposé à être vice-président du comité?
Le sénateur Beaudoin: Si c'est nécessaire.
Le sénateur Kirby: Je propose cette motion.
La présidente: Êtes-vous d'accord, honorables sénateurs?
Des voix: D'accord.
La présidente: Adoptée.
Le sénateur Pépin: Je propose
Que le sous-comité fasse imprimer 300 exemplaires de ses délibérations et que la présidence soit autorisée à ajuster cette quantité en fonction des besoins.
La présidente: Honorables sénateurs, êtes-vous d'accord pour adopter la motion?
Des voix: D'accord.
La présidente: Adoptée.
Le sénateur Pépin: Je propose:
Que, conformément à l'article 89 du Règlement, la présidence soit autorisée à tenir des réunions pour entendre des témoignages et à en permettre la publication en l'absence de quorum, pourvu qu'un représentant du gouvernement et un représentant de l'opposition soient présents.
La présidente: Honorables sénateurs, êtes-vous d'accord pour adopter la motion?
Des voix: D'accord.
La présidente: Je suis prête à accueillir la motion suivante:
Que le sous-comité demande à la Bibliothèque du Parlement d'affecter des attachés de recherche auprès du sous-comité et que la présidence, au nom du sous-comité, dirige le personnel de recherche dans la préparation d'études, d'analyses, de résumés et de projets de rapport.
Le sénateur Kirby: J'en fais la proposition.
Le sénateur Corbin: Je ne suis pas membre du sous-comité, mais vous m'avez invité à assister à la séance. Vous allez plutôt vite.
La présidente: Ce sont toutes des motions de routine.
Le sénateur Corbin: À mon avis, il n'y a plus rien de routinier. Pouvez-vous répéter le texte de cette motion?
La présidente: La motion se lit ainsi:
Que le sous-comité demande à la Bibliothèque du Parlement d'affecter des attachés de recherche auprès du sous-comité et que la présidence, au nom du sous-comité, dirige le personnel de recherche dans la préparation d'études, d'analyses, de résumés et de projets de rapport.
Le sénateur Beaudoin: La première partie de la motion ne me cause aucun problème, mais ce n'est pas le cas de la deuxième. En effet, il s'agit d'un comité, et non d'un comité composé d'une seule personne.
La présidente: Rappelez-vous que la présidence ne peut agir qu'au nom du sous-comité.
Le sénateur Kirby: L'attaché de recherche doit faire rapport à quelqu'un, et ce quelqu'un c'est la présidence. La présidence peut donner des ordres à l'équipe de recherche uniquement au nom du sous-comité.
Le sénateur Beaudoin: Une fois que le sous-comité a pris une décision.
La présidente: Exactement.
Le sénateur Corbin: Cela doit être interprété selon l'orientation suggérée par le sous-comité.
La présidente: Tout à fait.
Le sénateur Corbin: Autrement dit, vous ne pouvez adopter une approche totalement différente des membres du comité ou diverger sensiblement du consensus établi.
La présidente: Absolument. Je dois agir au nom du sous-comité. Honorables sénateurs, êtes-vous d'accord pour adopter la motion?
Des voix: D'accord.
La présidente: D'adoptée. Quelqu'un pourrait-il proposer:
Que, conformément à l'article 32 de la Loi sur la gestion des finances publiques, l'autorisation d'engager les fonds du sous-comité soit conférée à la présidence, en son absence, la vice-présidence; et
Que, conformément à l'article 34 de la Loi sur la gestion des finances publiques et à la directive 3:05 de l'annexe II du Règlement du Sénat, l'autorisation d'approuver les comptes à payer au nom du sous-comité soit conférée individuellement à la présidence, la vice-présidence et au greffier du sous-comité.
Le sénateur Kirby: J'en fais la proposition.
La présidente: Honorables sénateurs, êtes-vous d'accord pour adopter la motion?
Des voix: D'accord.
La présidente: Adoptée. Je vais maintenant accueillir la motion suivante:
Que, conformément aux lignes directrices du Sénat gouvernant les frais de déplacement des témoins, le sous-comité peut rembourser des dépenses raisonnables de voyage et d'hébergement à un témoin d'un même organisme, après qu'une demande de remboursement ait été présentée, mais que la présidence soit autorisée à permettre le remboursement de dépenses pour un deuxième témoin en cas de circonstances exceptionnelles.
C'est la règle que nous utilisions au comité permanent des affaires juridiques et constitutionnelles. Ainsi, en cas de circonstances exceptionnelles, par exemple si une personne handicapée avait besoin d'être accompagnée pour venir comparaître devant nous, nous paierions aussi les dépenses de cette personne.
Le sénateur Corbin: Avez-vous l'intention de convoquer un grand nombre de témoins de l'extérieur?
La présidente: La décision appartient au comité, mais j'espère que nous pourrons aujourd'hui décider quel témoins nous voudrons entendre.
Le sénateur Beaudoin: J'ai un problème, en ce sens que je siège à tellement de comités que je n'ai pas le temps de voyager. Si les témoins viennent ici, je n'ai pas d'objections. Cependant, si nous devons nous déplacer pour les entendre, à ce moment-là, j'ai un problème.
La présidente: Sénateur Beaudoin, si vous consultez notre budget, vous verrez qu'aucun déplacement n'est prévu. Toutes les séances auront lieu ici.
Le sénateur Beaudoin: Le meilleur exemple est celui du comité permanent des affaires juridiques et constitutionnelles. C'est un très bon comité qui ne coûte pratiquement rien.
La présidente: Il est question des dépenses de voyage et d'hébergement des témoins, et non des sénateurs.
Le sénateur Beaudoin: Très bien. J'en fais la proposition.
La présidente: Honorables sénateurs, êtes-vous d'accord pour adopter la motion?
Des voix: D'accord.
La présidente: Adoptée.
Pour ce qui est de l'heure des séances régulières du sous-comité, le comité des affaires sociales se réunit à 15 30 le mercredi et à 11 h 30 le jeudi. Dans certains cas, il y a conflit avec le comité sénatorial permanent des affaires juridiques et constitutionnelles. Je propose de limiter le nombre de séances que nous aurons au début, mais d'essayer de réserver le lundi après-midi. Il va de soi que vous seriez avertis longtemps à l'avance. Cela vous convient-il?
Le sénateur Beaudoin: Le lundi après-midi?
Le sénateur Kirby: Le lundi après-midi, cela ne me plaît guère. En effet, c'est le seul jour de la semaine où je ne suis pas tenu d'être ici. Que pensez-vous du mardi matin?
Le sénateur Beaudoin: Le mercredi et le jeudi, c'est impossible. Le mardi après-midi, c'est impossible également. Qu'est-ce qui ne va pas le lundi après-midi?
Le sénateur Kirby: Je n'aime pas tellement venir en ville, à moins d'y être obligé.
Le sénateur Carstairs: Et le mardi matin de 8 h 30 à 10 h 30?
Le sénateur Kirby: Cela ne me pose aucun problème.
La présidente: Ce sera très difficile pour le sénateur Keon car il est normalement en salle d'opération à cette heure-là.
Le sénateur Kirby: Étant donné que nous n'aurons pas tellement de réunions, nous pourrions peut-être sonder les membres et trouver un créneau au lieu de prescrire une heure en particulier car d'une semaine à l'autre, les horaires peuvent changer.
Le sénateur Beaudoin: Si nous n'avons pas tellement de séances, j'accepterai le mardi matin. Le mardi est un jour terrible pour moi. Je suis pris de midi à 18 heures.
Le sénateur Pépin: C'est la même chose pour moi, mais le seul temps dont je dispose est le mardi matin. Le reste de la semaine est complet.
Le sénateur Beaudoin: Entendons-nous là-dessus, dans ce cas.
Le sénateur Corbin: Vous avez convenu de fonctionner sans que tous les membres du comité soient présents. La tâche principale du sous-comité est de recueillir de l'information. Par conséquent, si certaines personnes ne peuvent être présentes un jour en particulier ou encore une matinée ou un après-midi, le comité ne sera pas empêché de fonctionner. Je pense qu'il devrait aller de l'avant pour ne pas faire traîner les choses en longueur.
La présidente: Entendons-nous sur le mardi de 8 h 30 à 10 h. 30.
Le sénateur Beaudoin: Cette heure ne me convient pas car j'habite de l'autre côté de la rivière. Il me faut traverser le pont, et c'est extrêmement difficile à l'heure de pointe, le matin. Cela dit, 9 heures c'est acceptable.
La présidente: Nous allons donc nous réunir de 9 heures à 11 heures.
Honorables sénateurs, je vous ai soumis deux budgets. J'aimerais que nous adoptions le premier aujourd'hui pour que nous puissions ensuite le présenter au comité permanent de la régie interne, des budgets et de l'administration. Je voulais que vous voyiez l'étude intégrale. Comme vous pouvez le constater, les coûts sont très modestes. Le budget pour le 31 mars 2000 s'élève à 7 890 $ et à compter du 6 juin 2000, on prévoit 3 100 $. J'ai l'impression que nous ne dépenserons pas cet argent pour les repas si nous nous réunissons de 9 heures à 11 heures le matin.
Le sénateur Kirby: Ces deux budgets sont tellement raisonnables que je suis très heureux d'avoir présenté la motion d'adoption. En fait, cela ne représente que 11 000 $.
La présidente: Honorables sénateurs, êtes-vous d'accord pour adopter la motion?
Des voix: D'accord.
La présidente: Adoptée.
Passons maintenant à la partie la plus importante de la séance, c'est-à-dire notre plan de travail, que vous avez devant vous. Notre mandat a été approuvé par le Sénat. Je veux qu'une chose soit très claire entre nous, soit que notre comité n'a pas l'intention de passer en revue les décisions qui ont été prises au sujet de l'euthanasie et du suicide assisté. Nous n'allons pas examiner ces recommandations. Notre examen s'attachera aux recommandations unanimes du comité, c'est-à-dire les recommandations unanimes concernant l'abstention et l'interruption de traitement de survie, les soins palliatifs, les directives préalables, les pratiques de sédation, autrement dit tout ce qui a fait l'objet d'une recommandation unanime dans le rapport. Nous allons demander une mise à jour.
Le sénateur Corbin a posé une question au sujet des témoins que nous entendrons. J'aimerais donner à l'équipe de recherche l'autorisation de dresser pour nous, au début de février, une liste de témoins sur l'état des soins palliatifs au Canada pour que nous puissions savoir si, depuis cinq ans, il y a davantage de services de ce genre disponibles pour les patients canadiens. Je veux déterminer s'il y a une meilleure formation médicale dans ce domaine à l'heure actuelle. Nous avions appris qu'il y avait peu ou pas de formation dans le domaine du contrôle de la douleur et des pratiques sédatives à l'université. Je voudrais que nous puissions communiquer avec certains des témoins antérieurs, comme le docteur MacDonald de Montréal. Ainsi, nous pourrons savoir ce qui se passe à l'heure actuelle dans les facultés de médecine pour ce qui est de la formation des futurs médecins.
Le sénateur Beaudoin: Je suis heureux de savoir comment nous fonctionnerons car j'ai toujours dit que nous devrions mettre en oeuvre toutes nos décisions unanimes le plus tôt possible. Je suis d'accord avec ce principe depuis le début. Je suis prêt à participer à ce travail. Combien de temps prendra le sous-comité? Un an ou deux?
La présidente: Nous devons soumettre notre rapport le 6 juin.
Le sénateur Beaudoin: Dès le mois de juin?
La présidente: Cela coïncide avec l'anniversaire de cinq ans.
Le sénateur Beaudoin: Allons-nous étudier toutes nos décisions unanimes?
La présidente: C'est exact.
Le sénateur Beaudoin: Je n'ai aucune objection.
La présidente: Nous ne voulons pas revenir sur le rapport. Nous avons fait un travail exhaustif.
Le sénateur Beaudoin: Nous devrions à tout le moins commencer par la partie unanime.
Le sénateur Corbin: Vous avez dit tout à l'heure que nous mettions maintenant les choses sur la table et pourtant, dans le budget des transports et des communications, il y a trois points concernant des vidéoconférences, avec l'Australie, les Pays-Bas et l'Orégon. Pourquoi a-t-on inclus les Pays-Bas et l'Oregon, si nous devons traiter des recommandations unanimes? Il s'agit là d'aspects controversés.
La présidente: La première partie du mandat du comité, qui a été approuvé par le Sénat, consiste à évaluer les progrès réalisés dans la mise en oeuvre des recommandations unanimes du rapport. C'est la première chose dont j'ai parlé. La deuxième partie du mandat concerne l'évolution de la situation au Canada pour ce qui est des questions évoquées dans le rapport. Cela porte précisément sur des domaines comme les directives préalables. La plupart des provinces ont adopté une loi concernant les directives préalables. Une autre chose que je veux faire aujourd'hui, c'est autoriser un membre du personnel à communiquer par écrit avec les autorités provinciales pour que nous puissions obtenir une mise à jour sur le statut de ce genre d'information. La troisième partie du mandat porte sur l'évolution de la situation à l'étranger.
Cela ne suppose aucun jugement, sénateur Corbin. Ce document est maintenant utilisé dans les facultés de médecine dans tout le pays. Le sénateur Kinsella nous a dit qu'il l'utilise. Cependant, certains des renseignements concernant la situation à l'étranger ne sont plus exacts. Mme Dunsmuir en a déjà parlé -- si vous avez l'occasion de lire son rapport concernant le territoire septentrional de l'Australie. Nous avons inclus l'Oregon, les Pays-Bas et l'Australie dans notre budget pour que, si nous ne sommes pas satisfaits des renseignements que les attachés de recherche auront pu obtenir concernant ce qui se passe dans ces pays, nous puissions avoir la marge de manoeuvre voulue pour organiser une vidéoconférence avec les autorités responsables et ainsi obtenir davantage d'informations que nous pourrons ajouter au rapport. Cependant, je tiens à expliquer clairement que toutes les communications avec les autorités étrangères ne s'inscriront pas dans notre examen des recommandations; elles auront uniquement pour but de recueillir de l'information.
Le sénateur Beaudoin: Un autre aspect me frappe. Il s'agit d'un domaine qui relève partiellement de la compétence des provinces. Lorsque nous avons fait notre étude, en 1994-1995, nous avons été très prudents afin de ne pas nous immiscer dans un champ de responsabilité provincial. Nous continuerons à agir de la même façon, mais rien ne nous empêche d'énoncer nos conclusions et nos suggestions. Cependant, nous devons tenir compte de cet aspect qui rejoint la santé et qui relève de la responsabilité des provinces. Nous ne nous sommes jamais ingérés dans un domaine de compétence provinciale, et j'espère que cela continuera.
La présidente: Absolument. J'aimerais qu'on présente deux motions. La première se lirait comme suit:
Que l'on demande au personnel de communiquer avec les autorités provinciales afin d'obtenir une mise à jour de l'information concernant leur province au sujet des recommandations unanimes du rapport.
Le sénateur Kirby: J'en fais la proposition.
La présidente: Honorables sénateurs, êtes-vous d'accord pour adopter la motion?
Des voix: D'accord.
La présidente: Adoptée.
Deuxièmement, je voudrais qu'on présente une motion autorisant le personnel à dresser une liste et à communiquer avec des témoins au sujet des recommandations unanimes et des progrès réalisés quant à leur mise en oeuvre. Autrement dit, des témoins qui nous parleraient des soins palliatifs, ainsi que de l'abstention et de l'interruption d'un traitement de survie, et cetera.
Le sénateur Corbin: J'ai réfléchi au sujet des témoins bien avant la séance. Pourquoi ne pas demander au ministre de la Santé, M. Rock, de comparaître devant le comité? Ce serait intéressant pour deux raisons. Je suppose que ce sera l'un des principaux acteurs amenés à agir au sujet de nos recommandations, certainement en ce qui a trait aux soins palliatifs, ainsi qu'aux entretiens avec les provinces et au financement. En outre, lorsqu'il était titulaire du ministère de la Justice, il a comparu devant le comité au moment de notre étude de ces questions épineuses. Il pourrait sans doute nous faire bénéficier de son opinion générale pour ce qui est des deux aspects de la question.
La présidente: Il y a deux ministres que j'aimerais entendre au sujet des progrès réalisés: le ministre de la Santé, qui était le ministre de la Justice lorsque le rapport a été rédigé, et l'actuelle ministre de la Justice.
Le sénateur Kirby: Tout comme moi.
La présidente: J'aimerais obtenir du comité l'autorisation d'expliquer à ces ministres, dans une lettre détaillée, ce dont nous aimerions qu'ils nous parlent. Je me servirais des recommandations unanimes pour rédiger ces lettres. Il est inutile de leur dire: «Nous voulons que vous veniez comparaître.» J'aimerais préciser: «Nous voudrions que vous veniez nous parler de telle ou telle chose.» Autrement dit, j'aimerais que leur intervention soit très précise, qu'elle se fonde sur les recommandations unanimes contenues dans le rapport.
Le sénateur Beaudoin: M. Rock a l'avantage d'être non seulement le ministre de la Santé, mais également un excellent juriste.
La présidente: Est-ce d'accord, honorables sénateurs?
Des voix: D'accord.
La présidente: D'accord.
Ai-je votre autorisation de demander au personnel de commencer à dresser la liste des témoins pour que nous puissions commencer en février?
Des voix: D'accord.
La présidente: Adopté.
Je n'ai pas l'intention de convoquer de séances avant février. Cependant, je demeurerai sans doute en contact avec vous, y compris les membres de l'ancien comité, pour que vous ayez une idée de notre orientation.
Le sénateur Corbin: Je l'apprécierais.
La présidente: Je vous ferai distribuer également des copies des lettres que j'enverrai aux ministres.
Le sénateur Beaudoin: Avez-vous parlé au sénateur DeWare?
La présidente: Oui. Elle espère participer activement aux travaux du comité, tout comme le sénateur Keon et le sénateur Lavoie-Roux, en supposant, évidemment, que son état de santé s'améliore et qu'elle revienne. À ce moment-là, il y aura six des sept membres du comité original qui seront en mesure d'apporter leur contribution.
Le sénateur Corbin: J'ai pensé souvent à l'ex-sénateur Joan Neiman, qui assumait la présidence du comité original. Je l'ai rencontrée à quelques rares occasions depuis le dépôt du rapport. Apparemment, elle a reçu énormément de courrier et de commentaires au sujet du rapport, mais nous n'en avons pas pris connaissance. Cette correspondance lui était adressée et elle l'a conservée par-devers elle. Je n'ai jamais reçu ce genre de rétroaction. En supposant qu'elle soit toujours active, serait-il utile pour le comité de l'entendre?
La présidente: Je serais ravie d'entendre le sénateur Neiman. Je propose que nous l'invitions à comparaître et à partager avec nous les réactions qu'on lui a communiquées depuis cinq ans.
Le sénateur Corbin: Ce n'est qu'une suggestion.
La présidente: C'est une merveilleuse suggestion.
La séance est levée.
OTTAWA, le lundi 14 février 2000
Le sous-comité de la mise à jour de «de la vie et de la mort» du comité sénatorial permanent des affaires sociales, des sciences et de la technologie se réunit aujourd'hui à 14 h 01 pour étudier les faits nouveaux survenus depuis le dépôt, en juin 1995, du rapport final du comité sénatorial spécial sur l'euthanasie et l'aide au suicide intitulé «De la vie et de la mort».
Le sénateur Sharon Carstairs (présidente) occupe le fauteuil.
[Traduction]
La présidente: Comme le prévoit notre mandat, nous entamons aujourd'hui des audiences destinées à mettre à jour les recommandations qu'a prises à l'unanimité le comité sénatorial spécial de 1995 dans son rapport sur l'euthanasie et l'aide au suicide intitulé «De la vie et de la mort».
Je voudrais rappeler aux sénateurs et aux témoins que notre comité ne désire pas ouvrir le débat sur l'aide au suicide et sur l'euthanasie, mais qu'il veut s'en tenir strictement aux parties du rapport qui ont fait l'objet de recommandations unanimes de la part du premier comité. J'espère que l'on tiendra compte de cette mise en garde tout au long des audiences.
Nous avions invité aujourd'hui trois témoins qui devaient nous éclairer sur les grands enjeux dont nous sommes saisis. Malheureusement, le professeur Keyserlingk, de l'Unité d'éthique biomédicale de la Faculté de médecine de l'université McGill, ne peut se joindre à nous parce qu'il est retenu par la neige à Montréal. Les deux autres témoins qui ont été invités sont bien connus des membres de notre comité. Il s'agit du professeur Jocelyn Downie, qui nous a aidés pendant plusieurs mois pendant la préparation du premier rapport, et du professeur Barney Sneiderman.
Mme Jocelyn Downie, professeure, Health Law Institute, Université Dalhousie: Honorables sénateurs, merci beaucoup de m'avoir invitée cet après-midi à prendre part à vos travaux. Je vous félicite de vous être engagés à mettre à jour le rapport sénatorial terminé il y a maintenant cinq ans.
On m'a demandé de faire un survol des progrès accomplis depuis cinq ans eu égard aux recommandations qu'avaient faites à l'unanimité le comité sénatorial spécial sénatorial sur l'euthanasie et l'aide au suicide dans son rapport intitulé «De la vie et de la mort». Étant donné les contraintes de temps, je me suis limitée à deux tâches: d'abord, je veux faire le point sur le statut juridique de certaines parties du rapport «De la vie et de la mort» en vous signalant les changements juridiques qui sont survenus, s'il y a eu, et je veux aussi vous signaler toute évolution qui aurait pu survenir dans chacune des catégories de l'aide au suicide; en second lieu, je voudrais vous expliquer où en sont les recommandations d'ordre juridique qui ont été faites à l'unanimité dans le rapport «De la vie et de la mort».
Je vais d'abord aborder les pratiques de sédation et de traitement de la douleur et les changements dans le milieu juridique. À vrai dire, il n'y en a pas eu. On peut à peine parler de quelques changements significatifs d'ordre juridique. En 1996, le sénateur Carstairs déposait un projet de loi devant préciser dans la loi les questions d'abstention de traitement de la douleur et de pratiques de sédation. Le projet de loi est mort au Feuilleton au moment du déclenchement des dernières élections fédérales.
Puis le sénateur Lavoie-Roux a déposé un autre projet de loi aux mêmes fins, qui est mort au Feuilleton à son tour, lors de la première session de la 36e législature.
En 1999, le sénateur Carstairs déposait un autre projet de loi destiné à nouveau à faire préciser dans la loi des questions concernant les pratiques de traitement de la douleur et de sédation. Nous avons hâte de voir ce qu'il adviendra de ce projet de loi.
Quant à ce qu'il est advenu des recommandations d'ordre juridique prises à l'unanimité par le dernier comité eu égard au traitement de la douleur et aux pratiques de sédation, elles sont tout simplement restées lettre morte. Le Code criminel n'a pas été modifié pour apporter des précisions à la pratique de traitement de la douleur dans le but de soulager la souffrance, même si cela pouvait abréger la vie du patient.
Passons maintenant aux modifications du statut juridique: il n'y a rien eu de fait au palier fédéral. Dans les provinces, toutefois, les choses ont bougé quelque peu. Ainsi, la loi ontarienne de 1996 intitulée «Health Care Consent Act» prévoit désormais que le patient a le droit clairement énoncé de refuser un traitement qui pourrait assurer sa survie.
Il y a également plusieurs événements d'importance qui sont survenus et que j'aimerais commenter. Je me reporte à nouveau au projet de loi de 1996 du sénateur Carstairs dans lequel elle voulait faire préciser dans la loi des questions concernant l'abstention et l'interruption du traitement de survie, puis au projet de loi du sénateur Lavoie-Roux, dont les objectifs étaient les mêmes, puis enfin au projet de loi de 1999. Ces trois projets de loi portaient tous sur le traitement de la douleur et sur les pratiques de sédation ainsi que sur l'abstention ou l'interruption du traitement de survie.
Laissez-moi passer de l'aspect général de l'abstention et de l'interruption de traitement à certaines catégories spécifiques de gens ainsi qu'à des événements survenus concernant ces catégories de gens touchés par les questions d'interruption et d'abstention. La Cour suprême du Canada s'est penchée sur l'interprétation en common law du refus de traitement dans le cas des mineurs non mûrs, dans l'affaire Sheena B. Alors que la situation n'était pas aussi claire que cela à l'époque où le comité sénatorial a publié son rapport, il est désormais clair que lorsque l'abstention et l'interruption de traitement de survie est dans l'intérêt de l'enfant, les parents ont le droit de refuser le traitement, et leur refus doit être respecté. Toutefois, lorsque le traitement est, au contraire, dans l'intérêt de l'enfant, le refus des parents peut-être annulé par l'État.
Le deuxième groupe d'individus qui nous préoccupent ici, ce sont les mineurs mûrs. Depuis la publication du rapport sénatorial sur l'euthanasie et l'aide au suicide, il s'est produit certains événements d'ordre législatif dans le domaine du common law qui touchent les mineurs mûrs. Toutefois, la plupart des lois provinciales ou le common law ne nous éclairent pas beaucoup là-dessus. De façon plus particulière, il n'a pas encore été établi clairement si les mineurs qui comprennent la nature et les conséquences de leur décision devraient pouvoir faire respecter leur choix, ou si leur décision de se faire traiter ou non doit être respectée uniquement si une tierce partie -- le professionnel de la santé ou le tribunal -- considère que c'est dans l'intérêt véritable du patient.
Le troisième groupe auquel s'appliquent l'abstention et l'interruption, c'est le groupe d'individus qui cherchent unilatéralement à interrompre ou à refuser le traitement de survie. Or, le débat devient alors futile. Au cours des dernières années, deux cas sont survenus qui posent la question de ce qui devrait arriver lorsque les fondés de pouvoir demandent le traitement, mais que l'équipe médicale est d'avis que le traitement ne serait pas dans l'intérêt véritable du patient incapable de décider. C'est l'envers de la situation que l'on trouve généralement dans les cas d'abstention et d'interruption de traitement. Comme mon collègue, Barney Sneiderman, est censé vous en parler en détail, je m'abstiendrai de m'y attarder. Vous trouverez tout ce qu'il vous faut dans le mémoire que je ferai tenir au comité.
Pour nos fins aujourd'hui, et pour bien vous exposer la situation, qu'il me suffise de vous signaler qu'il y a eu dans ce domaine deux causes extrêmement médiatisées et controversées. On a abondamment discuté de la question de l'abstention et de l'interruption unilatérales de tout traitement de survie. Par conséquent, cette question qui était en veilleuse en 1995 est maintenant arrivée à l'avant-plan et doit être abordée.
Cela m'amène au statut des recommandations d'ordre juridique concernant l'abstention et l'interruption. Le Code criminel n'a pas été amendé. Aucune loi en ce sens n'a été adoptée en vue de reconnaître explicitement cette situation et en vue de préciser les circonstances dans lesquelles l'abstention ou l'interruption d'un traitement de survie est acceptable du point de vue juridique.
Depuis la publication du rapport «De la vie et de la mort», plusieurs provinces ont choisi de présenter des mesures législatives sur les directives préalables. Sept provinces et un territoire ont aujourd'hui adopté et promulgué des lois en ce sens; deux provinces ont déjà adopté une loi qui n'est pas encore promulguée, même si dans l'un des cas la loi remonte à 1993; enfin, une province et deux territoires n'ont aujourd'hui encore rien fait pour traiter des directives préalables.
Comme il n'y a eu aucun événement d'ordre juridique d'envergure touchant les directives préalables, on pourrait dire que les recommandations d'ordre juridique du comité ont été «partiellement suivies» ou «pas du tout suivies». Elles ont été partiellement suivies en ce que certaines provinces et certains territoires qui n'avaient aucune loi sur les directives préalables en ont adopté une depuis, tel que le recommandait le comité. Toutefois, les provinces et territoires pris collectivement n'ont pas souscrit à un protocole qui leur permettrait d'appliquer les directives préalables acceptées ailleurs.
Passons maintenant à l'aide au suicide. La situation juridique entourant l'aide au suicide n'a pas changé au Canada. Toutefois, il faut signaler plusieurs cas qui nous intéressent ici. En octobre 1995, Mary Fogarty a été reconnue coupable d'avoir aidé une amie à se suicider. Le ministère public et le jury ont jugé que Mary Fogarty avait fourni à Brenda Barnes, qui était diabétique, des seringues et de l'insuline et qu'elle avait écrit pour Barnes sa note de suicide. Fogarty a été reconnue coupable et condamnée à trois années de probation ainsi qu'à 300 heures de service communautaire. Ainsi, elle devenait la première personne en 30 ans à avoir été mise en accusation au titre de l'alinéa 241b) du Code criminel et a avoir été reconnue coupable. En juin 1996, le docteur Maurice Genereux était accusé en vertu de l'alinéa 241b) du Code criminel d'avoir aidé un patient à se suicider. En mai 1997, d'autres chefs d'accusation s'ajoutaient, et il a fini par être inculpé d'avoir encouragé son patient à se suicider, de même que de l'avoir carrément aidé à le faire. Le docteur Genereux était accusé d'avoir prescrit des médicaments à deux patients porteurs du VIH. L'un d'entre eux a fini par se suicider, alors que l'autre a fait des tentatives en ce sens. C'était la première fois qu'un médecin était accusé de ce crime au Canada. En décembre 1997, après avoir plaidé coupable, il devenait le premier médecin accusé aux termes de cette disposition du Code criminel. Enfin, Burt Doerksen est censé subir son procès en août 2000 sous l'inculpation d'aide au suicide. Il est accusé d'avoir aidé sa femme de 78 ans à se suicider par inhalation de monoxyde de carbone dans le garage familial.
Passons maintenant à la situation des recommandations d'ordre juridique. Ces recommandations ont été suivies par défaut, car aucun amendement n'a été apporté à l'infraction que constitue le faut de conseiller le suicide au titre des alinéas 241a) ou b), et l'alinéa 241b) reste inchangé. Il avait été recommandé de laisser les choses telles quelles, et c'est effectivement ce qui a été fait: elles n'ont pas été touchées.
Je vais m'attarder enfin sur l'euthanasie. Vous pourriez vous demander si les choses ont changé du point de vue juridique. Non, elles n'ont pas changé. Je sais que je me répète cet après-midi. Mais qu'en est-il d'événements survenus qui pourraient avoir une incidence du point de vue juridique? Encore une fois, il faut signaler plusieurs cas. En 1993, Robert Latimer était accusé de meurtre au premier degré pour la mort de sa fille. Il avait placé sa fille sévèrement handicapée dans la cabine de son camion et l'avait asphyxiée avec du monoxyde de carbone dans le but de soulager ce qu'il croyait être des souffrances insurmontables. M. Latimer a été reconnu coupable de meurtre au second degré et a été condamné à une peine d'emprisonnement à perpétuité avec le minimum obligatoire, sans possibilité de libération conditionnelle pendant dix ans. Après avoir interjeté appel avec succès de sa condamnation auprès de la Cour suprême, celle-ci ordonnait un nouveau procès sous prétexte que la poursuite avait suborné le jury en exigeant des agents de la GRC qu'ils demandent aux jurés potentiels ce qu'ils pensaient de l'euthanasie et de l'avortement du point de vue éthique et religieux.
M. Latimer a donc fait l'objet d'un deuxième procès sous l'inculpation de meurtre au second degré et a été reconnu coupable. Malgré la peine d'emprisonnement obligatoire à vie sans possibilité de libération conditionnelle avant dix ans, M. Latimer était en fait condamné à deux ans moins un jour d'emprisonnement, la première année devant être passée en prison et la deuxième en détention à domicile. Cette sentence extraordinaire n'a été possible que parce que le juge de première instance avait accordé à Latimer une exemption constitutionnelle de la peine minimale obligatoire sous prétexte que cette punition serait anticonstitutionnelle et constituerait une peine cruelle et inusitée allant ainsi à l'encontre des droits de M. Latimer reconnus par l'article 12 de la Charte. La Cour d'appel rejetait l'appel de M. Latimer, acceptait l'appel du ministère public et imposait au prévenu une peine minimale obligatoire. La cause est aujourd'hui en appel et devrait être entendue par la Cour suprême du Canada incessamment. J'ai voulu savoir quand, mais je n'ai pu obtenir de date. Toutefois, elle aurait dû être entendue il y a déjà quelque temps. Nous nous attendons à ce qu'elle le soit d'ici six mois.
Vous connaissiez sans doute aussi l'affaire de la docteure Nancy Morrison. En 1997, la docteure Nancy Morrison était accusée de meurtre au premier degré à la suite de la mort de Paul Mills, un patient de 65 ans souffrant du cancer de l'oesophage. Après de nombreuses interventions, notamment des chirurgies, il avait été déterminé qu'on ne pouvait rien faire de plus pour lui. Avec le consentement de la famille du patient, on a arrêté tout traitement pouvant lui permettre de survivre et on l'a débuté. Malheureusement, aucun des médicaments qui lui étaient administrés ne semblait le soulager de ses souffrances. Il semblait souffrir énormément et avait du mal à respirer. Il a été allégué que pour soulager son patient de douleurs insurmontables la docteure Morrison avait donné à Paul Mills une injection mortelle de chlorure de potassium. La docteure Morrison fut ensuite mise en liberté sur cautionnement et s'est ensuite remise à pratiquer de façon limitée.
À la fin de l'enquête préliminaire, le juge Randall Hughes concluait qu'un jury dûment constitué ne pouvait juger l'accusée coupable de l'accusation en question, ni même de toute autre accusation, et il libérait la docteure Morrison. Le ministère public demandait ensuite un bref de certiorari en vue de casser le jugement du juge Randall. Toutefois, comme il s'agissait là d'un contrôle judiciaire d'un jugement rendu lors d'une enquête préliminaire plutôt que lors d'un véritable appel, le critère à établir fut celui de l'excès de compétence plutôt que de l'erreur de droit. Ainsi, même si le juge Hamilton concluait que la juge Hughes avait effectivement fait une erreur de droit, elle concluait également que l'erreur n'excédait pas sa compétence et que, par conséquent, il ne lui revenait pas d'accéder à la demande. Le ministère public décidait ensuite de ne pas interjeter appel de la décision du juge Hamilton, et on a donc terminé ainsi la poursuite au criminel. Toutefois, le Collège des médecins et chirurgiens s'est penché lui aussi sur l'affaire et a choisi à son tour d'agir en envoyant une lettre de réprimande. En mars 1999, la docteure Morrison signait la lettre et admettait ainsi qu'elle avait donné une injection mortelle de chlorure de potassium à son patient. Cette lettre est maintenant portée à son dossier, mais ne devrait pas l'empêcher de pratiquer de quelque façon que ce soit. L'affaire est donc close.
Vous vous demandez peut-être ce que sont devenues du point de vue juridique les recommandations du premier comité sénatorial? Elles ont été suivies dans la mesure où le comité sénatorial ne proposait rien de particulier. L'euthanasie non volontaire demeure toujours une infraction criminelle, tout comme l'euthanasie volontaire; et l'euthanasie non volontaire demeure toujours une infraction au titre des dispositions actuelles du Code criminel sur le meurtre.
Toutefois, les recommandations n'ont pas été suivies dans la mesure où elles devaient être interprétées comme une suggestion de modifier les dispositions sur la détermination de la peine du Code criminel, en vue d'alléger les peines dans les cas où l'euthanasie non volontaire comporte comme élément essentiel le désir de soulager les douleurs de l'autre pour des fins de compassion ou des fins humanitaires. Le Code criminel n'a pas non plus été modifié pour alléger les peines imposées à la suite de l'euthanasie volontaire incluant comme élément essentiel la compassion.
En conclusion, on déclarait en 1995 que l'aide à la mort avait au Canada un statut juridique imprécis et indéfendable. La situation est la même aujourd'hui encore. Il faut non seulement apporter des précisions à la loi, mais aussi réformer le droit en ce sens, tout comme le réclamait le comité sénatorial spécial sur l'euthanasie et l'aide au suicide dans son rapport, «De la vie et de la mort».
Abordons d'abord la nécessité d'éclaircir la situation. L'absence d'un énoncé législatif ou judiciaire clair sur l'abstention et l'interruption de tout traitement de survie et sur la prestation de traitements palliatifs pouvant éventuellement abréger la vie, reconnue par le comité sénatorial, demeure toujours une priorité, car elle entraîne au moins six préjudices distincts.
D'abord, dans le régime actuel, certains patients reçoivent un traitement qu'ils ne souhaitent pas recevoir parce que les soignants ne savent pas s'ils enfreindront le Code criminel en ne faisant pas tout en leur pouvoir pour garder le patient en vie.
En second lieu, les patients au Canada sont traités très différemment d'une région à l'autre du pays, d'une ville à l'autre, et même d'un établissement à l'autre, qu'il s'agisse de les brancher ou non sur un appareil respiratoire, de leur fournir ou non des quantités massives de morphine ou de chlorure de potassium. Qu'ils soient traités ou non, c'est pour eux comme jouer à la loterie, car cela dépend de l'établissement où ils se trouvent ou du soignant qui s'occupe d'eux. Étant donné que la loi est vague, certains soignants ne respecteront aucun refus de traitement de survie. Certains respecteront le refus du patient d'obtenir de la ventilation artificielle, mais pas le refus de l'hydratation et de l'alimentation artificielles. Certains autres soignants respecteront les refus de traitements qui leur viendront d'adultes capables, mais pas ceux de fondés de pouvoir. D'autres encore respecteront les refus de tous, qu'ils viennent de l'adulte capable ou du fondé de pouvoir. Enfin, certains autres soignants respecteront les refus de traitements de patients en phase terminale, mais pas ceux de patients pour qui le pronostic de rétablissement est excellent s'ils reçoivent le traitement.
En troisième lieu, certains patients ne reçoivent pas de traitements adéquats contre la douleur parce que les soignants ne savent pas s'il est illégal ou pas de fournir des analgésiques à des doses ou sous des formes qui pourraient abréger la vie de leurs patients.
En quatrième lieu, les soignants soignent sous la menace de poursuites pour responsabilité légale. Il bien facile pour moi de répondre, à partir de mon bureau, que toute abstention ou interruption de traitement de survie est parfaitement légale au Canada et qu'offrir un traitement pouvant abréger la vie est tout aussi légal au Canada, car je ne risque aucune mise en accusation. Celui qui ne risque pas nécessairement d'être déclaré coupable risque néanmoins d'être mis en accusation, ce qui est très sérieux. Cette situation nuit aux soignants, car elle ajoute beaucoup de stress à leur vie déjà remplie et nuit aux patients, car elle compromet les soins qui leur sont offerts.
En cinquième lieu, la loi se fait sur le dos de personnes vulnérables. Elle se fait sur le dos de personnes qui ont les ressources voulues -- financières, émotives et physiques -- pour contester le système devant les tribunaux, même si ce ne sont pas là les plus puissants. Prenez, par exemple, le fardeau qu'a dû assumer Nancy B., qui était paralysée et qui souffrait du syndrome de Guillain-Barré. Nancy B. voulait qu'on lui retire son respirateur. Pour obtenir cela, elle a dû porter son cas devant les tribunaux et, avec sa famille, endurer tout le débat public qui a entouré son droit de refuser le traitement de survie. Elle a fini par gagner sa cause, et, ce faisant, a aidé à établir le droit au Canada de refuser d'être traité. Toutefois, elle a payé un prix personnel immense. Ceux qui ont plus de ressources de toutes sortes, y compris les législateurs, les organisations des processionnels de la santé, et les individus en santé, devraient faire montre de vision, à mon avis.
Le sixième problème, c'est que le droit évolue en fonction des affaires dont sont saisis les tribunaux, avec toutes les limites que cela implique. Les tribunaux sont mieux en mesure de résoudre les problèmes juridiques que les problèmes moraux, alors que les législateurs sont chargés de résoudre tant les questions morales que les questions juridiques. En outre, les tribunaux sont limités par les faits de l'affaire, la capacité et la position des parties en cause, alors que le législateur, en revanche, peut tenir des consultations plus étendues et élaborer des règles générales.
En 1995, on jugeait nécessaire de préciser si l'aide au suicide était légale afin de mettre fin à ces difficultés. Nous voici en 2000, et cela n'a pas encore été fait.
Pensons maintenant à la nécessité d'une réforme. Tout d'abord, il est de plus en plus manifeste depuis 1995 que les affaires d'aide au suicide et d'euthanasie ne sont pas traitées de façon uniforme. Il n'existe pas de réaction uniforme au Canada aux affaires d'aide au suicide et d'euthanasie. Les dispensateurs de soins de santé de l'Ontario et de la Nouvelle-Écosse peuvent, pour les mêmes actes, être poursuivis pour meurtre en Nouvelle-Écosse ou plaider coupable d'avoir administré un produit dangereux en Ontario. Il semble y avoir là une iniquité patente. Il était et il demeure nécessaire de réformer le droit pour résoudre le manque d'uniformité dans l'application des lois.
Deuxièmement, il existe encore des écarts entre le Code criminel et l'administration de la justice. Dans le Code criminel, l'euthanasie est clairement définie comme un meurtre; et pourtant cet acte est traité au Canada comme un crime de moindre importance. Ou bien l'euthanasie doit entraîner une punition de moins de 25 ans d'emprisonnement, auquel cas il faudrait modifier le Code criminel en conséquence, comme l'avait recommandé le comité du Sénat, ou bien elle mérite un emprisonnement d'au moins 25 ans, auquel cas il faudrait cesser d'accepter des plaidoyers pour réduire les chefs d'accusation. L'approche actuelle, qui consiste à conserver l'euthanasie au rang des homicides dans le Code criminel, à conserver la peine minimale d'emprisonnement à vie qui y est associée, mais à poursuivre les prévenus sous le régime des dispositions relatives à l'homicide involontaire ou à l'administration d'un produit dangereux, est à tout le moins équivoque, sinon hypocrite. Il était nécessaire de réformer le droit en 1995, et ce l'est encore, pour résoudre cette équivoque ou cette hypocrisie.
Troisièmement, dans le régime actuel, nous continuons de manquer à nos devoirs envers les mourants, leurs familles et leurs amis, ainsi qu'envers les dispensateurs des soins de santé. Des gens meurent dans des souffrances intolérables. D'autres essaient de se suicider, manquent leur coup et se retrouvent dans un état pire qu'avant leur tentative. D'autres encore prennent des mesures désespérées pour aider leurs patients ou leurs proches et se trouvent dans des situations qui les rendent passibles d'emprisonnement à vie sans possibilité de libération conditionnelle pendant 25 ans. Certains refusent des traitements de survie par crainte qu'en les acceptant ils ne se retrouvent dans un état où la vie n'en vaut plus la peine et qu'il ne leur soit interdit de mourir.
En 1995, j'étais d'accord avec la conclusion du comité du Sénat, selon qui il était nécessaire de préciser et de réformer le droit. Cinq ans plus tard, je dois malheureusement vous dire qu'il est toujours nécessaire de préciser et de réformer le droit. Je soumets donc que les recommandations unanimes du comité du Sénat devraient être réitérées et qu'il faudrait exhorter les personnes qui ont le pouvoir de les mettre en oeuvre à le faire. C'est leur devoir envers tous les Canadiens.
M. Barney Sneiderman, professeur faculté de droit, Université du Manitoba: Après l'excellent tour d'horizon de Mme Downie, je m'abstiendrai de lire mes observations préliminaires et je me contenterai d'ajouter des commentaires aux deux affaires qu'elle a mentionnées -- l'affaire Doerksen de Winnipeg et l'affaire dans laquelle était impliqué la docteure Morrison. Je mentionnerai toutefois un certain nombre d'autres affaires pertinentes.
En 1997, la Cour d'appel du Manitoba a rendu une décision dans l'affaire intitulée L. et H. Je n'entrerai pas dans les détails de cette affaire. Si cela vous intéresse, je pourrai vous en dire davantage plus tard. La Cour d'appel a décidé que seul le médecin traitant peut décider d'exécuter une ordonnance de non-réanimation. La cour a établi une distinction entre le traitement et le non-traitement. D'après les juges, la seule raison pour laquelle il est nécessaire d'obtenir le consentement au traitement, c'est que pour traiter le patient il faut le toucher. Toucher le patient sans son consentement est un acte défini comme «coups et blessures» en droit civil et comme «voies de fait» en droit pénal. Dans le cas d'une ordonnance de non-réanimation, on ne touche pas le patient, et il n'est donc pas nécessaire de ce fait d'obtenir le consentement du patient ou de son fondé de pouvoir. C'est une simple décision médicale.
Je veux décrire très brièvement l'affaire Sawatsky c. Riverview Health Centre, de Winnipeg. Un patient débilité et incapable de 79 ans était soigné dans un établissement de soins de longue durée. Sa femme s'est opposée à ce qu'une ordonnance de non- réanimation soit déposée dans son dossier. On a réussi à persuader un juge du Banc de la Reine de surseoir à l'ordonnance de façon à ce que des médecins de l'extérieur du centre de Riverview puissent examiner si l'ordonnance était raisonnable du point de vue médical. Le patient a été examiné par deux médecins indépendants qui se sont dits d'accord avec l'ordonnance. Toutefois, la cour n'a pas été saisie de nouveau de l'affaire parce que l'état du patient s'est empiré et qu'il est mort.
Dans l'affaire Sawatsky, il s'agissait d'une insistance pour obtenir le traitement, cas que le droit n'a pas encore reconnu. Ce qu'il faut déterminer, c'est si la reconnaissance en droit du refus du traitement devrait comprendre également le droit inverse, c'est-à-dire le droit du patient ou de sa famille d'exiger le traitement, même si le médecin estime que ce n'est pas raisonnable du point de vue médical et que le traitement ne présente aucun avantage pour le patient.
Il faut également déterminer quand le traitement est raisonnable du point de vue médical, ce qui nous entraîne dans le chapitre fort complexe de l'acharnement médical. Ce qui rend la question de l'acharnement médical encore plus complexe, c'est qu'il est impossible de la tenir à l'écart de la question du rationnement des soins de santé.
L'affaire Sawatsky signale l'inquiétude du public envers le traitement excessif et le manque de traitement. D'une part, il existe la possibilité que la technologie médicale prolonge l'agonie de façon injustifiée; cette inquiétude explique la création des directives en matière de soins de santé. Par contre, il existe une crainte légitime que des traitements nécessaires ne soient pas offerts par notre régime de soins de santé assiégé et tant décrié. Pour la plupart, les journalistes ont dépeint l'affaire Sawatsky comme un combat entre David et Goliath -- celui d'une épouse âgée et dévouée qui essayait de tirer son mari des griffes d'un système médical dépersonnalisé. Par exemple, on pouvait lire en première page du Globe and Mail le titre suivant: «Les médecins ne sauveront pas le patient en dépit des exhortations de son épouse.» Dans leurs lettres aux journaux et leurs commentaires aux tribunes radiophoniques, des Manitobains inquiets se sont dits d'accord avec Mme Sawatsky lorsqu'elle affirmait, au sujet de son mari: «Ils l'ont abandonné. Plus on vieillit, plus on devient vulnérable et plus on devient inutile.»
Je ne dis certes pas qu'il faut toujours prolonger la vie des patients. Je suis de ceux qui estimaient justifiée l'ordonnance de non-réanimation dans l'affaire Sawatsky. Même s'il est difficile, sinon impossible, de définir ce qu'est l'acharnement thérapeutique dans le contexte d'une politique générale, il n'en reste pas moins qu'un grand nombre de patients meurent chaque jour dans les hôpitaux canadiens parce que leurs médecins et les membres de leurs familles reconnaissent que l'agonie ne devrait pas être prolongée du simple fait de l'existence de la technologie médicale.
L'acharnement thérapeutique pourrait, dans une autre ère, nous entraîner dans un cauchemar orwellien. Dans le contexte médical, il s'agit pour moi d'acharnement avec un A majuscule -- un grand sujet d'inquiétude.
Permettez-moi maintenant de passer à autre chose. Le rapport du comité, publié en 1995, révélait un manque certain de consensus sur la légalisation de l'euthanasie et de l'aide au suicide. Il y avait toutefois unanimité sur une question: l'euthanasie devrait être considérée comme un homicide coupable réduit et ne devrait pas entraîner de peine minimum obligatoire. Le message s'est peut-être rendu jusqu'au Parlement, mais au cours des cinq années ou presque qui se sont écoulées il n'a donné aucun indice de sa volonté d'agir dans ce sens.
Un peu plus tard cette année, la Cour suprême entendra l'appel de Robert Latimer au sujet de sa peine minimum obligatoire, c'est-à-dire l'emprisonnement à vie sans possibilité de libération conditionnelle pendant 10 ans. On a donné qualité d'intervenant à des groupes de personnes handicapées qui plaideront sans doute de façon passionnée pour que la sentence soit maintenue. Je sais que le meurtre de Tracey Latimer a soulevé beaucoup d'angoisse et d'indignation chez les personnes handicapées. Quand je parle des «personnes handicapées», j'entends par là les personnes handicapées elles-mêmes et celles qui leur dispensent des soins.
Je ne crois pas que Robert Latimer soit leur ennemi. S'il n'avait pas été convaincu de la valeur inhérente de sa fille en tant qu'être humain, il ne lui aurait certes pas consacré 12 ans de soins attentifs et de dévouement. Ceux qui le condamnent amèrement ne reconnaissent pas son mérite de ne pas avoir opté pour la facilité, de ne pas avoir placé sa fille en établissement, non plus que son mérite et celui de sa femme d'avoir enduré pour leur fille toutes ces années de patience incroyable, de travail incessant et de peine.
L'affaire Latimer a un aspect dont on n'a pas tenu compte. Les 12 citoyens moyens qui ont rempli consciencieusement leur devoir à titre de jurés dans le procès de 1997 ont condamné Latimer du meurtre de sa fille handicapée, Tracey. Après tout, il n'a présenté aucune défense reconnue par les tribunaux, et le jury était consciencieux. Toutefois, après avoir rendu leur verdict, ces citoyens ont été horrifiés d'entendre le juge décréter que la peine minimale d'emprisonnement serait de 10 ans.
Comme vous le savez, le jury a courageusement et unanimement recommandé que Latimer ne purge qu'une année d'incarcération. Le juge au procès, le juge Noble, a réagi en imposant une peine de deux ans, dont un an seulement en prison. Comme Mme Downie vous l'a dit, la Cour d'appel de la Saskatchewan a renversé cette décision et imposé la peine minimale de 10 ans.
Les jurés ont pu juger de l'homme. Ils étaient sur place, au procès, ils ont entendu tous les témoignages et ont conclu qu'une peine de 10 ans était exagérée. Ils estimaient collectivement que dans ce cas le meurtre pouvait être traité de façon plus clémente et en sont arrivés à la même conclusion que votre comité, c'est-à-dire que l'euthanasie n'est pas un meurtre ordinaire. Si leur désarroi a été aussi grand, au prononcé d'une peine minimale de 10 ans, c'est qu'ils avaient présumé, peut-être à tort, que le droit était suffisamment éclairé pour que la peine soit proportionnelle à l'affaire.
Si la Cour suprême maintient la peine, que penseront-ils plus tard de leur expérience de juré? Ils ressentiront de l'amertume et un sentiment d'indignation, je suppose.
Le droit place entre leurs mains le sort d'un homme, mais refuse de leur dire quel sera le résultat d'un verdict de culpabilité. La Cour d'appel n'a pas tenu compte de la recommandation du jury lorsqu'elle a renversé la peine imposée par le juge Noble. Dans les faits, elle a dit aux jurés de se mêler de leurs affaires. Après tout, n'est-ce pas ainsi que les choses se passent habituellement? Le rôle du jury est simplement de décider de la culpabilité ou de l'innocence; il s'occupe du crime, mais non du châtiment. C'est bien beau lorsque le crime dont est saisi le jury entraîne un vaste choix de sanctions et aucune incarcération obligatoire; mais ce n'est pas le cas du meurtre. D'après la loi, seule Tracey Latimer a été une victime dans cette affaire. On pourrait croire également que les jurés ont aussi été des victimes. Les jurés sont censés exprimer le sentiment de la société; lorsqu'ils l'ont fait, ils ont lancé un message dont le droit n'a pas tenu compte, et leur conscience est maintenant alourdie de savoir que leur verdict a entraîné un châtiment qu'ils estiment exagéré. Quel message cela donne-t-il à tous les citoyens qui pourraient être un jour appelés à être jurés?
Il y a également d'autres victimes: Laura Latimer et ses trois enfants. Quelques jours seulement après le verdict, mais avant le prononcé remarquable de la peine par le juge Noble, trois des jurés interviewés par la SRC ont exprimé leur désarroi à l'idée d'une peine de 10 ans. Deux d'entre eux ont parlé de la famille de Latimer. L'un a dit: «Il a chez lui de jeunes enfants qui ont besoin de lui.» L'autre a dit: «Son incarcération ne sera utile ni à lui ni à sa famille. Il vaudrait mieux qu'il soit chez lui, à prendre soin de sa famille.»
Certains interprètent la peine imposée par le juge Noble comme un indice de ce que tuer une personne handicapée est un acte criminel moins grave que le meurtre d'une personne non handicapée. Ce n'était pas son message. Il a pris la peine d'expliquer que d'après les preuves il était clair que Latimer a mis fin à la vie de sa fille parce qu'il ne connaissait aucun autre moyen de mettre fin à sa souffrance à elle et à sa peine à lui; il ne l'a pas fait parce qu'il la considérait comme un être humain moins important. Le principe de la dénonciation doit être pris en compte dans l'établissement de la peine, mais pas dans un cas de ce genre. Ceux qui insistent sur ce message, aussi mal adressé qu'il soit dans ce cas-ci, devraient savoir qu'il bouleverse cette famille; et n'oubliez pas que c'est de la famille de Tracey que je parle.
Depuis la mort de Tracey, en 1993, cette famille a vécu dans le stress le plus incroyable; les trois autres enfants ont vécu toute leur vie dans la crainte de perdre leur père. S'ils ne sont pas déjà marqués à vie, ils le seront sûrement si la peine minimale de 10 ans est maintenue.
À mon avis, cette peine est si disproportionnée par rapport au crime qu'elle réclame un allégement, surtout compte tenu des peines maximales moins importantes qu'on peut imposer aux criminels les plus endurcis qui commettent les crimes les plus haineux, abstraction faite du meurtre. En réclamant une peine d'un an, le jury manifestait, en fait, sa compréhension intuitive du concept de la peine cruelle et inhabituelle. Il disait qu'il n'est pas suffisant de châtier le crime, que le châtiment doit également correspondre au criminel. Une majorité appréciable de Canadiens partageaient ce sentiment, apparemment, puisque, d'après un récent sondage Angus Reid, 73 p. 100 des répondants ont appuyé l'affirmation voulant que Latimer avait agi par compassion et devrait se voir imposer une peine plus clémente, comparativement à 23 p. 100 contre.
Cinq ans plus tard, le Parlement n'a donné aucun indice de son intention d'adopter la proposition du comité au sujet de l'euthanasie. De toute façon, j'estime qu'il est évident qu'un projet de loi sur l'euthanasie soulèverait un tollé de protestations chez le public et des discours passionnés qui rendraient très difficile un débat calme et raisonné.
Mon expérience personnelle m'a montré que si vous défendez l'euthanasie devant un auditoire qui contient des personnes handicapées, vous soulèverez un sentiment d'indignation, et votre opinion sera comparée au programme nazi d'euthanasie, à une invitation au meurtre en masse des personnes handicapées par leurs dispensateurs de soins qui, soi-disant, trouveront des jurés sympathiques à leur cause et prêts à minimiser la valeur de la vie des handicapés en appuyant avidement une défense pour euthanasie. On vous dira qu'il ne s'agit pas d'euthanasie, mais bien du meurtre d'une personne à charge handicapée, pour accommoder le dispensateur de soins.
Évidemment, on nous dit toujours que les handicapés s'opposent à la clémence envers Robert Latimer. J'ai toutefois trois amis handicapés qui sont du même avis que moi dans cette affaire. Par conséquent, ce que nous entendons, ce n'est pas nécessairement l'opinion des personnes handicapées. Pourquoi celles-ci n'auraient-elles qu'une seule opinion sur un sujet alors qu'il existe probablement des opinions diverses dans tous les autres groupes? Tout ce que nous savons, c'est que ce que nous entendons, c'est l'avis de ceux qui se prétendent les porte-parole de cette communauté. Je ne dis pas non plus que seules les personnes handicapées s'opposent à la clémence pour Robert Latimer, mais c'est néanmoins de cette communauté que sont issues ses critiques les plus passionnés et les plus virulents.
Mme Downie a parlé de l'affaire Doerksen, que je connais très bien. Il s'agit d'une affaire d'aide au suicide. Pour un avocat de la défense, c'est une affaire en or. Lorsque sa femme est décédée, il y a deux ans, Bert Doerksen avait 79 ans et sa femme, 78. Elle souffrait d'un certain nombre de maladies graves, entre autres de douleurs incurables, que la clinique de soins palliatifs de Winnipeg était incapable de soulager. Elle prenait des narcotiques depuis tant d'années qu'ils ne faisaient plus aucun effet. Les Doerksen étaient mariés depuis 59 ans. Ils s'étaient fréquentés pendant trois ans, alors qu'ils n'étaient qu'adolescents. Lorsqu'ils se sont mariés, il avait 17 ans et elle en avait 16. Soixante-deux ans plus tard, elle mourait dans le garage de la famille d'un empoisonnement au monoxyde de carbone, et il était accusé de l'avoir aidée à se suicider. J'ai rencontré Bert Doerksen, qui est un homme remarquable et extrêmement intelligent. Il n'est plus le même depuis la mort de sa femme -- elle lui manque terriblement. Il souffre d'un cancer de la moelle osseuse et de l'oesophage. Le procureur de la Couronne a déclaré que s'il plaidait coupable il ne serait pas incarcéré. Bert Doerksen refuse de plaider coupable. Il dit qu'il est né avec une conscience nette et qu'il prévoit mourir de la même façon. Je soupçonne que s'il refuse de plaider coupable, c'est parce qu'il devrait admettre qu'il a commis un acte mauvais et qu'il n'est pas prêt à l'accepter.
D'après le ministère du Procureur général, des protestations se seraient élevées contre le retrait de l'accusation contre Bert Doerksen. Ces protestations viendraient d'handicapés. La Couronne refuse de retirer cette accusation.
J'ai écrit un article paru en regard de la page éditoriale du Winnipeg Free Press il y a quelques mois dans lequel je citais les lignes directrices en matière de poursuites au sujet des conditions de sursis de procédure. Je signalais qu'environ six des huit critères s'appliquaient à la cause Doerksen. On ne veut pas retirer l'accusation.
J'ai entendu dire que la Couronne espère qu'il va mourir du cancer. Cela lui éviterait de lui faire subir un procès.
J'ai dit que je ne crois pas que la proposition du comité concernant le meurtre par compassion ait de grandes chances d'être adoptée. Il y a une autre façon de procéder, qui serait de modifier la détermination de la peine minimum obligatoire pour meurtre par un système de détermination de la peine par présomption tel que proposé dans un article récent publié dans le Alberta Law Review à propos de la cause Latimer. L'idée est de maintenir des minimums obligatoires, mais de modifier le Code criminel pour permettre à un accusé de prouver, par preuve péremptoire, pourquoi il devrait être relevé de cette peine minimum. Ce serait la façon d'atténuer la rigidité de la loi pour un véritable cas de meurtre par compassion.
Nous pourrions en fait faire beaucoup si nous avions une façon de contourner la règle stricte selon laquelle une condamnation pour meurtre entraîne automatiquement une peine minimum obligatoire de 10 ans. Il y a des groupes qui préconisent l'abrogation du motif de défense de provocation pour une accusation de meurtre. S'il était abrogé, je prédis qu'un jury acquittera un prévenu qui devrait être condamné ou qu'un jury condamnera et que cela suscitera de grandes protestations contre la sévérité d'une peine de 10 ans. Si nous avions quelque chose comme un système de détermination de la peine par présomption, nous pourrions alors abolir la défense de provocation. Certes, du point de vue d'un accusé, ce qui importe, n'est pas l'étiquette que l'on donne au crime, c'est la peine.
Dans le domaine du syndrome de la femme battue et de l'autodéfense, c'est la même chose. On pourrait peut-être dire: «Ma foi, il ne s'agit vraiment pas d'autodéfense. Cela ne correspond pas aux paramètres de la provocation. Toutefois, si nous avions un moyen de contourner la peine minimum obligatoire, nous pourrions parvenir à un résultat plus acceptable.»
Le sénateur Beaudoin: Vous dites que l'on n'a pas modifié le Code criminel depuis notre rapport. Je vous signalerai qu'il y a toutefois eu certaines modifications. Pour ce qui est du Code criminel, j'ai toujours pensé que nous devrions au moins mettre en oeuvre la partie de notre rapport sur laquelle nous étions tous unanimes. Il s'agissait essentiellement des soins palliatifs, de l'interruption du maintien des fonctions vitales et du refus de traitement. Je n'y verrais pas d'inconvénient. Nous avons beaucoup à faire dans ce domaine.
Lorsqu'une question entraîne des amendements au Code criminel, il n'y a pas de problème, parce que nous avons toute compétence en la matière. Toutefois, les soins palliatifs relèvent en partie de la compétence provinciale. Dans bien des cas, cela relève entièrement de la compétence provinciale. Néanmoins, il y a l'évolution de la jurisprudence. Il est vrai que le Code criminel n'a pas été modifié, mais il y a certaines causes qui peuvent changer la loi de la façon dont elle est interprétée. S'agit-il de causes repères qui mèneront à modifier le Code criminel?
Mme Downie: Pour ce qui est de l'aide à la mort et des recommandations unanimes, en particulier pour ce qui est du refus, de l'interruption et du traitement palliatif risquant de raccourcir la vie, la cause la plus importante fut la cause Rodriguez un cas de suicide assisté. Cela comportait des passages importants sur le refus, l'interruption et le traitement palliatif qui abrège la vie. C'est sorti avant le rapport. Aussi, la loi n'a-t-elle pas changé depuis le rapport du fait de Rodriguez. Peut-être que l'on n'a pas été suffisamment sensibilisé à ce que comportait Rodriguez, parce qu'il est dit clairement que des adultes compétents ont le droit de refuser un traitement par maintien des fonctions vitales, quel qu'il soit. On déclare qu'il y a une différence entre l'augmentation constante des doses de morphine et une injection de chlorure de potassium. C'est une cause très importante pour cela. Toutefois, le problème est qu'il s'agissait d'un cas d'aide au suicide; il ne s'agissait pas de refuser un traitement ni d'interrompre le maintien des fonctions vitales. Cela ne touche pas aux autres zones grises du refus et de l'interruption.
On peut dire que l'on n'a pas besoin de loi à propos du refus et de l'interruption, car voilà ce qu'il faut dans un certain passage de la décision concernant Rodriguez. Je ne suis pas d'accord, parce qu'il faut quelque chose de clair, et non pas un passage obscur enterré dans une décision qui ne porte pas sur le refus ou l'interruption. La majorité des médecins ne sont pas au courant de ce paragraphe enfoui dans la décision Rodriguez.
Surtout, il y a d'autres aspects du refus et l'interruption que cette cause ne touche absolument pas, et c'est pourquoi il nous faut un texte législatif. Nous n'avons pas de causes nous permettant d'énoncer clairement les choses en ce qui concerne les mineurs mûrs qui refusent un traitement ou ceux qui en exigent un plutôt que de le refuser, ou des adultes incapables de décision sans directives préalables. Il n'en est pas question dans Rodriguez ni de façon convaincante dans l'une des autres causes que nous avons vues. Après Rodriguez, les causes sont moins importantes. Il nous faut soit un texte législatif clair, soit une décision de la cour sur une série de cas semblables.
Voilà les deux voies qui s'offrent à nous pour obtenir la clarté voulue sur la légalité de toute la série de questions qui se posent dans le contexte du refus, de l'interruption ou de traitements palliatifs pouvant abréger la vie.
Le sénateur Beaudoin: Je suis bien d'accord avec vous pour dire qu'il nous faut modifier le Code criminel. Pour ce qui est de l'interruption et du refus de traitement, la jurisprudence n'est peut-être pas assez claire, et il nous faut envisager certains amendements au Code criminel. Cela servirait les familles, les médecins, le personnel infirmier, et cetera.
Comme vous le disiez, la cause Rodriguez traitait essentiellement du suicide assisté et non pas du refus ou de l'interruption. Cela n'entrait certainement pas dans la décision.
Mme Downie: C'était une observation incidente.
Le sénateur Beaudoin: C'était une décision cinq à quatre. Nous considérons que la cause Rodriguez est claire pour ce qui est du suicide assisté, et c'est tout ce que nous disons, rien de plus, rien de moins. Pour les deux autres questions, l'interruption et le refus, il reste beaucoup à faire.
J'aimerais savoir si vous considérez ou non que la jurisprudence a jeté quelque lumière sur cette question, parce que vous avez analysé un certain nombre de cas depuis 1995, et il est évident que toutes les informations que vous pourriez nous donner pourraient nous aider à prendre nos décisions.
Mme Downie: Prenons un ou deux exemples de zones grises concernant le refus et l'interruption et considérons les cas pertinents. Un de ces exemples porte sur des mineurs mûrs. Comme vous l'avez vous-même reconnu, la question n'est pas claire. Vous disiez bien que la compétence relève des provinces, si bien que nous avons dans certaines provinces une législation qui précise que le refus de traitement par des mineurs doit être respecté même s'il y a une certaine confusion dans la loi. Parfois il est stipulé que c'est tout refus, si le mineur est capable de prendre une décision, aussi capable qu'un adulte; dans d'autres cas, il est stipulé que cela ne s'applique que s'il est capable de prendre une décision et prend cette décision dans son propre intérêt.
Ce n'est pas plus clair en jurisprudence. Nous avons par exemple deux cas importants en Colombie-Britannique. Dans l'un, le juge dit que si on est mineur, mais que l'on comprend la nature et les conséquences de la décision à prendre, le refus doit être respecté, sauf que la cour a toujours compétence parens patriae, c'est-à-dire qu'elle peut intervenir si elle estime que le mineur prend une mauvaise décision. Cela revient à dire que la règle du mineur mûr est limitée. Une autre décision a été rendue récemment par la Cour d'appel. Un juge a déclaré dans ce cas qu'il s'agissait de la règle du mineur mûr sans limite, que l'on ne pouvait parler de son intérêt personnel -- que cela ne s'applique pas aux adultes et qu'ainsi cela ne doit pas s'appliquer aux mineurs capables de prendre une décision. Un autre juge de la même cause a par contre dit qu'il fallait conserver cette limite, de sorte qu'un mineur doit être capable non seulement de prendre une décision, mais aussi de prendre une décision qui est dans son intérêt personnel.
Je dirais que dans le contexte de mineurs mûrs la jurisprudence ne règle pas du tout la question. Elle l'embrouille plutôt. Du moins la question a-t-elle été examinée -- elle ne l'avait pas été par le passé -- mais nous n'avons pas de solution claire.
De même, pour ce qui est du refus unilatéral et de l'interruption unilatérale, nous n'avons pas de directives suffisamment claires de la jurisprudence. Il n'y a aucune décision qui ait réglé le problème. Il n'y a rien qui dégage les législateurs de cette responsabilité, car il n'y a pas eu de réactions aux recommandations unanimes du comité spécial du Sénat sur l'euthanasie et le suicide assisté. La jurisprudence aurait pu régler la question, mais ne l'a pas fait. Cela va venir, et si les législateurs n'agissent pas je pense que d'ici à cinq ans nous aurons quelque chose de la Cour suprême au sujet de la question des mineurs mûrs et de l'interruption unilatérale et du refus unilatéral. Elle sera obligée de trancher parce qu'elle sera saisie de certaines causes et qu'elle tranchera petit à petit sur ces questions. Rodriguez porte sur un point particulier, et nous avons maintenant un énoncé sur les adultes capables de prendre une décision. Nancy B. signifie quelque chose. Toutes les causes reprendront petit à petit toutes les petites zones grises concernant le refus et l'interruption.
Ainsi, dans 10 ou 20 ans, je pourrais peut-être vous dire que c'est clair et que l'on a un tableau complet de la question. Je puis vous dire ceci à la suite du jugement rendu dans cette cause; cela à la suite du jugement rendu dans cette autre cause. Qu'en coûtera-t-il, toutefois, à tous ces gens qui devront s'en remettre aux tribunaux plutôt que de devoir régler ces questions dans le contexte d'audiences qui couvrent l'ensemble du sujet? D'autres sortes de groupes pourraient être entendus pour mettre au point les dispositions législatives voulues alors que le recours à la jurisprudence présente de nombreuses limites. C'est possible, mais cela prendra beaucoup de temps et coûtera très cher. Nous n'avons pas pour nous aider les causes que nous aurions espéré avoir après cinq ans.
Le sénateur Beaudoin: Je suis tout à fait d'accord. Nous ne devrions pas laisser cela aux tribunaux. Nous devons accepter nos responsabilités et présenter et adopter un projet de loi.
M. Sneiderman: La cause de Nancy B. est une décision d'un juge de première instance, mais elle a eu une incidence considérable. Ceux qui ont dû comprendre le message sont les médecins. Le message qu'ils doivent comprendre, c'est qu'un patient qui a les compétences mentales pour prendre une décision a le droit de refuser un traitement même si, de l'avis du médecin, ce traitement lui redonnerait une qualité de vie que le médecin juge tolérable.
Je participe parfois à des discussions avec des médecins et des étudiants en médecine. Ils connaissent tous cette cause. Je me rappelle avoir assisté à un séminaire avec des étudiants et résidents en médecine où l'on a fait venir une infirmière sur une civière qui jouait le rôle de Nancy B., et chacun des résidents devait s'approcher d'elle et entamer une conversation. «Nancy B.» commençait la conversation en disant qu'il était temps de retirer l'appareil respiratoire et de la laisser mourir, et la discussion commençait entre la patiente et l'étudiant. Une des étudiantes lui a dit qu'elle ne pourrait se plier à sa demande. Elle a expliqué que, du fait de ses convictions religieuses, il lui était simplement impossible de satisfaire à la demande de la patiente. J'ai alors pris la parole. Je lui ai dit: «Il y avait une pancarte sur le bureau de Harry Truman qui disait: Si vous ne supportez pas la chaleur, sortez de la cuisine. Vous allez être médecin, et vos principes religieux sont une question entre vous et votre Dieu. Si vous avez l'impression que vous ne pouvez respecter sa demande, vous êtes tenue de la confier à un autre médecin, mais vous devez comprendre que c'est son droit.» Elle ne m'a pas répondu. Elle avait l'air assez mécontente. Puis un certain nombre de ses confrères ont fait des commentaires appuyant ce que j'avais dit. Ils ont déclaré: «Écoute, tu as entendu. Elle t'a dit de débrancher l'appareil respiratoire, et elle est capable de prendre cette décision. Tu peux lui parler, tu peux certainement essayer de la persuader d'autre chose, mais tu ne peux la forcer, car, en définitive, c'est à elle de décider.» Cette décision d'un juge de première instance a eu une incidence considérable.
[Français]
Le sénateur Pépin: J'étais infirmière à l'époque où l'on devait refuser de donner une injection de morphine à un patient très souffrant si on savait, étant donné sa faiblesse, qu'il pouvait en mourir. Plus tard, la loi et la religion catholique ont changé, ce qui a permis aux infirmières de le faire.
Mme Downie vous dites qu'un mineur peut être considéré d'âge adulte lorsqu'il comprend très bien la loi et que sa demande est claire. Par contre, la cour ou un médecin peut décider du contraire si on ne peut pas répondre à sa demande. Prenons l'exemple d'un mineur de 15 ans atteint de leucémie, trop souffrant et qui ne veut pas poursuivre les traitements. Est-ce qu'un médecin, la cour ou un parent pourrait s'opposer à sa demande? Cela n'est pas clair pour moi.
Il y a quelques années l'âge de la majorité, pour les traitements médicaux, variait d'une province à l'autre, est-ce encore le cas? Le Québec était la province où les majeurs étaient les plus jeunes à travers le Canada. À Terre-Neuve, l'âge de la majorité était de 19 ans alors qu'au Québec l'âge requis pour obtenir des moyens de contraception était de 14 ou 15 ans.
[Traduction]
Mme Downie: Tout d'abord, l'âge du mineur varie effectivement d'une province à l'autre. Il existe dans chaque province une loi sur l'âge de la majorité, et elle s'applique à partir de l'âge de 18, 19 ans et plus. Au Québec il existe une loi qui régit le consentement des mineurs et le refus de traitement à partir de l'âge de 14 ans; et cette loi est en vigueur dans cette province depuis plus longtemps que dans n'importe quelle autre province ayant des lois similaires. On constate donc ce genre de situation assez étrange.
Le sénateur Pépin: Un enfant de 14 ans pourrait-il être autorisé à faire quelque chose comparativement à un jeune qui est considéré comme un mineur à l'âge de 18 ans dans une autre province?
Mme Downie: Oui, tout à fait. Il y a également le problème du jeune qui a 17 ans et 364 jours et qui pourtant ne peut pas donner son consentement. Cependant, deux jours plus tard, il le peut. Qu'arrive-t-il à la compétence d'une personne dans une période de 48 heures? C'est toute l'absurdité de lier le consentement à l'âge.
En common law, on ne voit plus les choses de cette façon. On reconnaît qu'il doit s'agir de la compétence et non de l'âge, et qu'on doit administrer un test de compétence à chaque mineur comme on le fait pour chaque adulte. Si vous constatez que quelqu'un qui n'a pas encore atteint l'âge de la majorité est capable de comprendre la nature et les conséquences de la décision, alors ce devrait être à cette personne de prendre la décision. C'est le début de la règle du mineur mûr dont fait état la législation de certaines provinces, mais pas de toutes les provinces. La règle n'est pas claire, car dans certains endroits il s'agit d'une règle illimitée et dans d'autres la décision doit être prise «dans l'intérêt véritable» de la personne. On peut imaginer une situation où un jeune de 15 ans est atteint de leucémie en phase terminale, un jeune dont les jours sont clairement comptés. Le pronostic pour cet adolescent est sombre, bien qu'il ait suivi toutes sortes de traitements de chimiothérapie. Cependant, le mineur en question comprend la situation et dit: «C'est assez, je refuse de continuer.» Les juges peuvent décider -- et nous avons une trilogie de cas d'adolescents qui ont refusé le traitement de maintien en vie: «Absolument. Oui. Votre refus doit être respecté.» Dans chacun de ces cas, les juges comprennent la décision et la reconnaissent. S'ils se mettent à la place du mineur, ils se disent: «C'est ce que je ferais.» À leur avis, il s'agit d'une décision raisonnable. La question qui se pose est la suivante: que se passe-t-il lorsque le mineur prend une décision que les juges ne considèrent pas comme raisonnable? C'est là qu'on a tendance à accoler cette notion «d'intérêt véritable» à la règle du mineur mûr. Cela est dangereux parce qu'on se trouve alors à évaluer la qualité du jugement d'une personne. Nous ne le faisons pas dans le cas des adultes, alors pourquoi le faisons-nous dans le cas des adolescents de 17 ans? Pendant 364 jours de l'année, ils doivent prendre uniquement la bonne décision, mais les adultes peuvent prendre les décisions les plus ridicules du monde, et nous n'interviendrons pas. Il serait intéressant de voir ce qui se passerait si un juge n'appuyait pas la décision d'un jeune de 15 ans qui refuse un traitement. Le juge peut considérer que ce n'est pas une bonne décision. Si un cas de ce genre devait être porté devant la Cour suprême, nous obtiendrions une réponse à cette question de mineur mûr.
M. Sneiderman: Il ne faut pas oublier qu'historiquement la règle du mineur mûr s'est développée dans le cas de mineurs voulant obtenir un traitement non seulement pour des maladies transmises sexuellement, mais aussi pour la planification des naissances. L'accent ne portait pas tant sur le processus de prise de décisions du mineur que sur le fait que le traitement demandé servait clairement l'intérêt véritable du mineur. L'expression «mineur mûr» désigne la compétence du mineur. Nous n'avons pas de définition juridique claire de la compétence mentale, et nous n'en aurons probablement jamais.
Il ne faut pas non plus oublier que les décisions prises par des adolescents ne sont pas nécessairement les mêmes que les décisions prises par des adultes. Il y a eu le cas en Saskatchewan d'un jeune garçon de 12 ans atteint du cancer. Son père refusait de consentir au traitement recommandé par les médecins, qui comportait l'amputation d'une partie de sa jambe. L'enfant a exprimé ses propres convictions, à savoir qu'il était d'accord avec son père. L'affaire a suscité l'intérêt de partisans des deux camps.
Nous savons que les adolescents ont tendance à être influencés davantage par leurs pairs et par leurs parents que par des adultes. Nous savons aussi que les adolescents sont souvent plus préoccupés par leur apparence physique que ne le sont les adultes. Je suis au courant d'un cas à Winnipeg où une jeune fille de 16 ans a refusé de consentir à la chimiothérapie parce que ce traitement lui ferait perdre ses cheveux. Elle a insisté sur le fait qu'elle préférait mourir que perdre ses cheveux. Sa mère lui a dit: «Nous t'achèterons une perruque.» La jeune fille a répondu: «Ce n'est pas la même chose!» Elle a toutefois subi des traitements de chimiothérapie, et il n'a pas été nécessaire d'aller devant les tribunaux. On lui a simplement dit que le traitement lui serait administré, qu'elle le veuille ou non.
Il y a aussi la question des conséquences à court terme par rapport aux conséquences à long terme parce que les adolescents sont souvent plus préoccupés par le court terme que par le long terme.
C'est une question complexe. Nous pouvons dire que si le mineur est apte à décider, alors il doit prendre la décision, car si nous laissons le mineur décider lorsque nous, les adultes, convenons que la décision est dans l'intérêt véritable du mineur, nous nous trouvons alors à bafouer la règle. La question demeure: quand le mineur est-il apte à décider? Comme Mme Downie l'a indiqué, les cas où une décision a été rendue étaient tous des cas où les pronostics étaient plutôt sombres: donc il était facile de trancher. C'est le jeu des probabilités. Si les témoins médicaux établissent que même avec un traitement agressif les chances de s'en sortir sont de 10 ou 20 p. 100, vous devez évaluer si cela en vaut la peine. Comme Mme Downie l'a souligné, vous êtes le juge. Vous vous mettez à la place du mineur et vous vous dites: «Je prendrais la même décision que celle prise par le mineur.» Nous n'avons pas encore été saisis d'un cas où le pronostic de rétablissement serait excellent, mais où le mineur refuserait des soins visant à prolonger sa vie.
Le sénateur Pépin: L'autre question concerne les étudiants en médecine. Vous nous avez parlé d'une étudiante en médecine qui a refusé d'administrer un traitement à cause de ses croyances religieuses.
M. Sneiderman: C'était une résidente.
Le sénateur Pépin: C'était une résidente. À l'heure actuelle, les étudiants en médecine et les infirmières exercent des pressions pour être transférés d'un département à un autre parce que, par exemple, ils peuvent se trouver à travailler dans un département où ils doivent aider à pratiquer des avortements, et ils ne peuvent pas le faire. Je crois comprendre que les pressions exercées sont assez fortes.
Il y a longtemps que je n'ai pas travaillé dans un hôpital, mais je me souviens de l'impact des discussions concernant le contrôle des naissances et de la persuasion dont il a fallu faire preuve avant que les infirmières coopèrent. Bien entendu, cet impact n'est pas comparable à ce dont nous discutons aujourd'hui.
Quelles sont les tendances manifestées par les jeunes étudiants en médecine?
M. Sneiderman: Je ne suis pas vraiment en mesure de vous le dire, mais je peux vous parler des étudiants en médecine du Manitoba.
Le sénateur Pépin: Sont-ils plus disposés à accepter ce que dit le patient et à aider le patient?
M. Sneiderman: Je pense que les nouvelles générations d'étudiants en médecine et de médecins sont plus respectueuses des droits de leurs patients que leurs prédécesseurs, et ce, pour deux raisons: tout d'abord parce qu'ils reconnaissent concrètement le principe de l'autonomie du patient, et deuxièmement parce qu'ils craignent d'être poursuivis s'ils ne suivent pas les instructions du patient. Cela est sans doute encore plus efficace.
Le sénateur Pépin: J'avais oublié cet aspect.
Le sénateur Corbin: Par curiosité, dans le cas de conscience auquel vous avez fait allusion lorsque l'infirmière a refusé de se conformer au souhait du patient, cet événement a-t-il eu lieu dans un environnement religieux? S'agissait-il d'un hôpital public? S'agissait-il d'un patient de la même religion?
M. Sneiderman: C'était dans le contexte d'un colloque organisé par l'un des professeurs de médecine versés en éthique médicale, et il s'agissait d'un exercice de jeu de rôles. Cela se déroulait au Health Sciences Centre à Winnipeg. On n'a jamais discuté des convictions religieuses du patient. La résidente médicale a mentionné ses croyances religieuses sans préciser en quoi elles consistaient. Elle a parlé du caractère sacré de la vie et a indiqué qu'elle ne pouvait tout simplement pas accepter la décision d'un patient de mourir. Elle a dit que la situation serait peut-être différente si le patient était en phase terminale et en train de mourir, ce qui n'était pas le cas. C'est tout ce qu'elle a dit.
Le sénateur Corbin: Il s'agissait en fait d'un exercice d'éthique?
M. Sneiderman: J'ai participé à quelques-uns de ces exercices, et il est intéressant de constater à quel point les gens se prennent au jeu. En fait ce n'est plus un jeu pour eux: cela devient réel.
Le sénateur Corbin: Nous avons les jeux de guerre. C'est une analogie.
M. Sneiderman: Oui.
Le sénateur Corbin: La question plus générale concerne l'objet de tout cet exercice, je suppose.
Pourquoi les gouvernements, les parlements ou les assemblées législatives n'ont-ils pas donné suite à certaines des questions soulevées dans le rapport du Sénat, «De la vie et de la mort», et combien de temps faudra-t-il attendre avant que l'on agisse à cet égard?
Professeur Downie, je ne me souviens pas de vos termes exacts, mais vous avez dit que les tribunaux sont en train, cas par cas, d'établir un consensus sociétal, et d'établir des précédents, petit à petit. Cela nous rappelle la façon dont l'euthanasie est devenue légale aux Pays-Bas, par exemple. Les tribunaux se sont prononcés là où le Parlement a refusé de s'aventurer.
Laissons de côté l'aspect légal pendant un instant. Que pensez-vous des gouvernements, des parlements et des assemblées législatives qui n'assument pas leurs responsabilités, sociales ou sociétales, à cet égard? J'aimerais que vous abordiez l'aspect politique ou philosophique, car c'est ce dont il s'agit.
Mme Downie: C'est une question extrêmement intéressante. Pourquoi n'a-t-on rien fait? Je ne suis pas la personne la mieux indiquée pour répondre à cette question. Il faudrait sans doute un politicologue et un anthropologue pour répondre à une telle question.
Je crois franchement qu'il s'agit d'une abdication de responsabilité. Je n'ai aucune difficulté à arriver à cette conclusion, mais j'ai de la difficulté à comprendre ce phénomène. Je ne comprends peut-être pas suffisamment les influences qui s'exercent au niveau de la politique. Je suis une observatrice de l'extérieur, et il me semble que c'est une question qui a tendance à polariser l'opinion. Je ne parle pas uniquement de la recommandation unanime. Je ne parle pas de la décriminalisation de l'euthanasie. Je parle de la non-administration et de l'interruption du traitement de survie. Pourquoi les gens refusent-ils d'aborder cette question? Je pense qu'ils craignent que, si vous présentez une loi dans ce domaine, les gens ne croient que vous êtes déjà en train de présenter une loi sur l'euthanasie et le suicide assisté, et que vous êtes en train de déguiser la question. Ils craignent peut-être que vous ne fassiez ce premier pas et que nous n'arrivions pas à nous arrêter une fois lancés sur cette pente glissante. La crainte qui se rattache à une question qui suscite la polarisation concerne le résultat du vote sur une telle question. Il existe dans ce domaine des minorités qui se font entendre et qui semblent avoir beaucoup d'influence sur le plan politique. Il est parfaitement clair que la grande majorité des Canadiens appuient ce type de réforme législative: pourtant il est évident que les calculs faits par ceux qui déterminent ce qui influera sur les politiciens élus consistent à déterminer ce qui permettra de les faire réélire. Le consensus à cet égard, c'est que cela ne favorisera pas la réélection. Je pense que c'est très malheureux.
J'estime que les gens ont une responsabilité à cet égard. J'espère que vous l'assumerez, que vous informerez soigneusement le public et que vous en récolterez d'énormes avantages. Il s'agit d'une occasion intéressante d'agir pour le Sénat. Vous n'avez pas besoin de vous préoccuper de votre réélection. Vous pouvez mettre de côté tous ces aspects politiques et reconnaître qu'il existe un problème grave au Canada, à savoir que nous ne nous occupons pas correctement des mourants. Il n'est pas nécessaire d'ouvrir l'autre débat, mais vous pouvez en aborder un aspect et prendre des mesures à cet égard. Les gens vous applaudiront si cela est fait soigneusement, et nous serons mieux en mesure de nous occuper des mourants. La plupart des travailleurs de la santé seront mieux en mesure de le faire, ce que d'ailleurs ils veulent faire. Nous n'avons rien à perdre. Nous pouvons laisser de côté la politique et mettre l'accent sur la question fondamentale, à savoir permettre à tous de soigner les mourants grâce à une réforme législative dont la teneur n'est pas controversée. Je vous renvoie la balle et vous demande pourquoi cela ne s'est pas produit de l'extérieur.
Le sénateur Corbin: Je partage votre opinion. Cette inertie me dérange moi aussi.
Je n'ai pas l'intention d'aborder l'aspect religieux de cette question, mais même le Vatican approuve certains des points soulevés dans notre rapport. Je ne crois pas que le public en général soit au courant de la chose, et je ne crois pas non plus que les gouvernements sachent ce que l'on entend par une ordonnance de non-réanimation, par le maintien en vie artificiel et ce genre de choses. Le Vatican a clairement exprimé ses vues à cet égard. Le professeur Sneiderman a peut-être des choses à ajouter.
M. Sneiderman: En 1957, le pape Pie XII, qui n'est pas l'un de mes héros, a établi une distinction entre un traitement extraordinaire et ordinaire. Aujourd'hui on parle de distinction entre un traitement proportionné et disproportionné. L'Église à cette époque avait déclaré que si le traitement n'offre aucun espoir de bienfait, il était inutile de l'appliquer.
Un grand nombre de prêtres catholiques n'ont toujours pas compris ce message. Je suis au courant de cas à Winnipeg où il y avait des conflits familiaux et où le prêtre a déclaré que le patient devait être traité parce que la vie est sacrée. Le prêtre n'avait pas compris ce que sa propre Église avait prescrit il y a plus de 40 ans.
Par ailleurs, la définition du terme «euthanasie» risque de prêter à confusion. Chaque fois que je participe à une tribune sur l'aide au suicide et l'euthanasie, je prends la peine de définir très soigneusement les termes. Il y a une époque où on établissait une distinction entre l'euthanasie passive et l'euthanasie active. Ces termes ont depuis été abandonnés. Ce que l'on appelait l'euthanasie active volontaire, c'est ce que l'on appelle maintenant l'euthanasie dans le débat sur la légalisation de l'aide au suicide et de l'euthanasie. Ce que l'on appelait l'euthanasie passive est désignée désormais par l'expression «cessation des soins visant à prolonger la vie». Lorsqu'on utilise le mot «euthanasie», c'est comme agiter un drapeau rouge. Pour certaines personnes, la cessation des soins visant à prolonger la vie équivaut à l'euthanasie, et si cela équivaut à l'euthanasie, alors ce doit être quelque chose de répréhensible. Il faut être très clair à propos des définitions.
Mme Downie: Une interprétation un peu plus indulgente des raisons pour lesquelles rien n'a été fait, c'est qu'au cours des dernières années il y a eu certains cas d'euthanasie et d'aide au suicide qui ont retenu l'attention du public: Robert Latimer, Nancy Morrison, et cetera. Certains estiment peut-être qu'il ne faut pas présenter de loi pendant que ces cas d'euthanasie font les manchettes parce que le public ne sera pas en mesure de faire la distinction.
Le sénateur Corbin: Cela ne finira jamais.
Mme Downie: C'est un problème. Peut-on utiliser cela comme prétexte, le fait que ces affaires sont toujours en instance? Une décision a été rendue dans l'affaire Morrison. Se produira-t-il autre chose avant que la décision soit rendue dans l'affaire Latimer? Les gens craignent peut-être que l'on n'allie les cas d'euthanasie avec la loi sur l'abstention ou l'interruption de traitement. L'enjeu consiste à être très prudent dans la façon de présenter les choses, et à présenter les choses de façon à ce que le public sache quelle est votre intention. Je crois qu'ainsi on obtiendra son adhésion.
Le sénateur Pépin: Les responsables des soins palliatifs vont écouter. Cependant je reconnais effectivement que le mot «euthanasie» effraie tout le monde.
M. Sneiderman: Dans mes déclarations préliminaires, j'ai dit que je commenterais l'affaire Morrison, et j'ai oublié de le faire. Avec votre permission, j'aimerais le faire maintenant.
La présidente: Oui, je vous en prie.
M. Sneiderman: Dans sa décision lors de l'audience préliminaire, le juge a déclaré tout d'abord qu'il n'y avait pas vraiment lieu de demander à un jury de se prononcer sur la question de meurtre, étant donné que selon certaines indications la perfusion des quantités massives de médicaments antidouleur qui avaient été administrées au patient ne s'était pas faite parce que l'intraveineuse avait bougé. On avait avancé la théorie selon laquelle si la perfusion de ces médicaments ne s'était pas faite, il en était peut-être de même pour le chlorure de potassium. Cependant, le fait est qu'une minute après que le chlorure de potassium eut été administré, le coeur du patient a cessé de battre. Par conséquent, je crois qu'il s'agissait d'une cause probable d'action à soumettre au jury.
Par ailleurs, la décision selon laquelle l'existence d'une infraction incluse ne pouvait être établie contre la docteure Morrison était clairement erronée, puisqu'il existait des preuves incontestables selon lesquelles elle avait administré du chlorure du potassium et qu'en droit cela était clairement un crime de tentative de meurtre. Selon le Code criminel, même s'il est dans les faits impossible de commettre le crime, un accusé peut néanmoins être reconnu coupable d'une tentative.
Un exemple que j'utilise avec mes étudiants, c'est celui de la grand-mère qui se berce dans sa chaise berçante. Vous êtes son héritier et, comme elle ne se décide pas à mourir, vous lui trouez la peau. Après l'autopsie, il s'avère que la grand-mère est morte d'une crise cardiaque dix minutes avant que vous lui tiriez dessus. Cela demeure une tentative de meurtre. Comme il est impossible de tuer un cadavre, vous ne pouvez pas être reconnu coupable de meurtre, mais il s'agit d'une tentative de meurtre, comme c'est le cas dans l'affaire Morrison.
Il est intéressant de se demander pourquoi, malgré ce qu'indique clairement la loi à mon avis, ce dossier a été clos, même si cela ne veut pas dire que je crois qu'il ne s'agissait pas du meilleur résultat, compte tenu des circonstances de l'affaire.
Le sénateur Roche: Professeur Downie, j'ai lu l'article paru dans le Globe and Mail aujourd'hui intitulé «Why we should embrace death». L'auteur est Daryl Pullman, professeur agrégé d'éthique médicale à l'Université Memorial à St. John's. Il fait certaines juxtapositions assez intéressantes entre le rôle approprié du médecin et le caractère inévitable et le mystère de la mort. Il fait ensuite la distinction entre l'avancement des sciences médicales et une culture qui nie la mort.
Il s'agit d'une question incroyablement complexe, puisqu'il s'agit d'une part de déterminer comment protéger l'intégrité et le caractère sacré de la vie tout en protégeant les droits des fournisseurs de soins de santé et les droits des patients.
Qu'aimeriez-vous que le comité fasse? Est-ce que j'abuse en vous demandant de résumer votre point de vue à cet égard? Lorsque les gens me demandent de résumer ma philosophie, je leur dis de lire mes livres. Êtes-vous en mesure de dire au comité, d'après votre expérience, ce que vous aimeriez qu'il recommande en ce qui concerne la juxtaposition que je viens de vous présenter à propos de la protection du caractère sacré de la vie et de la protection des droits des médecins, des fournisseurs des soin de santé et des patients?
Mme Downie: Je vous donnerai une réponse limitée à cette question. Je la limiterai dans le contexte des recommandations unanimes; par conséquent, ce qu'il faut faire à propos des questions abordées dans ces recommandations unanimes.
Si vous examinez les valeurs fondamentales de notre système judiciaire, qui à mon avis sont assez répandues dans l'ensemble de la société, vous constaterez les valeurs que vous avez exprimées lorsque l'on parle de droits: c'est-à-dire l'autonomie, l'égalité, la dignité, la vie. Ce sont de toute évidence les valeurs fondamentales de notre système. Il y a parfois des tiraillements entre ces valeurs, et dans le domaine de l'aide à la mort ces tiraillements sont fréquents. Cependant, je pense que nous pouvons trouver des moyens de régler ces tiraillements dans d'autres domaines qui nous permettent de comprendre comment nous devrions les régler dans le domaine de l'aide à la mort.
Par exemple, dans le cas des adultes aptes à décider, dans l'ensemble de notre système nous avons reconnu que l'autonomie prévaut tant que l'expression de cette autonomie ne nuit à personne d'autre. Pour utiliser un langage extrêmement familier, j'ai le droit de brandir mon poing à un pouce de votre nez. Ce principe est répandu dans l'ensemble de notre système judiciaire et de notre tissu social. Si vous l'appliquez dans le contexte de l'abstention, de l'interruption de traitement ou d'un traitement palliatif qui abrège la vie, et cetera, cela signifie que des adultes aptes à décider devraient avoir accès, sur demande, à un traitement palliatif qui risque d'abréger leur vie, et que leur refus d'un traitement de survie doit être respecté.
Je suggère au comité de s'assurer que le droit et la pratique reflètent ces déclarations de façon à ce que les adultes aptes à décider voient leurs voeux respectés.
Puis on passe aux personnes inaptes à décider. Si elles ont préparé des directives préalables, l'analyse de l'autonomie se fait de façon pratiquement aussi nette. Vous avez une déclaration de leurs souhaits préalables, vous savez ce que ces personnes auraient voulu, donc vous respectez leurs voeux et vous assurez le traitement ou vous respectez le refus du traitement, selon le cas. Dans le cas des personnes inaptes à décider, nous passons à une forme d'analyse différente, l'analyse de l'intérêt véritable. Cette analyse évalue toujours le droit à la vie en fonction d'autres intérêts. Cependant, il est généralement accepté qu'il arrive que la vie ne vaut plus la peine d'être vécue et que l'on peut dire de façon raisonnable qu'il n'est pas dans l'intérêt véritable d'une personne inapte à décider de continuer à recevoir un traitement. On peut dire de façon tout à fait raisonnable qu'il est dans l'intérêt véritable d'une personne inapte à décider, et qui souffre, de recevoir un traitement permettant de contrôler adéquatement la douleur, même si ce traitement risque d'abréger sa vie.
Je proposerais qu'en premier lieu vous épousiez ces recommandations une fois de plus, que vous tâchiez de trouver une nouvelle façon de les faire adopter par ceux qui ont le pouvoir de les adopter, et de préciser le statut juridique de l'abstention ou de l'interruption de traitement de survie pour toutes les catégories de personnes. Il importe de préciser le statut juridique de la prestation de traitements palliatifs susceptibles d'abréger la vie afin que les gens puissent recevoir des soins qui soulagent adéquatement la douleur.
Puis vous devriez vous occuper de modifier la peine. J'estime que la peine obligatoire d'emprisonnement à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle pendant 25 ans ne convient pas. Elle ne sert pas les intérêts de la société ni ne protège ceux que nous voulons protéger.
Le sénateur Roche: À la fin de votre mémoire, vous dites qu'il est urgent de s'occuper des raisons pour lesquelles un éclaircissement juridique s'impose. Vous déclarez:
Par exemple, les gens meurent dans des souffrances atroces.
Pouvez-vous fournir au comité certaines preuves empiriques quant aux chiffres qui existent et qui vous incitent à faire une telle déclaration?
Mme Downie: Non. Je suppose que votre comité convoquera non seulement des spécialistes en soins palliatifs, mais aussi des personnes qui s'occupent de gens dans d'autres circonstances où la douleur est irréductible. Ce ne sont pas tous les mourants ni tous ceux qui éprouvent une douleur irréductible qui reçoivent les soins palliatifs d'un médecin. Ce sont eux qui pourront vous fournir les données les plus à jour. Je ne suis pas en mesure de vous fournir la source la plus à jour. Je peux vous indiquer la source de cette déclaration. Vous pouvez aussi vous fier sûrement à des preuves empiriques.
Le sénateur Roche: Je préférerais ne pas me fier à des preuves empiriques. S'il existe des documents professionnels, je serais heureux que vous les mettiez à la disposition du comité.
Mme Downie: Il y a une énorme étude faite aux États-Unis intitulée, je crois, «Support Study». Je peux vous l'envoyer.
Le sénateur Roche: J'aurais cru que, vu l'état de la médecine aujourd'hui, les gens qui éprouvent des souffrances intolérables se voient administrer suffisamment de médicaments.
Mme Downie: Il y a deux problèmes. Le premier, c'est l'accès à des gens qui savent comment soulager leur douleur, qu'il s'agisse de spécialistes en soins palliatifs ou d'autres types de médecins qui savent comment soulager la douleur. Il existe un terrible problème d'accès aux gens qui savent comment soulager la douleur. Le deuxième problème, c'est que certaines douleurs ne peuvent pas être contrôlées. Même les plus fervents partisans des soins palliatifs, quelqu'un comme le docteur Balfour Mount, qui est un merveilleux fournisseur de soins palliatifs, vous diront qu'au moins 5 p. 100 des gens éprouvent une douleur qui ne peut être contrôlée.
Le sénateur Roche: Vous déclarez aussi dans votre mémoire:
Les gens essaient de se suicider, sans succès, et se retrouvent dans une situation pire que lorsqu'ils ont fait leur tentative de suicide.
Existe-t-il des preuves empiriques pour appuyer cette déclaration?
Mme Downie: Oui.
Le sénateur Roche: Pouvez-vous les mettre à notre disposition?
Mme Downie: Oui.
Le sénateur Roche: Professeur Sneiderman, compte tenu des critiques que vous avez exprimées concernant la peine de dix ans imposée à Robert Latimer, pouvez-vous indiquer au comité ce que vous considérez comme une peine appropriée dans un cas comme celui-là?
M. Sneiderman: Je trouve cela difficile à faire parce que je ne suis pas un juge qui impose des peines. Un juge doit examiner les tendances de la détermination de la peine pour déterminer la peine appropriée à imposer dans un cas donné.
Compte tenu des faits de cette affaire, je considère que la peine prononcée par le juge Noble était appropriée. J'ai des enveloppes pleines de coupures de presse et d'histoires concernant d'horribles contrevenants qui ont commis d'horribles crimes et dont les peines maximales sont non seulement inférieures à celle reçue par Robert Latimer, mais pour qui les peines réellement imposées sont aussi considérablement moins sévères.
Les dispositions relatives à la détermination de la peine dans le Code criminel en ce qui concerne le meurtre s'appuient sur le principe selon lequel le meurtre est le pire crime qui peut être commis. Je pense que c'est souvent le cas. Cependant, je ne crois pas que ce soit toujours le cas. Il ne faut pas oublier qu'il faut tenir compte non seulement du crime, mais aussi du criminel. Je crois que la peine doit être adaptée non seulement au crime, mais aussi au criminel.
Le sénateur Roche: Vous l'avez bien dit dans votre témoignage. Vous m'avez un peu étonné dans votre première phrase en réponse à ma question, si je vous ai bien entendu la deuxième fois, lorsque vous avez dit qu'à votre avis la peine imposée à Latimer était appropriée.
M. Sneiderman: Si c'est ce que j'ai dit, je me suis trompé.
Le sénateur Roche: Je vais vous donner la possibilité de rectifier vos propos. J'ai déduit de votre déclaration qu'à votre avis la peine imposée à M. Latimer était grossièrement inappropriée, vu les circonstances de l'affaire.
M. Sneiderman: Je l'ai trouvée inappropriée, trop lourde. La peine de 10 ans était trop lourde.
Le sénateur Roche: Estimez-vous que M. Latimer devait recevoir une peine, quelle qu'elle soit? Dans l'affirmative, quelle aurait-elle dû être à votre avis?
M. Sneiderman: Dans cette affaire, on a invoqué la défense de nécessité. Le juge de première instance a interdit au jury d'examiner ce moyen de défense. Je pense qu'il a eu raison. Peut-être un jour la défense de nécessité sera-t-elle autorisée lorsque l'accusé aura commis un meurtre par compassion. Cela serait sans doute plus facile dans un cas où la personne décédée avait donné son consentement. Sans le consentement de la personne décédée, lorsqu'il s'agit d'une euthanasie non volontaire, cela crée un précédent dangereux en vertu duquel quelqu'un pourrait décider qu'il vaut mieux qu'une autre personne soit morte. Je n'aime pas les règles inflexibles. En théorie, on pourrait imaginer une situation où ce pourrait être un moyen de défense acceptable. Dans l'affaire Latimer, je dirais que sa conduite a été répréhensible. Il a été prouvé qu'il y a eu crime; se pose ensuite la question du châtiment.
Comme je l'ai dit, je ne suis pas un juge qui impose des peines. Je n'ai pas l'expérience qui me permettrait de dire ce qui est approprié en l'espèce. Je dirai seulement qu'à mon avis la peine imposée par le juge Noble était appropriée. Je peux l'accepter sans problème. Je pense qu'il devrait purger une peine d'incarcération, et c'est ce qui s'est passé en application de la décision du juge Noble. Il a reçu une peine d'un an d'incarcération. Il ne l'a pas purgée au complet. Il a bénéficié d'une libération anticipée, mais c'est généralement ce qui se passe dans notre système lorsqu'il s'agit de peines relativement légères.
La présidente: Professeur Downie, vous avez parlé de directives préalables et vous avez dit qu'il y a une province et un territoire qui n'ont pas de loi. Dois-je comprendre qu'il s'agit de l'Île-du-Prince-Édouard?
Mme Downie: Non, c'est le Nouveau-Brunswick. L'Île-du-Prince-Édouard l'a adoptée, mais ne l'a pas encore proclamée. Même chose pour la Colombie-Britannique, mais la loi est censée entrer en vigueur le 28 février 2000. Nous l'avons appris la semaine dernière.
La présidente: Savez-vous s'il y a des efforts de la part du gouvernement fédéral ou de l'ensemble des provinces pour que la loi d'une province sur les directives préalables soit acceptée ailleurs? Par exemple, moi, je réside dans deux provinces, le Manitoba et l'Ontario. Parce que c'est une question qui me préoccupe, j'ai préparé des directives préalables dans les deux provinces, mais si je n'en avais qu'au Manitoba, seraient-elles respectées si j'avais un accident ou une maladie fatale ici en Ontario?
Mme Downie: À ma connaissance, il n'y a eu aucun effort collectif, et à coup sûr rien au niveau fédéral, et il n'y a pas d'arrangement réciproque entre les provinces. J'ai vaguement le sentiment qu'une province a quelque chose concernant les directives préalables des autres provinces pourvu que leur forme générale s'inspire de la loi ontarienne de 1996. Si l'on procède à un examen attentif, on constatera peut-être, dans les diverses lois, des cas où, si cela se rapproche assez, les directives seraient appliquées.
Vous allez avoir des problèmes quand les provinces n'ont pas le même genre de directives préalables. Il y a les instructions et il y a les procurations. Dans les instructions, on énonce le genre de décisions à prendre, tandis que dans la procuration on indique qui doit prendre ces décisions. En Nouvelle-Écosse, il n'y a que des procurations, de sorte que si vous remplissez les instructions ontariennes, qui précisent tout admirablement, mais que vous ne désignez pas un fondé de pouvoir, vous ne serez pas couvert par la loi de la Nouvelle-Écosse.
Je pense que l'on pourrait avancer un autre argument pour que vos directives préalables soient respectées dans une autre province -- sans chercher une disposition de réciprocité dans la loi -- et ce serait en invoquant le common law. Dans la jurisprudence, il y a l'affaire Malette c. Shulman de la Cour d'appel de l'Ontario dans laquelle il a été décidé que les directives préalables doivent être respectées. Si vous étiez dans une autre province, mettons la Nouvelle-Écosse, et que vous avez des instructions, mais pas de procuration, vous ne bénéficieriez de rien en vertu de la Medical Consent Act, comme elle s'appelle, mais je pourrais soutenir que vos instructions sont l'expression claire de vos souhaits et que nous devrions nous y tenir en vertu du common law, et non en vertu de la loi ontarienne. Il est évident que nous ne serions pas liés par la loi ontarienne. Quand je rencontre des gens qui se préoccupent de cette question précise, je leur dis qu'ils pourraient invoquer cela. C'est en tout cas ce que je soutiendrais si j'avais un membre de ma famille en Nouvelle-Écosse et que cela se présentait. Je réclamerais l'application du common law.
C'est une autre façon de procéder. De plus, ce n'est qu'une décision ontarienne, et la Cour suprême du Canada ne s'est pas prononcée sur la question, quoique ici encore il y ait une complication. La décision Malette c. Shulman est citée dans un paragraphe de la décision Rodriguez. On y reconnaît que l'on peut invoquer le common law dans certains cas. C'est une autre façon de montrer comment, en faisant du rapiéçage, on peut présenter un argument et, de cette façon, couvrir tous les éléments de l'abstention et de l'interruption, mais c'est vaseux et compliqué. Ce serait beaucoup plus facile s'il y avait une loi. Ceux qui ne connaissent pas quelqu'un qui passe son temps à réfléchir aux derniers moments de la vie pourraient faire respecter leurs souhaits plus rapidement et sans doute de façon plus uniforme.
La présidente: Il y a aujourd'hui des lois sur les directives préalables dans de nombreuses provinces. À votre avis, la population est-elle au courant? Quand je dis aux Manitobains que nous avons une loi de ce genre depuis longtemps, bien avant celle d'autres provinces, ils ne le savent pas. Y a-t-il une campagne d'information pour que les gens sachent qu'ils peuvent préparer des directives préalables?
Mme Downie: Rien à ma connaissance qui soit fait par les gouvernements, fédéral ou provinciaux.
J'ai plutôt constaté des initiatives locales par des organisations comme la Corporation canadienne des retraités intéressés. Elle a préparé une trousse d'information magnifique sur le sujet. Un peu partout au pays, des groupes ont constaté que certaines personnes âgées avaient besoin de comprendre la loi concernant les directives préalables dans leur province, c'est-à-dire la marche à suivre, et ils ont préparé une trousse d'information. Il y a des initiatives de ce genre, mais leur effet est limité parce que même si elles touchent un auditoire, celui-ci se limite aux membres du groupe. À mon avis, ce n'est pas assez bien coordonné.
J'ai constaté la même chose que vous. Les gens ne connaissent pas la loi de leur province. En plus, il n'y a pas de programme d'information coordonnés, et cela vient du fait que l'on ne veut pas être confronté à sa propre mortalité. J'ai apporté des formulaires de directives préalables chez moi et j'ai dit aux membres de ma famille de les remplir. Ils n'ont pas sauté de joie. Les gens hésitent. Mais si on prenait soin de préparer le terrain et de discuter avec eux de ce qu'il faut pour préparer de bonnes directives -- il est toujours très facile d'en préparer de mauvaises -- la pratique se généraliserait. Il y a peu de gens qui les comprennent et il y en a peu qui les remplissent.
C'est une bonne initiative. Je n'ai pas commenté certaines de celles qui se trouvent ici parce que j'ai choisi de m'attarder sur les recommandations de nature juridique. Toutefois, beaucoup de recommandations qui ne sont pas d'ordre juridique revêtent une importance cruciale, comme les campagnes d'information, les lignes directrices nationales et les programmes nationaux. Cela aiderait beaucoup, et j'espère qu'elles seront appliquées.
M. Sneiderman: Ce qu'il faudrait, c'est qu'une personnalité se retrouve aux soins intensifs et que son conjoint se retrouve devant les journalistes et dise: «Mon conjoint a signé des directives préalables, refuse l'acharnement thérapeutique, et pour cette raison les soins seront interrompus.» C'est ce qui est arrivé en 1994 dans le cas de Richard Nixon et dans celui de Jacqueline Kennedy.
Aux États-Unis, ces deux cas ont beaucoup fait pour faire connaître les directives en matière de soins de santé. Nous savons quelle est l'importance des médias. Il suffit qu'un cas comme celui-là retienne l'attention des médias. Cela peut accomplir bien davantage que les initiatives locales.
La présidente: Madame Downie, vous dites que les lois ne sont pas claires et donc que la confusion règne. Vous avez donné l'exemple de quelqu'un qui vous téléphone pour vous demander des conseils. Vous avez le luxe de pouvoir dire que vous pouvez donner des conseils parce que vous ne risquez pas d'être poursuivie.
Dans vos fonctions à la faculté de droit, recevez-vous beaucoup de coups de téléphone de ce genre?
Mme Downie: Je reçois effectivement des appels où les gens me décrivent leur situation et me demandent s'ils peuvent interrompre le traitement.
Il y a eu un cas particulièrement poignant qui est arrivé tout de suite après l'affaire Morrison. Si vous vous souvenez, il y a eu une ordonnance de non-publication dans cette affaire, si bien que beaucoup de gens ignoraient ce qu'elle avait fait et pensaient que c'était un cas d'abstention de traitement ou d'augmentation croissante d'injections de morphine. Cela a eu un gros effet paralysant.
Quelqu'un au téléphone m'a parlé d'une femme dont on s'occupait à la maison. Elle était branchée sur un respirateur et voulait l'arrêter. La famille le voulait aussi. Ils pensaient tous qu'il était temps d'arrêter. Je leur ai dit que la loi leur permettait de le faire. «Oui, mais personne ne veut le faire», disaient-ils. On m'a demandé pourquoi personne ne voulait arrêter le respirateur chez elle. Ce qui les inquiétait, c'est que le médecin arriverait en voiture, et, comme ils étaient à la campagne, les voisins verraient la voiture du médecin dans l'entrée. Le médecin partirait ensuite, et ils se demandaient combien de temps passerait avant que l'ambulance ou le corbillard arrive. Ils avaient peur d'être inculpés de quelque chose. Je reçois des coups de téléphone comme cela.
C'était un cas de peur paralysante causée par l'affaire Morrison, qui portait sur l'interruption et l'abstention. Ils ont dit être prêts à l'amener à l'hôpital et que là ils le feraient, parce qu'ils ne risquaient pas d'être vus.
Dans l'ensemble, le personnel soignant sait que non seulement il peut, mais doit interrompre le traitement de survie que le malade ou son représentant refuse. Par contre les gens sont paralysés par la peur parce que ce n'est pas clair.
Je ne reçois pas beaucoup d'appels, mais suffisamment pour que cela m'ennuie.
Des gens me disent que, puisqu'il y a une loi, il n'est pas nécessaire d'en créer une autre. Si l'on fouille assez, on va la trouver, et elle est assez claire, mais je pense qu'il faut une nouvelle loi pour que ce soit limpide pour tout le monde. Les gens pourront ensuite se calmer un peu et mettre leur énergie à s'occuper des malades au lieu de craindre que la police ne frappe à leur porte.
La présidente: Professeur Sneiderman, il y a une partie de votre document qui traite d'une question qui cause beaucoup d'embarras, comme je le constate depuis plusieurs années. Je parle de l'hydratation et de l'alimentation artificielles.
Quand vous avez parlé de l'affaire L. et H., vous avez dit que toucher un malade sans son consentement revient à une agression. Dois-je en conclure qu'à votre avis l'insertion d'intraveineuses ou de valves à des fins d'alimentation ou d'hydratation, sans le consentement du malade, serait aussi une forme d'agression?
M. Sneiderman: Pas forcément. Cela dépend à quoi le malade avait consenti au début. Cela pourrait dépendre de l'avis de la famille. Comme vous le savez, il se passe beaucoup de choses dans la pratique dans les hôpitaux qui ne sont pas reconnues légalement. Par exemple, lorsqu'un membre de la famille est invité à donner son consentement pour traiter un adulte, à moins qu'un membre de la famille n'ait été désigné tuteur légal du malade ou que le membre de la famille n'agisse en vertu d'une procuration, à strictement parler, le membre de la famille n'a pas légalement le pouvoir de prendre des décisions en matière de traitement médical. Sauf que cela ne correspond pas à la réalité, et, d'ailleurs, comment pourrait-il en être autrement?
On ne pourrait pas dire que ce malade fait l'objet d'une agression. J'ai aussi de graves réserves à propos de la décision manitobaine qui a soulevé des questions très profondes en deux pages à peine. Chose intéressante, je suis tout à fait de l'avis du juge Twaddle, qui dit ne pas comprendre pourquoi quiconque voudrait protéger la vie d'un malade en état végétatif. Il se trouve que c'est mon avis également.
La présidente: Prenons le cas du malade qui est lucide et qui refuse d'être alimenté et hydraté artificiellement et à qui on insère quand même les intraveineuses. Est-ce une agression?
M. Sneiderman: Oui. Si le malade jouit de ses facultés et a refusé, alors «non» signifie «non».
La présidente: Si le malade est sous perfusion et veut que les intraveineuses soient enlevées et qu'on ne lui obéit pas, est-ce une agression?
M. Sneiderman: Si le malade est lucide, qu'un traitement est en cours et qu'il demande que le traitement soit interrompu, alors il doit l'être. Vous pouvez établir une analogie ici avec les dispositions sur l'agression sexuelle dans le Code criminel. «Non» signifie «non», et «oui» maintenant peut signifier «non» deux minutes plus tard. Si c'est «non» deux minutes plus tard, c'est ce qui compte, et non pas le «oui» de deux minutes plus tôt.
Le sénateur Beaudoin: J'ai été absent pendant quelques instants et à mon retour vous parliez de l'affaire Latimer. Je me souviens que nous avons étudié le cas il y a cinq ans. Je suis l'un de ceux qui avaient suggéré de l'étudier. Je me reporte aux recommandations du rapport du comité, à la page 91.
Estimez-vous, madame la présidente, qu'il s'agit bien d'une étude qui a été réalisée sur la question, et, dans l'affirmative, quel est le résultat de cette étude? Les membres du comité ont-ils adopté à l'unanimité les conclusions?
La présidente: Non.
Le sénateur Corbin: De quelle question discutons-nous ici?
Le sénateur Beaudoin: L'homicide par compassion.
La présidente: Ce qui est clair, c'est notre recommandation selon laquelle une troisième catégorie de meurtre devrait être créée. Nous avions recommandé que l'individu soit inculpé de meurtre, suive la procédure, et que sur déclaration de culpabilité le juge puisse imposer une peine applicable à cette troisième catégorie de meurtre, par opposition à une peine pour meurtre au premier ou au deuxième degré, et qui comporte la réclusion obligatoire à perpétuité avec possibilité de libération conditionnelle dans 10 ou 25 ans.
On peut dire honnêtement, sénateur Beaudoin, que notre intérêt pour ce type d'inculpation était attribuable à ce que nous savions de l'affaire Latimer. Pour être juste, il faut dire que nous n'avons pas porté de jugement définitif sur l'affaire Latimer parce que nous savions qu'elle n'allait pas être réglée avant la publication de notre rapport. Nous étions à la fin de son premier procès. Nous étions alors convaincus qu'il y en aurait un deuxième. C'est évidemment ce qui s'est produit, et aujourd'hui la Cour suprême est saisie d'un appel. Lors du premier appel à la Cour suprême, celle-ci a ordonné un nouveau procès.
Le sénateur Beaudoin: Cela correspond exactement à mes souvenirs. Il s'agit là d'une question très importante, mais nous devons attendre la décision de la Cour suprême.
L'examen de cette question fait-il maintenant partie de notre mandat? On en a traité lorsque l'on a examiné celle de l'euthanasie non volontaire.
La présidente: Nous sommes mandatés pour examiner la question d'une inculpation pour une troisième catégorie de meurtre, parce que c'est l'un des points qui ont fait l'unanimité. Notre mandat est d'étudier toutes les recommandations du comité qui ont été adoptées à l'unanimité.
Le sénateur Corbin: Quand vous dites «nous», parlez-vous des membres du comité à ce moment-là? Le comité compte aujourd'hui de nouveaux membres.
La présidente: Effectivement.
Le sénateur Beaudoin: Je ne suis pas certain qu'il y avait unanimité sur ce point. Je suis d'accord avec ce que nous avons dit, mais les membres du comité étaient-ils unanimes sur ce point?
M. Sneiderman: Le texte dit «le comité recommande», et il n'y a pas de dissidence relevée à la page 91.
La présidente: Le comité recommande que le Code criminel soit modifié.
Si vous regardez sous «euthanasie volontaire» et sous «euthanasie non volontaire», vous verrez que dans les deux cas il y a une majorité et une minorité de voix. Dans ce cas-ci, en haut, sénateur Beaudoin, vous verrez que la recommandation a été adoptée à l'unanimité.
Le sénateur Beaudoin: Cela ne me cause pas de difficulté parce que je suis d'accord avec cette décision. Estimez-vous que cela fait partie de notre mandat actuel?
La présidente: Oui, tout à fait.
Le sénateur Beaudoin: Je suis d'avis qu'il y a lieu de modifier le Code criminel dans un cas comme celui-ci. Toutefois, il n'y a pas de réponse toute faite.
Vous avez dit que ce qui s'est passé dans l'affaire Latimer ne devrait pas se reproduire parce que la peine était beaucoup trop lourde. C'est bien le cas?
M. Sneiderman: C'est mon avis.
Le sénateur Beaudoin: C'est votre avis.
La présidente: Pour être juste, le professeur Sneiderman nous a proposé une autre solution que la création d'une troisième catégorie de meurtre, et je sais que nous voudrons l'examiner. Il a dit que nous devrions peut-être à la place examiner toute la question de la présomption légale de peine. Vous ai-je bien compris, professeur Sneiderman?
Le sénateur Beaudoin: Pourriez-vous me résumer cela?
M. Sneiderman: Premièrement, les recommandations du comité portaient expressément sur le meurtre par compassion; ou bien il s'agit d'homicide involontaire ou d'une autre catégorie de meurtre. S'agissant de la peine minimale obligatoire en cas de meurtre, nous ne traitons pas directement du meurtre par compassion parce qu'il y a d'autres possibilités. Par exemple, celui du syndrome de la femme battue où l'on peut dire qu'il ne s'agit pas vraiment d'autodéfense ni de provocation. Il y a la défense de l'agression provoquée. Peut-être, s'il n'y avait pas de peine minimale obligatoire, pourrions-nous faire disparaître le mythe -- car j'estime que c'en est un -- selon lequel il y a des gens qui commettent un meurtre en état d'ébriété, et la loi accepte qu'il n'y a pas d'intention criminelle. Il s'agit dans tous les cas de situations où la victime est quelqu'un contre qui l'accusé était en colère. Ce n'est jamais le cas de quelqu'un qui est ivre au point de tuer son meilleur ami parce qu'il ignorait ce qu'il faisait. Cela signifie que s'il n'y avait pas de règle inflexible nous n'aurions pas à nous préoccuper à ce point du nom que l'on donne à l'acte. Nous pourrions ensuite nous pencher sur le châtiment. Nous pourrions simplement modifier le Code criminel pour faire en sorte que les peines minimums obligatoires continuent d'exister. Toutefois, si la défense souhaite contester cette peine minimum obligatoire après une déclaration de culpabilité, ce serait à la défense de prouver pourquoi le minimum obligatoire ne devrait pas s'appliquer en l'espèce. Nous pourrions peut-être même accepter un fardeau de la preuve un peu plus lourd que celui qui existe en matière civile.
Il y a une catégorie de preuve aux États-Unis, relative à la preuve claire et convaincante, qui s'applique dans certains cas de ce que l'on appelle le droit de mourir. Ce fardeau de la preuve se situe entre le fardeau en matière civile, la prépondérance de la preuve, et le fardeau en matière criminelle, celui de preuve au-delà de tout doute. Si la défense arrivait à répondre aux critères du fardeau dans un cas particulier, nous pourrions ensuite délier les mains du juge. Celui-ci pourrait toujours imposer une peine de neuf ou huit ans ou statuer que l'incarcération n'est pas appropriée. C'est ma proposition.
Le sénateur Beaudoin: Je veux que ce soit très clair en droit. Notre discussion à ce moment-là -- et c'était à la fin des discussions -- portait sur l'inculpation de meurtre au troisième degré. Nous utilisons cette expression, mais cela reste un meurtre.
M. Sneiderman: Oui.
Le sénateur Beaudoin: Nous n'avons pas eu le temps d'examiner la chose plus en profondeur. Comme la présidente l'a dit, l'affaire Latimer était devant les tribunaux. Un meurtre comme celui-là n'est pas un meurtre ordinaire. Ce qui nous préoccupait, c'était la sanction -- la peine -- plutôt que le crime proprement dit. Bien sûr il s'agit d'un meurtre, mais il n'est pas sensé de punir son auteur de la même façon que d'autres meurtriers. C'est exactement ce que nous avons dit.
Vous nous offrez une autre possibilité, à savoir que cela ne serait pas considéré comme un meurtre.
M. Sneiderman: Non. Le crime reste le même.
Le sénateur Beaudoin: Le crime reste le même?
M. Sneiderman: Oui. Ce qui change, ce sont les options qui s'offrent au moment d'imposer la peine. Autrement dit, le crime reste le même, meurtre au premier ou au deuxième degré. Dans l'affaire Latimer, il s'agissait d'un meurtre au premier degré. Je ne comprends toujours pas pourquoi le juge de première instance a donné au jury l'option de retenir l'accusation de meurtre au deuxième degré. Cela aurait dû être ou bien le meurtre au premier degré ou rien du tout. Et si jamais il y a eu une suppression délibérée de la vie, c'est bien dans ce cas. L'appellation reste la même. C'est toujours un meurtre.
Ensuite nous passons à la peine. Ici, le juge a les mains liées. Il doit imposer une peine de prison à perpétuité avec une admissibilité à la libération conditionnelle qui se situe entre 10 et 25 ans. Je propose que la défense ait la possibilité de persuader le juge qui prononce la peine que, en l'espèce, il existe des circonstances déterminantes et que la peine minimum obligatoire ne doit pas s'appliquer. Comme vous le savez, dans le cas d'une deuxième condamnation de conduite avec facultés affaiblies, la peine obligatoire est 14 jours; commettre une infraction avec une arme à feu entraîne un an d'emprisonnement obligatoire. Toutefois, pour l'immense majorité des infractions au Code criminel, il n'y a pas de peine minimum obligatoire. Ce que les juges font tout le temps -- c'est à cela qu'ils sont formés -- c'est tenir compte de facteurs qui n'interviennent pas dans la détermination de la culpabilité ou de l'innocence. Il s'agit de facteurs relatifs à la question de savoir quel est le châtiment approprié en l'espèce.
Le sénateur Beaudoin: Le débat qui reste porte donc uniquement sur le châtiment.
M. Sneiderman: Précisément.
Le sénateur Beaudoin: Cela est très différent des autres solutions. La véritable question, ce devrait être la sanction.
M. Sneiderman: On arriverait au même résultat ici, comme ce serait le cas si on acceptait l'une ou l'autre des recommandations du comité, qu'il s'agisse d'une inculpation pour homicide involontaire ou pour meurtre au troisième degré. On y arrive autrement, c'est tout.
J'ai rédigé un article qui proposait la défense du meurtre par compassion. L'article portait sur l'affaire Latimer et a été publié dans Health Law Journal. Dans un article récent, je ne parlais plus de défense du meurtre par compassion; je parlais plutôt de peine minimale obligatoire parce que je suis arrivé à la conclusion que l'option du meurtre par compassion n'est pas réalisable. Pour moi, ce n'est pas politiquement faisable.
Le sénateur Beaudoin: Si je vous ai posé la question, c'est qu'à mon avis on n'aurait pas dû en parler dans cette partie du rapport. Cela ne devrait pas vraiment se trouver sous l'euthanasie.
La présidente: Vous avez tout à fait raison, sénateur Beaudoin. Cela n'aurait pas dû figurer dans cette partie du rapport.
Le sénateur Beaudoin: Logiquement, cela ne devrait pas être là.
La présidente: Vous avez raison.
Le sénateur Roche: Madame la présidente, n'avez-vous pas dit il y a un instant que le comité devait examiner uniquement les recommandations adoptées à l'unanimité?
La présidente: Oui.
Le sénateur Roche: Cela figure-t-il dans le mandat?
La présidente: Oui; c'est pourquoi nous avons bien dit que nous ne discuterions pas des questions de l'aide au suicide et de l'euthanasie. Nous allons aborder toutes les autres questions parce qu'elles ont toutes fait l'unanimité. Toutefois, il n'y a pas eu unanimité dans nos conclusions à propos de l'euthanasie et de l'aide au suicide. Chose intéressante, quand nous avons commencé à rédiger notre rapport, l'euthanasie et l'aide au suicide étaient nos principaux points à l'étude. Toutefois, au fur et à mesure que nous avons entendu des témoins, il est apparu que nous voulions débattre de beaucoup d'autres questions, y compris les soins palliatifs, l'interruption et l'abstention de traitement de survie, et cetera. Le rapport a pris une ampleur beaucoup plus grande que ce qui avait été prévu. Nous avons décidé de traiter de questions qui de toute évidence préoccupaient les citoyens qui ont comparu devant le comité.
Le sénateur Roche: Est-il possible d'ériger un pare-feu entre ces deux questions? N'y a-t-il pas un lien à faire entre soins palliatifs et euthanasie? Comment pouvez-vous limiter la discussion?
La présidente: Il y a manifestement un lien entre les deux. Nous disons aux témoins -- et c'est ce que nous avons dit aux témoins que nous entendons aujourd'hui -- que nous les invitons à se concentrer sur les recommandations qui ont été faites à l'unanimité par le comité, mais que nous voulons aussi chercher à voir ce que le gouvernement a fait de ces recommandations unanimes. Nous étions d'avis qu'il serait assez facile pour le gouvernement de s'attaquer à ces questions-là, puisqu'elles avaient fait l'objet d'un rapport unanime. Nous sommes conscients toutefois qu'il lui serait bien plus difficile de s'attaquer à d'autres questions. Après tout, la décision de la Cour suprême du Canada dans l'affaire Rodriguez n'était pas unanime. Par le plus pur des hasards, il se trouve que le partage des voix y était exactement le même que pour l'adoption du rapport du Sénat.
Le sénateur Roche: Ainsi, le travail de notre comité consiste à aiguillonner le gouvernement pour qu'il donne suite aux recommandations de notre rapport qui ont reçu un appui unanime, par opposition aux questions plus controversées qui méritent une plus ample réflexion, c'est bien cela?
La présidente: C'est bien cela. En toute justice, il nous appartient aussi de revoir nos recommandations unanimes. Nous avons peut-être changé d'avis depuis. Nous avons eu un dialogue intéressant aujourd'hui sur la recommandation numéro 3. Nous n'arrivons peut-être pas aux mêmes conclusions que le premier comité quant à la suite à donner à une accusation de meurtre par compassion après avoir entendu le témoignage que nous a livré aujourd'hui le professeur Sneiderman, qui nous laissait entendre qu'il pourrait y avoir une autre façon de s'y prendre. Nous pourrions peut-être proposer au gouvernement deux scénarios possibles.
L'emprisonnement à perpétuité obligatoire de 25 ans pour quiconque est condamné de meurtre au premier degré a été proclamé quand nous avons invalidé la peine capitale. Je ne suis pas sûre que le gouvernement veuille modifier cette disposition, mais c'est là mon avis personnel.
Le sénateur Corbin: Le communiqué de presse a-t-il déjà été publié?
La présidente: Oui, il a été publié aujourd'hui. Nous disons très clairement dans le communiqué de presse que le comité ne va étudier que les recommandations unanimes.
Au nom du comité, je tiens à remercier Mme Downie, qui est venue de Halifax, et le professeur Sneiderman, qui est venu de Winnipeg. Je vous présente nos excuses pour le mauvais temps qui sévit dans la capitale.
La séance est levée.