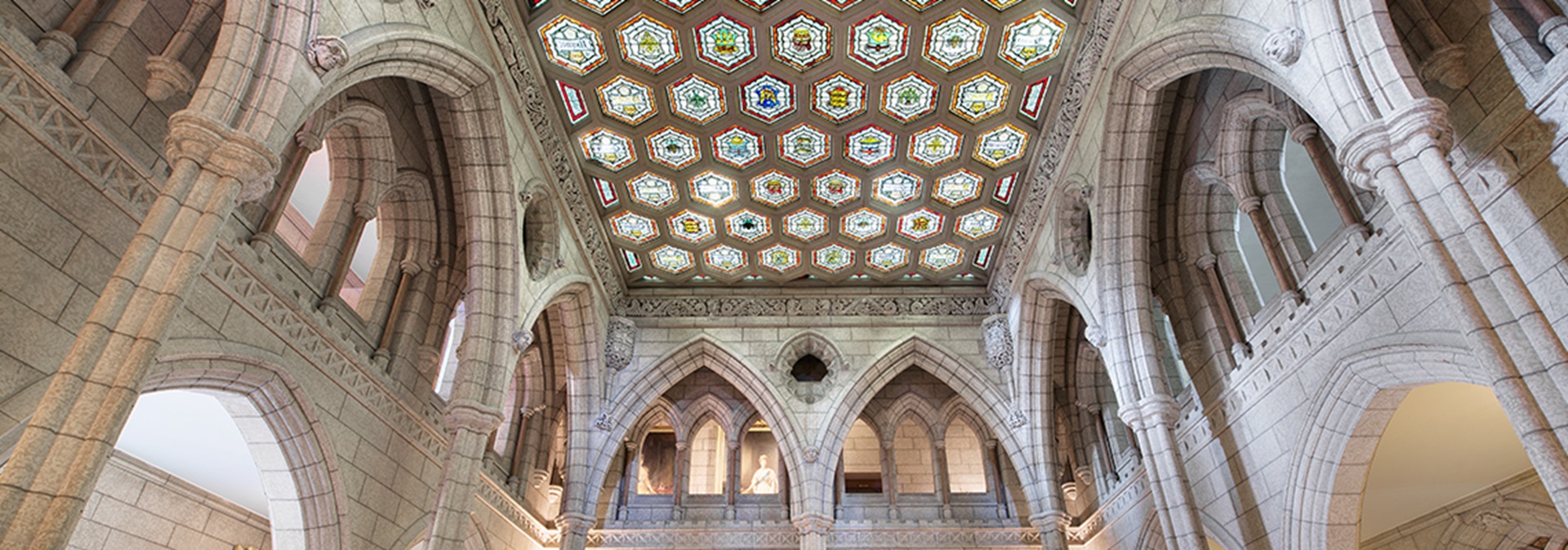Délibérations du sous-comité de
mise à jour de «De la vie et de la mort»
Fascicule 9 - Témoignages
OTTAWA, le mardi 4 avril 2000
Le sous-comité de mise à jour de «De la vie et de la mort» du comité sénatorial permanent des affaires sociales, des sciences et de la technologie se réunit aujourd'hui, à 10 heures, en vue d'étudier les faits nouveaux survenus depuis le dépôt, en juin 1995, du rapport final du comité sénatorial spécial sur l'euthanasie et l'aide au suicide intitulé: «De la vie et de la mort».
Le sénateur Sharon Carstairs (présidente) occupe le fauteuil.
[Traduction]
La présidente: Aujourd'hui marque le neuvième jour des audiences tenues dans le cadre de notre mandat visant à mettre à jour les recommandations unanimes du rapport du comité sénatorial spécial sur l'euthanasie et l'aide au suicide intitulé: «De la vie et de la mort». Je vous rappelle, de même qu'aux témoins et à ceux qui suivent nos audiences à la télévision, que le sous-comité ne reprend pas le débat sur l'aide au suicide et l'euthanasie. Il se concentre uniquement sur les parties du rapport où le comité initial avait des recommandations unanimes. Je vous demanderais de ne pas l'oublier.
Nous entendrons aujourd'hui deux témoins, Mme Virginia Jarvis et le Dr David Roy, de l'Institut de recherches cliniques de Montréal. Je vous souhaite à tous deux la bienvenue. Je vous prie de limiter votre déclaration préliminaire à 15 minutes, après quoi nous aurons une foule de questions à vous poser. Nous vous écoutons.
Mme Virginia Jarvis, Institut de recherches cliniques de Montréal: Je vous remercie beaucoup de m'avoir invitée à vous parler des pratiques actuelles en matière de maîtrise de la douleur et de sédation. Avant de commencer, je dois vous dire quelle est ma perspective, et c'est celle d'une infirmière spécialisée en soins palliatifs et aigus au service d'un grand hôpital d'enseignement. J'ai fort peu de contact avec le grand public.
Pour ce qui est des recommandations qui ont été faites par le comité sénatorial en 1995, je n'ai pas vu grand changement dans les pratiques relatives à la maîtrise de la douleur.
Il subsiste généralement une certaine ignorance en matière de traitement de la douleur, particulièrement pour ce qui concerne les malades en phase terminale. Parmi les médecins, les infirmiers et infirmières, les pharmaciens, les patients et leurs familles, on continue également de craindre que les opioïdes ne causent la mort, et rien n'est plus faux. On sait que c'est la première dose d'opioïdes qui risque le plus de causer une dépression respiratoire. Même si cela devait se produire, nous avons la chance d'avoir un antidote pour cette condition. Il est aisé d'y remédier. En outre, nous avons la certitude que les opioïdes ne causent aucun tort aux organes, contrairement à bien d'autres médicaments. Les médicaments d'usage courant comme les anti-inflammatoires non stéroïdiens peuvent causer des lésions irréparables aux reins ainsi que des hémorragies dans le tractus gastro-intestinal qui peuvent causer la mort. Nombre d'actes chimiothérapeutiques, par exemple, peuvent avoir des effets secondaires parfois mortels. En comparaison, les opioïdes présentent beaucoup moins de danger.
Les médecins et les infirmiers et infirmières craignent encore de provoquer des toxicomanies chez leurs patients, et les patients et les membres de leurs familles craignent qu'eux-mêmes ou les membres de leurs familles ne deviennent toxicomanes.
Notre société a tort de s'en faire autant pour le petit pourcentage de la population qui a des problèmes de toxicomanie. Il y a beaucoup plus de citoyens au Canada qui vivent avec le cancer ou d'autres conditions douloureuses que de personnes qui souffrent d'assuétude aux opioïdes. Avec toutes ces campagnes que l'on mène contre les toxicomanies aberrantes, on omet de dire à notre société que la morphine et les autres opioïdes ont des usages médicaux très valables et légitimes. C'est cette crainte qui explique en partie l'hésitation des médecins à prescrire des opioïdes pour soulager la douleur. En outre, on semble accorder trop d'importance au nombre de milligrammes que le patient reçoit. Ce fait est totalement dénué d'importance. Ce sont les effets des opioïdes ici qui présentent la plus grand importance.
Les opioïdes soulagent la douleur, tout comme les antibiotiques guérissent les infections ou la chimiothérapie, le cancer. Ainsi, si l'on apprend comment traiter la douleur et si l'on connaît la pharmacocinétique des opioïdes, je juge inutile la première recommandation, à savoir que le Code criminel soit modifié afin de clarifier la situation concernant l'administration d'un traitement destiné à soulager la souffrance au risque d'abréger la vie.
Je tiens à dire d'abord que la douleur est une condition qui exige un traitement médical. Le traitement pour toute condition exige une appréciation informée du ratio risque-avantage.
Pour ce qui est de la deuxième recommandation, à savoir que l'on élabore des lignes directrices sur l'administration de traitements visant à atténuer la souffrance mais susceptibles d'abréger la vie, on n'a pas établi de telles lignes directrices à ma connaissance.
Pour ce qui est de la troisième recommandation, celle qui concerne la formation en matière de traitement de la douleur, je pense que nous avons beaucoup à faire de ce côté. Je constate tous les jours que ce que je considère être une connaissance très élémentaire du traitement de la douleur à l'aide des médicaments courants pose de toute évidence d'énormes problèmes pour bon nombre de praticiens de la santé.
L'enseignement aux infirmiers et infirmières et aux médecins du traitement de la douleur, aux niveaux élémentaire et avancé, est un volet important de mon travail. Dans le cadre de mon enseignement, je demande toujours aux participants: qui a suivi un cours en traitement de la douleur ? Je n'ai jamais vu une seule main se lever. Et il y a trente ans que j'oeuvre dans le domaine des soins palliatifs. Je constate qu'un nombre croissant mais toujours insuffisant d'infirmiers et d'infirmières reçoivent une formation un peu plus poussée en traitement de la douleur dans le cadre de leur programme de formation de base. Toutefois, en règle générale, ces infirmiers et infirmières ne disposent pas des connaissances élémentaires qui sont requises pour un bon traitement de la douleur. Je constate surtout qu'ils fondent leurs pratiques sur l'expérience plutôt que sur le savoir. On explique souvent la raison d'être d'une pratique à peu près en ces termes: «Tel ou tel traitement a réussi avec Mme Leblanc, par conséquent, ça sera bon pour M. Lebrun.» Il s'agit là d'une pratique aux fondements très incertains, et cela est très préoccupant.
Je suis au courant des initiatives éducatives s'adressant aux médecins chargés des soins palliatifs; cependant, il existe très peu de cours pour les infirmiers et infirmières en matière de soins palliatifs et de maîtrise des symptômes et de la douleur. L'éducation en matière de maîtrise et de traitement de la douleur pour les médecins et les infirmiers et infirmières est confiée dans une large mesure aux entreprises pharmaceutiques. En outre, il n'existe pas de programmes de formation pour les infirmiers et infirmières-conseils en matière d'application clinique des pratiques relatives au contrôle des symptômes et aux soins palliatifs. J'ai dû moi-même obtenir ma formation à l'extérieur du Canada.
Les infirmiers et infirmières-conseils chargés des soins palliatifs devraient être des modèles et des éducateurs pour ceux qui oeuvrent auprès des patients en phase terminale. L'apprentissage expérientiel n'a de valeur que s'il s'appuie sur une bonne formation. Si l'on n'éduque pas les experts, alors comment peut-on accroître la connaissance des symptômes pour les infirmiers et infirmières en milieu communautaire ou hospitalier? J'en dirai autant pour les médecins étant donné qu'il y a longtemps que je travaille avec eux et les conseille souvent en matière de maîtrise des symptômes. On ne s'étonne donc pas qu'un infirmier ou une infirmière s'imagine avoir causé la mort d'un patient parce qu'il ou elle lui a administré la dernière piqûre de morphine. Le fait est qu'on ne peut pas empêcher nos patients de mourir. Ils meurent de la maladie qu'ils ont contractée et non de la dernière injection de morphine qui les a soulagés pendant les quelques dernières heures de leur vie.
Pour ce qui est des pratiques sédatives, je pense que l'on a apporté des changements dans le bon sens. En 1996, le Dr Chater, moi-même, Judi Paterson, qui était alors infirmière clinique spécialisée en soins palliatifs, et le Dr Viola avons entrepris un projet de recherche pour connaître les origines de l'expression «sédation terminale» et pour solliciter les opinions d'experts mondiaux en matière de pratiques sédatives; nous voulions savoir aussi si ces experts avaient administré un traitement sédatif à leurs patients, quels médicaments ils avaient utilisés, dans quelle mesure les traitements avaient réussi et, le plus important, si ces experts étaient en faveur ou non de l'euthanasie et de l'aide au suicide.
Je vais vous présenter le résumé des conclusions de ce projet de recherche. Je dirais que c'est une étude de base. Nous avons envoyé un questionnaire par la poste à 61 experts en soins palliatifs présélectionnés. Il y avait 59 médecins et 2 infirmières. Aucune de ces infirmières n'était du Canada. Nous voulions savoir ce qu'ils pensaient d'une définition que l'on proposait de la «sédation terminale»; nous voulions estimer la fréquence de cette pratique et les raisons de son utilisation; nous voulions connaître les médicaments et les dosages utilisés, en connaître les résultats et examiner le processus décisionnel. Nous leur avons également demandé leur opinion sur l'aide médicale au suicide et l'euthanasie volontaire. Environ 87 p. 100 des experts ont répondu; ils provenaient de huit pays mais surtout du Canada et du Royaume-Uni. Quarante pour cent approuvaient sans réserve la définition que nous proposions; 4 p. 100 n'étaient pas d'accord. Environ 89 p. 100 ont dit avoir recouru à la sédation terminale au cours des 12 derniers mois précédents -- et plus de la moitié d'entre eux l'avaient administrée à quatre patients au maximum. Au nombre des raisons invoquées pour l'utilisation de ces méthodes, il y avait divers symptômes physiques et psychologiques.
Les médicaments utilisés le plus fréquemment étaient la midazoïame et la méthotriméprazine. Ce ne sont pas des opioïdes mais plutôt des anxiolytiques, donc des médicaments qui suppriment l'angoisse et la souffrance. Ce sont en effet des médicaments aux effets très bénéfiques. Le processus décisionnel faisait intervenir le patient, la famille, et les experts ont fait état des divers degrés d'aisance avec lesquels les décisions étaient prises. Pour 90 patients sur 100, le recours à la sédation était considérée comme une bonne chose. Quatre-vingt-dix pour cent des répondants n'étaient pas en faveur de la légalisation de l'euthanasie, et je pense que c'est là un fait très important.
En conclusion, les experts en soins palliatifs utilisaient des agents sédatifs pour traiter les symptômes. Il faut abandonner l'expression «sédation terminale» et la remplacer par l'expression «sédation soulageant la détresse réfractaire chez les mourants». J'ignore pourquoi le comité sénatorial employait l'expression «sédation totale». Je ne comprends pas du tout pourquoi on a utilisé ce terme.
Je sais que vous êtes tous fort occupés, mais je crois utile de vous raconter ce récit poignant qui nous a décidés à entreprendre ce projet de recherche. Il s'agit d'une expérience que j'ai vécue de très près. J'ai eu le privilège de soigner un patient qui était atteint d'un cancer aux reins très avancé, un monsieur dans la cinquantaine. Sa maladie s'était étendue à son cou et à son épine dorsale. Il avait été vu par tous les experts, et chacun était d'accord pour faire opérer cet homme afin de stabiliser son cou et soulager la douleur intolérable qu'il éprouvait.
L'intervention chirurgicale n'était pas curative mais plutôt palliative. Il devait ensuite se prêter à une radiothérapie. Le tout était très bien pensé. On a opéré le patient pour lui insérer des tiges dans les vertèbres. Même si l'on avait du mal à maîtriser sa douleur après l'opération, l'anesthésiste nous avait donné d'excellents conseils et nous étions sur le point de calmer sa douleur.
Malheureusement, quelque temps après l'intervention chirurgicale, les tiges dans son épine dorsale ont causé une infection et la douleur du patient s'est accrue en conséquence. Les doses de médicaments ont été augmentées comme il se devait, et on lui a administré des opioïdes en rotation étant donné que les effets secondaires de la morphine commençaient à faire problème. Autrement dit, on a fait tout ce qu'on devait faire pour ce patient. Le service d'anesthésie est intervenu; l'unité des soins palliatifs et le service d'aumônerie sont intervenus aussi, mais la douleur de cet homme ne cessait de croître. Nous ne pouvions plus la maîtriser.
Ce patient était un colosse, il avait une voix forte, et il hurlait. Les infirmières ont été admirables, avec lui et sa famille. Elles ont fait tout ce qu'elles ont pu pour le soulager. Elles ne cessaient de demander aux médecins: peut-on faire autre chose?
Sa souffrance a fini par s'étendre au personnel infirmier et aux médecins traitants. Certaines infirmières ne pouvaient plus le regarder parce qu'elles avaient des cauchemars. On a désigné à son service certaines infirmières pour lui offrir à tout le moins une certaine continuité dans les soins. Le patient continuait de hurler à l'aide. Il criait, à pleins poumons, je vous l'assure: «Si j'étais un chien, vous m'achèveriez. Aidez-moi. Par pitié, aidez-moi.»
On s'est alors demandé si l'on devait lui administrer un traitement sédatif pour soulager sa douleur. On a décidé que le fait de lui administrer un traitement sédatif qui soulagerait sa douleur nous engageait sur le terrain glissant de l'euthanasie. En conséquence, ce patient hurlait encore au moment de sa mort. Il n'est jamais entré dans le coma. Au moment de sa mort, il implorait Dieu de lui venir en aide.
Les infirmières qui l'ont soigné ont eu besoin de counselling, et on leur en a offert, mais en fait, on leur en a peu donné. C'est un épisode qui, même près de huit ans plus tard, cause de l'angoisse à ceux qui y ont pris part. Et cela comprend les médecins, les aumôniers et tous ceux qui sont intervenus.
Je ne crois pas que cette situation se produirait aujourd'hui. À mon avis, tous les intervenants seraient disposés à administrer un traitement sédatif à ce patient. On constate souvent que le traitement sédatif, même bref, peut mettre fin à la spirale de la douleur, laquelle est un mélange de douleur physique, de crainte d'un retour ou d'une accentuation de la douleur, de souffrance psychologique et de détresse spirituelle.
Pour conclure, je répéterai que les sédatifs sont utilisés par les experts des soins palliatifs pour gérer les symptômes. Il faudrait cesser d'utiliser l'expression «sédation terminale» pour parler plutôt de «sédation soulageant la détresse réfractaire chez les mourants».
Le président: Merci de votre témoignage.
M. David Roy, Institut de recherches cliniques de Montréal: Honorables sénateurs, au cours des 20 dernières années, il s'est dégagé un consensus au sujet de l'abstention et de l'interruption de traitements qui prolongent la vie. Il existe plusieurs situations douloureuses dans lesquelles de telles décisions doivent être prises.
Je ferai une brève observation sur l'éthique du soulagement de la douleur et de l'angoisse. Je parlerai également de la façon dont nous faisons fi du passé -- à notre détriment -- et je parlerai des recommandations apparemment totalement reléguées aux oubliettes qu'avait formulées en 1983 la Commission de réforme du droit du Canada. Le rapport de cette commission devrait être sorti du tiroir et redistribué.
Je parlerai ensuite des soins palliatifs, de l'enseignement de la médecine palliative et de la recherche dans ce domaine, qui semble perdre constamment du terrain. Si certains demandent où sont donc passées les neiges d'antan, ma question à moi, c'est où sont passés tous les leaders et d'où les nouveaux viendront-ils?
Enfin, je parlerai des soins palliatifs et de la médecine palliative à domicile. Ce n'est pas toujours très beau de mourir chez soi.
Même si sauver des vies a toujours été le principal objectif des soins cliniques et le sera toujours, on reconnaît généralement maintenant que dispenser ou poursuivre des soins intensifs pour prolonger la vie n'apporte parfois qu'un prolongement de l'agonie d'une vie misérable et insupportable. Mme Jarvis en a donné quelques exemples.
Depuis le début des années 70, et plus particulièrement en 1976, grâce au célèbre cas Quinlan, aux États-Unis, les patients, les familles, les infirmiers et infirmières, les médecins et le grand public se demandent si c'est une bonne chose de prolonger la vie jusqu'à son issue biologique amère, surtout dans les cas où les malades et les mourants jugent insupportable le coût physique, émotif et personnel de tels traitements. Au cours des 20 dernières années, une nouvelle tendance s'est développée. Cette tendance s'écarte de l'éthique qui préconise le prolongement de la vie à tout prix, surtout dans le cas des patients qui ne peuvent le supporter, et favorise une éthique qui insiste sur la qualité de vie et qui accorde à la mort, durant la vie, une valeur absolue.
Le consensus actuel dans le domaine clinique et éthique au sujet de l'abstention et de l'interruption de traitements de survie vient de ce qu'on s'est rendu compte que les traitements sont des moyens et que leur usage n'est pas une fin en soi, une fin indépendante des objectifs cliniques qu'accepte le client et que les cliniciens peuvent réaliser. C'est sur ces objectifs cliniques que devraient se fonder les décisions sur le commencement ou l'interruption des traitements, sans oublier que ces objectifs peuvent varier selon l'évolution de la maladie. Ces objectifs varient également d'un patient à l'autre, même lorsque l'état clinique des patients est identique ou très semblable.
C'est la nature de la réaction du patient au plan de traitement qui indique quand le moment est venu de mettre la pédale douce sur les soins intensifs de survie et d'insister davantage sur les soins palliatifs. Cela se fait rarement de façon abrupte et irréversible. Toutefois, certaines interventions, dont la radiothérapie ou la chirurgie, peuvent permettre d'atteindre des objectifs cliniques de guérison auprès de certains patients, et des objectifs palliatifs auprès d'autres. Les traitements ne sont pas des formules coulées dans le béton. Ils peuvent servir à diverses fins, selon l'évolution de l'état du patient.
Dans toute l'évolution de la maladie et l'évolution correspondante des objectifs cliniques, il y a des moments où il est cliniquement, déontologiquement et légalement justifiable de s'abstenir d'offrir des traitements cliniques comme la réanimation, le support respiratoire, la dialyse, les antibiotiques, les traitements antiviraux, la chimiothérapie, la chirurgie, ainsi que l'hydratation et l'alimentation artificielle, ou de cesser d'offrir ces traitements. L'interruption de cette dernière intervention soulève encore fortement la controverse.
Certains, y compris des médecins, des infirmiers et infirmières et d'autres professionnels de la santé, ignorent encore cette tendance et ce consensus, alors que d'autres croient que cette orientation n'est pas souhaitable. De plus, dans certains cas, peut-être dans de nombreux cas, cette orientation peut provoquer inévitablement -- mais ce sera toujours inévitable dans certains de ces cas -- des discussions et des décisions très douloureuses, des délibérations complexes et des décisions graves, si ce n'est que parce que ces personnes, dans leur corps et dans leur vécu, sont trop complexes pour être réduites à de simples principes.
Ils se trompent, ceux qui pensent qu'on peut résumer le contrôle de ces décisions dans un domaine aussi complexe à quelques petits principes qu'il suffit d'appliquer, à quelques articles de loi qu'il s'agit d'exécuter. Ce qu'il faut, ce ne sont pas des principes, non plus que des articles de loi. Si l'on veut microgérer et microréglementer les décisions dans ce domaine, nous courons à l'échec, et c'est normal, car vouloir substituer des principes d'éthique ou des articles de loi au jugement clinique, personnel et professionnel est peine perdue. Le problème, bien sûr, c'est que le jugement professionnel et clinique ne fonctionne pas toujours, que le jugement clinique, personnel et professionnel n'est pas toujours suffisamment éclairé. Dans ces cas, les gens réclament des lois, car ils estiment que le jugement des médecins ou des infirmiers et infirmières n'est pas acceptable. Ce n'est pas la bonne approche.
Il y aura toujours des professionnels qui porteront de mauvais jugements. C'est quand on constate une tendance constante au mauvais jugement qu'il est nécessaire d'agir. Constatons-nous des tendances au mauvais jugement? Il est bien difficile de le déterminer sans études approfondies, et il reste même à déterminer si des études approfondies peuvent permettre ou non de découvrir une tendance à de très mauvais jugements. Toutefois, lorsque les tribunaux sont constamment saisis de certaines causes, lorsqu'il est nécessaire de tenir des enquêtes de coroner, lorsque les familles sont divisées et s'opposent aux hôpitaux, il faut alors se demander si la formation des médecins et des infirmiers et infirmières dans le domaine de l'éthique clinique laisse à désirer et devrait être revue. J'estime qu'il faut revoir l'enseignement qui leur est dispensé car le laisser-aller dans ce domaine confine à la négligence.
De la fin des années 70 jusqu'au milieu des années 80, on a commencé à créer des centres d'éthique dans les universités de diverses régions. On a commencé à offrir un peu partout des cours d'éthique clinique, d'éthique médicale et d'éthique des soins infirmiers. On voulait absolument amener les médecins et les infirmiers et infirmières à enseigner l'éthique clinique. Mais on constate maintenant que les pionniers et les leaders de cette époque, jusqu'à ceux des années 90, prennent de l'âge. Ils approchent tous l'âge de la retraite. Il n'est pas certain qu'il y ait une relève partageant la même passion, la même expérience et les mêmes compétences pour continuer d'offrir cet enseignement.
Parallèlement à la création des centres d'éthique, il y a eu une augmentation de la médecine et des soins palliatifs au Canada, ou du moins la création du premier centre que j'ai mis sur pied et dirigé à Montréal, en 1976. À cette époque, on commençait à découvrir et à encourager les soins palliatifs au Canada. Cela a mené progressivement à la création d'un service de soins à domicile. Des gens des quatre coins du monde venaient à Montréal, puis à Ottawa, puis ailleurs au Canada, pour apprendre comment offrir des soins palliatifs et pratiquer la médecine palliative dans des hospices, des hôpitaux et au domicile des patients.
Le Service de soins palliatifs du Royal Victoria McGill a cessé d'offrir des soins à domicile en 1997. Ce service n'existe plus. J'ai visité des patients chez eux. Ce n'était pas les plus pauvres, pas du tout, mais ils habitaient dans les régions rurales. Plus particulièrement, une patiente avait été renvoyée chez lui pour mourir du cancer. On lui avait remis de la morphine administrable par voie orale et des instructions très rigoureuses sur la façon de l'utiliser. J'ai visité une de ces fermes, et j'ai constaté que la famille était entièrement déchirée et qu'elle ne savait que faire. Lorsqu'on suivait strictement la posologie, le patient souffrait atrocement, mais la famille n'osait pas augmenter les doses. Une semaine plus tard, la famille m'a appelé et m'a dit qu'elle était prête à administrer tout le reste du médicament au patient, puisque ni elle ni le patient n'en pouvait plus. J'ai cherché et j'ai trouvé un médecin qui était prêt à faire deux heures et demie de route pour s'occuper de cette patiente, mais elle est morte avant qu'il puisse monter dans sa voiture pour aller la visiter, le lendemain matin.
Ce n'est qu'une anecdote, mais un peu partout au Canada, on demande maintenant de plus en plus aux gens de mourir chez eux. Le mouvement en faveur des soins ambulatoires ou, comme le diraient les francophones, le «virage ambulatoire», est une excellente chose pour ceux qui peuvent marcher, mais ce n'est pas si bien pour ceux qui ne le peuvent pas. C'est une question qu'il faudrait examiner. Comment les gens meurent-ils à la maison?
Un autre domaine sur lequel je commence à me pencher avec un groupe de chercheurs, c'est la façon dont les pauvres meurent au Canada. Nous ne savons pas comment les pauvres meurent dans notre pays et je ne suis pas certain que nous voulions vraiment le savoir. Si nous savons comment les pauvres meurent au Canada, cela conférera une responsabilité implicite qui ira des professionnels de la santé aux plus hauts échelons de la classe politique en passant par les ministères de la Santé. Je ne suis pas certain que nous voulions que le public prenne trop conscience de cette responsabilité. Nous aurons des décisions difficiles à prendre quant à l'utilisation de nos ressources. Devrions-nous les consacrer à construire d'énormes hôpitaux dotés de l'équipement le plus perfectionné, à coups de millions de dollars alors que nous ne répondons pas à un besoin beaucoup plus répandu, un besoin primordial, celui des soins communautaires et des soins à domicile? Je ne dis pas qu'il faille choisir entre l'un ou l'autre, mais nous risquons de nous orienter vers les gros établissements sans tenir compte des énormes souffrances qu'éprouvent les gens.
Lorsque les patients refusent un traitement, nous semblons croire qu'il n'y a pas de problèmes. Le patient est conscient, lucide et déterminé. Néanmoins, lorsque des patients qui s'expriment clairement, qui sont pleinement conscients et stables, jeunes et beaux par-dessus le marché, refusent des traitements qui prolongeraient leur vie, le personnel clinique qui s'est attaché à eux trouve parfois cela extrêmement difficile. Le cas de Nancy B., au Québec, en 1990-1991, en est un bon exemple.
Il y a aussi le cas où les inconvénients du traitement sont disproportionnés par rapport à ses avantages. Je n'ai pas le temps de citer de nombreux exemples, mais tout ce que je vous dis est le résultat de 23 ans de travail au chevet des patients, surtout au service des soins intensifs, au service de traumatologie ou dans le service des grands brûlés. Prenez l'exemple d'une femme âgée de 84 ans, qui présente un cas avancé de la maladie de Parkinson, de démence sénile du type Alzheimer et une pneumonie. Le traitement de sa pneumonie aux antibiotiques impose-t-il des inconvénients qui surpassent les avantages? C'est ce que nous pensions au début des années 80. La santé de cette patiente se dégradait, elle avait des escarres et elle n'était plus consciente de ce qui se passait autour d'elle. Elle n'avait aucune famille. Nous avons discuté de ce que nous devions faire pendant trois heures. Au cours de la discussion, un jeune médecin a dit que nous devrions lui administrer des antibiotiques pour traiter sa pneumonie. Je lui ai dit: «Vraiment? Sommes-nous dans un garage? Le carburateur ne fonctionne pas, nous allons donc réparer le carburateur. Il n'y a pas de moteur, pas de pistons, pas d'accu, pas de pneus, plus rien, mais nous allons réparer le carburateur? Nous devons examiner le patient tout entier. Nous ne sommes pas là pour soigner un poumon, mais pour traiter l'être humain.» Dans ce contexte, nous avons estimé qu'il serait cruel de soigner des pneumonies les unes après les autres, de traiter la biologie et d'oublier la personne. L'état de la patiente empirait. Elle ne pouvait déjà plus nous dire quoi que ce soit.
Lorsque les inconvénients l'emportent sur les avantages, nous ne pouvons pas codifier une série de petites règles qui vous diront exactement quoi faire dans chaque cas.
Vous devez porter un jugement fondé sur la réflexion et une longue expérience. Cela ne veut pas dire que vous ne commettrez pas d'erreurs ou que vous ne saurez pas exactement si vous avez bien agi ou non. Cela fait partie des soins aux personnes gravement malades. Vous n'êtes pas toujours certain d'agir comme il le faudrait.
Lorsqu'il est évident que le traitement sera inutile, il arrive parfois que vous pompiez du sang dans des gens qui continuent de saigner. C'est comme un robinet dont l'eau coule directement dans le drain sans que vous puissiez l'arrêter. Vous pourriez toutefois stabiliser le patient pendant suffisamment de temps pour qu'il réalise ses objectifs, comme on l'a fait pour un homme qui revenait constamment recevoir des transfusions au fur et à mesure que ses périodes de rémission raccourcissaient. Le personnel infirmier reprochait au médecin de faire ces transfusions, mais le médecin répondait: «Je ne l'oblige pas à revenir ici. Il revient de son propre gré. Il a quelque chose à terminer.» Cet homme est revenu pour la dernière fois, avec sa valise et accompagné de sa femme, en disant: «Je suis venu mourir ici. Je ne veux plus de transfusions, je compte seulement sur vous pour assurer mon confort.» Que faisait-il? Il construisait une véranda autour d'une vieille maison québécoise et ne voulait pas mourir avant que cette véranda ne soit construite.
Les traitements lui ont permis d'atteindre son objectif. On n'a pas cherché à prolonger sa vie de façon injustifiée, par n'importe quel moyen. C'est bien entendu le contraire qui peut se produire lorsque nous insistons pour prolonger la vie alors qu'il ne le faudrait pas, lorsqu'il ne vaut plus la peine de vivre.
J'ai travaillé à un grand nombre de cas d'état végétatif, que l'on appelle «état végétatif persistant». Nous ne devrions jamais utiliser cette expression, mais on s'en sert même dans la documentation médicale, si bien que je le ferai. Il s'agit d'un état d'inconscience persistant ou permanent. Ce n'est pas le coma. Le coma est un profond sommeil sans période d'éveil. Dans le cas de l'état végétatif persistant, qui devient permanent après une période d'observation, la British Association of Physicians a recommandé une période d'observation de neuf à dix mois pour les patients présentant de graves lésions neurologiques. S'il n'y a aucun signe d'éveil au bout de neuf à dix mois et s'il y a des signes de détérioration cérébrale qu'il est possible d'évaluer neurologiquement, l'état végétatif persistant devient un état végétatif permanent. C'est alors, sinon plus tôt, qu'il faudrait décider de continuer ou non l'hydratation et l'alimentation artificielles d'une personne. Ce sont des décisions extrêmement difficiles à prendre.
J'ai connu deux cas où toute la famille a estimé, en accord avec les médecins et le personnel infirmier, que la principale question à se poser n'était pas: «Devrons-nous continuer au bout de dix mois?», mais «Devons-nous continuer?» C'était à ceux qui voulaient poursuivre le traitement qu'il revenait de justifier leur décision, mais personne ne voulait le poursuivre. Les parents, le mari et les enfants ont tous demandé que l'on cesse d'alimenter la patiente et cette dernière est morte au bout de trois jours environ.
Un an plus tard, j'étais dans un établissement où il y a un grand nombre de jeunes atteints d'un grave traumatisme neurologique; en fait, ils sont tous dans un état végétatif permanent. Les familles viennent visiter leurs parents et rendent ensuite visite aux autres familles. Vous avez là tout un groupe de patients en état végétatif et leurs familles. À un moment donné, une des familles a demandé s'il faudrait poursuivre l'hydratation et l'alimentation artificielles de son fils, mais personne ne savait ce qu'il y avait lieu de faire. Tout le monde était déchiré. Un des médecins qui me connaissait et connaissait la famille m'a demandé de venir le voir pour discuter du cas. Avant que je me rende dans l'établissement, des rumeurs ont commencé à circuler selon lesquelles j'allais venir tout arrêter et tuer ce garçon. Je ne le savais pas. Je suis allé là-bas, nous avons longuement discuté et j'ai ensuite commencé à recevoir des nouvelles du personnel infirmier et des autres personnes qui travaillaient dans l'établissement. Nous nous sommes tous rendu compte que, dans les circonstances, nous ne pouvions pas arrêter l'alimentation et l'hydratation artificielles, car dans les circonstances, cela aurait eu l'effet d'une bombe. Ce garçon est mort d'un arrêt total de ses fonctions vitales six mois plus tard.
Vous devez prendre ce genre de décision en tenant compte de la situation dans son ensemble. C'est ce qui ressort du programme que nous avons lancé il y a environ cinq ou six ans en développant une «éthique de la complexité». On ne veut pas réduire ce genre d'éthique à quelques règles et quelques principes.
C'est une des dernières questions dont je parlerai brièvement. Lorsque l'angoisse ou la douleur est trop intense, il faut que tout ce qui sert à l'atténuer, les médicaments, les dosages, la fréquence et la voie d'administration, visent à l'objectif fondamental qui est de maintenir, si possible, la personne en état de conscience pour qu'elle puisse réfléchir et parler librement. Si non, la douleur réduit totalement son espace mental au point de l'empêcher de penser à autre chose que la douleur et les symptômes qui l'accompagnent comme les vomissements, une fatigue excessive, etc. Il y a d'autres personnes qui peuvent seulement trouver le repos en perdant conscience.
Certaines personnes ont besoin de dormir avant de mourir. Lorsque je parle de «dormir» ce n'est pas un euphémisme qui signifie euthanasie. Elles ont besoin de dormir avant de mourir. Certaines peuvent être réveillées et rester éveillées un instant, mais d'autres pas. Voilà ce que je voulais dire au sujet de la douleur et de l'angoisse.
Je terminerai en formulant une recommandation en ce qui concerne la Commission de réforme du droit. En 1983, la Commission de réforme du droit du Canada a fait cinq recommandations visant à modifier le Code criminel. Deux d'entre elles préconisaient de ne pas décriminaliser ou légaliser l'euthanasie et l'aide au suicide.
La troisième, la quatrième et la cinquième recommandation disaient en substance que les articles 14, 45, 198, 199 et 229 du Code criminel du Canada ne devraient pas obliger un médecin -- c'est la troisième recommandation -- à continuer d'administrer ou à commencer un traitement médical à l'encontre des désirs exprimés par le patient; selon la recommandation 4, ces articles ne devraient pas obliger un médecin à continuer d'administrer ou à commencer un traitement médical si ce traitement est devenu inutile dans les circonstances et n'est pas dans l'intérêt du patient et, dans la recommandation 5, on demande que ces articles ne soient pas interprétés de façon à empêcher un médecin de donner des soins palliatifs ou à l'obliger de cesser d'administrer des soins palliatifs appropriés pour éliminer ou soulager les souffrances d'une personne, pour la seule raison que ces soins ou ces mesures risquent d'abréger sa vie, une probabilité qui est extrêmement exagérée dans l'esprit du profane.
William Kerr a, dans le New England Journal of Medicine, comparé ce document avec un volume de 600 pages publié par les États-Unis en soulignant sa beauté et sa simplicité. Il termine son article en disant que: «Les États de notre pays qui n'ont pas encore établi de normes d'éthique dans ce domaine feraient bien de s'inspirer de la sagesse avec laquelle la Commission de réforme du droit du Canada a examiné ces questions complexes.»
Les provinces ou même le gouvernement fédéral feraient bien, s'ils n'ont pas encore établi de normes d'éthique dans ce domaine, de s'inspirer de la sagesse avec laquelle la Commission de réforme du droit du Canada s'est penchée sur ces questions délicates. C'est David Roy qui vous le dit, et pas William Kerr.
Ces lignes directrices pour la modification du Code criminel laissent une large place au jugement clinique. C'est indispensable. La place ne sera pas faite à un jugement clinique adéquat à moins que nous n'organisions des cours et des recherches. Vous ne pouvez pas enseigner bien longtemps si vous ne faites pas de recherches. Les cours et la recherche sont nécessaires tant pour les soins palliatifs que pour la médecine palliative et l'éthique clinique des soins palliatifs et de la médecine palliative. En fait, ces cours n'existent pas de façon générale.
La présidente: Permettez-moi de poser la première question parce que je pense déceler une différence dans le témoignage de nos deux témoins et nous pouvons peut-être éclaircir cela avant d'aller plus loin. Madame Jarvis, vous avez dit qu'à votre avis, il n'était pas nécessaire de modifier les lois. Je vous rappelle que le rapport de 1995 a été rédigé en réponse au rapport de la Commission de réforme du droit qui préconisait une modification des lois. Le Dr Roy semble penser qu'effectivement, il faudrait modifier les lois. Comment concilier vos deux points de vue?
Mme Jarvis: La loi a été changée en ce qui concerne le traitement de la douleur. À certains égards, le Dr Roy et moi-même disons la même chose. Nous sommes d'accord pour dire qu'il faut toujours tenir compte de l'opposition risques-avantages. Selon moi, les analgésiques n'abrègent pas la vie. Point n'est besoin de modifier le Code criminel car les analgésiques n'abrègent pas la vie. Nous savons qu'il y a des risques considérables lorsqu'on administre la première dose mais cela est vrai dans le cas de quiconque va subir une chirurgie. Ce n'est pas spécifique aux soins palliatifs.
Un autre risque provient d'une augmentation trop rapide de la dose d'opioïdes et dans ce cas-là, c'est de l'ignorance. Je dis qu'il faut pouvoir compter sur du personnel bien formé capable de porter de bons jugements cliniques. Dans le cas des soins palliatifs, nous n'acceptons pas les effets secondaires des opioïdes comme un mal nécessaire. Nous n'acceptons pas cela car cela peut être très déplaisant. L'augmentation des doses d'opioïdes peut entraîner une crise cérébrale ou d'autres états déplaisants pour le patient. Nous voulons éviter cela.
Si on en arrive à ne plus pouvoir traiter la douleur -- mais je pense que les choses s'améliorent parce que nous faisons appel à divers agents --, alors il faut se tourner vers les sédatifs, avec la participation de tous les intéressés. Toutefois, faut-il une mesure législative qui reconnaisse que ces moyens abrègent effectivement la vie? Je n'en suis pas sûre. Quoique nous tentions de faire, les patients vont mourir et nous devons accepter cela.
La présidente: Je reprends l'expression «abréger la vie» -- car le Dr Mount, soit dit en passant, m'a écrit une lettre qui va dans le même sens de ce que vous avez dit, c'est-à-dire qu'il n'aime pas cette expression car il ne pense pas qu'elle soit encore applicable aujourd'hui. La semaine dernière, nous avons entendu le témoignage du Dr MacDonald, qui nous a dit qu'à cause d'un manque de formation, d'un manque de compétence et d'expérience dans le domaine, il estime toujours que les lois doivent être modifiées car la vaste majorité des médecins qui s'occupent de patients à l'agonie craignent de leur administrer des médicaments à cause des conséquences juridiques potentielles mais il ajoute qu'il existe un besoin pressant du côté de la connaissance et des compétences en la matière.
M. Roy: Les articles du Code criminel, dans leur version actuelle, et auxquelles la Commission de réforme du droit se reporte, pourraient effectivement être utilisés contre les médecins et il faudrait les modifier. Ils sont tout à fait périmés. Mais là n'est pas la question.
La question centrale est la suivante: de quelle façon devrait-on modifier les lois? Si les lois sont modifiées ponctuellement, pour gérer les choses ponctuellement, ces modifications vont faire plus de dégâts et causer plus d'inquiétude que si l'on maintenait la version actuelle de ces articles du Code criminel.
La Commission de réforme du droit a proposé de modifier ces articles en utilisant les énoncés que je viens de vous citer. Ce libellé est tout à fait général. Si l'on devient trop minutieux, on exige deux témoins, il y en a un qui doit signer ici, et l'autre médecin consultant sera appelé à signer ailleurs. Les mesures législatives qui prévoient une procédure détaillée n'arriveront jamais à couvrir la gamme infinie de situations qui peuvent se présenter.
Voilà pourquoi certaines propositions ont causé plus d'inquiétude chez les médecins que les articles actuels du Code criminel.
Il y a une autre raison pour que nous soyons très prudents si nous envisageons de modifier le Code criminel à cet égard. Je vous ai parlé tout à l'heure d'un consensus qui semble assez général en Amérique du Nord. Depuis quelques années, cette unanimité s'effrite aux États-Unis. En 1997, un médecin de l'État du Kansas a purgé 30 mois de prison parce qu'il avait donné un médicament contre la douleur à une vieille dame qui souffrait énormément du cancer et parce qu'il avait débranché l'appareil de survie respiratoire d'un homme âgé diabétique qui avait subi un accident cérébrovasculaire qui l'avait frappé d'incapacité. Au Canada, des décisions semblables prises dans un contexte clinique, avec les communications qui s'imposent entre le personnel soignant et la famille, n'aboutiraient absolument pas à des poursuites judiciaires.
Ce que nous avons entendu dire à Montréal est qu'il y avait eu de bien piètres communications entre la famille et le personnel soignant quand il s'est agi de débrancher le respirateur artificiel. Cela a entraîné de vives émotions et toutes sortes de difficultés.
Pour l'instant, les médecins américains ont tendance à restreindre l'ordonnance d'analgésiques car ils craignent d'être poursuivis en justice. Trente mois de prison, ce n'est pas une très bonne publicité pour un médecin. La tendance actuelle va dans le sens d'un système de pratique médicale et clinique doté de règles rigides quand il s'agit de médecine palliative ou de soins intensifs. Il ne faut pas fermer les yeux là-dessus car ce mouvement pourrait influencer les procédures canadiennes.
Toutes sortes de programmes éducatifs devront être mis en place, toutes sortes d'analyses sur la façon dont les soins à domicile devront être organisés et financés devront être effectuées et il ne faut donc pas, dans ce contexte, oublier que le Code criminel pourrait rendre très frileux les gens qui travaillent dans ces secteurs.
Le sénateur Beaudoin: Vos deux exposés m'ont beaucoup impressionné. Vous êtes allés au coeur du sujet. Le but de notre comité est très net. Nous voulons mettre en vigueur les éléments du rapport de 1995 sur lesquels les membres du comité étaient unanimes.
Docteur Roy, vous avez déjà comparu devant le comité et je me souviens très bien de ce que vous avez dit. La difficulté en ce qui nous concerne est de traduire les opinions unanimes en une mesure législative. Une des choses les plus difficiles du monde est de rédiger un texte législatif parfait.
Le Code criminel rend les choses encore plus difficiles car dans ce cas-là il nous faut être précis. La précision comporte le risque que la loi soit insuffisante après un certain temps.
Docteur Roy, vous avez parlé de l'affaire Nancy B. Je pense que c'était une bonne décision. Je ne vois pas d'inconvénient à ce que l'on interrompe ou on refuse un traitement de survie. Nous sommes tous d'accord là-dessus. Toutefois, la façon de transcrire les opinions que contient la décision Nancy B. dans nos lois m'inquiète. Vous semblez avoir un certain doute à l'égard des conséquences de l'affaire Nancy B. Pouvez-vous développer votre pensée?
M. Roy: Je ne vois absolument rien à redire à cette décision. À mon avis, c'est l'une des meilleures décisions de la jurisprudence canadienne. La seule autre qui ait le même pouvoir est la décision Stephen Dawson, de la Cour d'appel de la Colombie-Britannique dans les années 80. Dans cette affaire, le tribunal de première instance a voulu justifier la requête des parents portant que l'on interrompe tout traitement de Stephen, qui était infecté par la sonde utilisée pour traiter son hydrocéphalie. Il fallait retirer la sonde pour la nettoyer et en remettre une nouvelle. L'enfant aurait pu mourir. Le tribunal de première instance a convenu avec les parents que la vie du patient était misérable. Au palier suivant, la cour a obtenu un meilleur témoignage de médecins qui connaissaient Stephen personnellement. La cour a déterminé que la description de la vie de Stephen dans le premier cas ne correspondait pas à la réalité. La description qu'on avait faite était si misérable qu'en en lisant les détails, on se disait: «Qu'on le laisse aller.» Ceux qui connaissaient Stephen, toutefois, ont dit: «Non, il n'est pas si misérable que cela.»
J'ai rencontré Stephen 14 ans plus tard, lorsque je travaillais avec un autre médecin qui étudiait les bébés nés de mères ayant absorbé des drogues pendant leur grossesse. Ce médecin m'a amené voir Stephen qui avait environ 21 ans à ce moment-là. Il est vrai qu'il était aux prises avec de graves difficultés mentales. Toutefois, c'était un garçon affectueux. Il s'est approché de moi et, m'entourant de ses bras, il m'a fait un câlin. Il y a des gens qui voulaient faire croire à tout le monde que sa vie ne valait pas la peine d'être vécue. Ce jour-là, il regardait la télévision seul.
Nancy B. souffrait du syndrome Guillain-Barré, qui entraîne une paralysie totale. Elle ne pouvait rien faire seule. Elle ne pouvait même pas essuyer les gouttes de sueur qui tombaient de son front l'été. Par divers signaux, elle a signifié qu'elle voulait que l'on débranche son respirateur artificiel. Ses parents ont accepté. L'hôpital ne savait pas quoi faire. La commission d'éthique était partagée. Finalement, l'affaire a été entendue au tribunal. Le juge La Forest a expliqué dans son jugement que de débrancher le respirateur artificiel dans ce cas-là ne constituerait ni un homicide ni un suicide. Il a fait une distinction très claire entre les deux et s'en est référé aux documents de la Commission de la réforme du droit que je viens de citer. Il s'en est inspiré largement pour écrire son jugement. Je ne vois rien à redire à ce jugement. En fait, c'est un jugement qui a établi un précédent déontologique en médecine clinique, du moins au Québec.
Le sénateur Beaudoin: Ce qui est difficile, c'est de trouver le juste milieu entre ce que pensent les professionnels de la santé et ce que dit le Code criminel. Je suis d'accord avec vous pour dire qu'il faudrait s'en remettre dans une large mesure aux professionnels de la santé. Ces spécialistes devraient avoir une certaine latitude. Nous devons toutefois fixer des paramètres afin d'assurer la protection de tous. Voulez-vous dire qu'en cas de doute il faudrait pencher du côté des médecins et du personnel infirmier? Dois-je conclure que le Code criminel ne devrait pas trop intervenir, mais qu'il devrait simplement servir de garde-fou, puisque la situation évolue d'une année à l'autre? Elle n'est plus ce qu'elle était en 1995. Nous en sommes peut-être arrivés à d'autres conclusions depuis. Autrement dit, la polémique s'est engagée entre ceux qui disent: «Qu'on s'en remette aux tribunaux et aux médecins», et ceux qui disent plutôt: «Adoptons de bonnes lois et cherchons à trouver un équilibre entre ce que dit la loi et ce que pensent les professionnels de la santé».
M. Roy: Je ne suis pas avocat et je ne sais pas du tout comment on s'y prend pour rédiger les lois. Quelles modifications faudrait-il y apporter, et dans quel sens faudrait-il se diriger? Pardonnez-moi de citer encore une fois ce document, dont je me sers dans mes cours depuis près de 23 ans. Je m'en sers dans les cours d'éthique clinique que je donne au Canada et à l'étranger. Si on me disait que je n'avais que trois minutes pour répondre à la question «Dans quel sens devrions-nous nous diriger?», je dirais: «Suivez le sens proposé dans ce document.» Les principes qui y sont énoncés sont très simples, mais ils constituent des paramètres très clairs. Ils n'étouffent pas les familles et les professionnels qui sont appelés à prendre de ces décisions.
Les médecins ne sont pas les seuls à avoir leurs mots à dire. Dans le modèle judiciaire, la décision est prise par un juge ou par un organisme quasi officiel, comme un comité d'éthique. Selon le modèle familial, c'est la famille qui décide. Il y a aussi le modèle médical, où ce sont les médecins qui décident. Aucun de ces modèles ne suffit à lui seul. Ce qui se fait de plus en plus, et ce qui donne les meilleurs résultats, c'est que les médecins et le personnel infirmier, qui passent le plus de temps avec le patient, se réunissent pour prendre ces décisions. Ce modèle, quand il fonctionne, donne des résultats incomparables. Il ne fonctionne pas toujours, parce que, bien souvent, les familles sont divisées en deux camps. Dans certains cas, il faut s'adresser aux tribunaux -- et les tribunaux sont là pour cela.
Si nous pouvions modifier la loi pour tenir compte des recommandations unanimes du comité et pour y inclure aussi une disposition d'interprétation qui prévoirait qu'en temps normal, ces décisions devraient être prises par les médecins et le personnel clinique soignants, de concert avec la famille si le patient n'est pas conscient, et que les tribunaux n'interviendraient que dans le cas où on n'arriverait pas à s'entendre, ce serait déjà un progrès formidable. Il serait futile d'opter pour la microgestion par la voie législative.
Mme Jarvis: J'aimerais dire quelque chose au sujet de l'idée «d'abréger la vie» et des divergences d'opinions entre les docteurs Macdonald et Mount. Le manque d'éducation ne constitue pas une bonne raison de modifier le Code criminel, parce qu'il faut avoir certaines connaissances pour pouvoir administrer ces médicaments. Si le manque d'éducation persiste, nous ne nous en retrouverons pas mieux.
Je suis dans ce domaine depuis de nombreuses années. Je peux vous dire qu'il est très difficile de soulager un patient à l'aide d'un médicament destiné à calmer la douleur. Ces médicaments doivent être administrés par quelqu'un de compétent, sinon le résultat sera pire encore.
M. Roy: Il ne s'agit pas simplement d'administrer des médicaments -- et je sais que Mme Jarvis va confirmer ce que je dis. Bien souvent, la douleur -- et je pourrais vous citer une multitude de cas -- tient essentiellement à des troubles émotionnels non soulagés. Dans un cas, les médecins ne cessaient d'augmenter la dose de médicaments destinés à calmer la douleur. La pauvre patiente avait été abandonnée par son mari. Elle avait perdu sa beauté, elle avait perdu ses cheveux. Elle était gonflée par les stéroïdes. Elle savait qu'elle ne vivrait pas très longtemps. Le médecin, qui était sensible à son trouble, venait la voir tous les jours. Il lui apportait des petits cadeaux et ils sont peu à peu devenus amis. Son état a commencé à s'améliorer et, au bout de deux semaines, le médecin a pu réduire la dose d'analgésiques. Au bout de trois semaines, la patiente a pu se lever. Ce n'est là qu'un exemple parmi bien d'autres. On commet une grave erreur en pensant qu'il suffit d'administrer des médicaments pour soulager la douleur. Qui a le temps de nos jours de retourner voir un patient ou une patiente tous les jours pendant trois semaines? Les médecins sont déjà surchargés à cause des longues listes d'attente.
Comme vous pouvez le voir, le problème est complexe. On peut changer la loi, mais si on ne change pas toutes les autres choses, la loi ne sera qu'une belle mesure sur papier, qui n'aura aucun effet dans la pratique.
La présidente: Je voudrais bien préciser que je ne vois aucune espèce de conflit entre vous et le Dr Macdonald et le Dr Mount sur cette question.
Le sénateur Corbin: Monsieur Roy, je n'ai pas vraiment de question à vous poser à la suite de votre témoignage. Je suis tout à fait persuadé du bon sens de vos déclarations et de vos pratiques. Je voudrais toutefois obtenir un éclaircissement de Mme Jarvis. Vous avez fait allusion aux fabricants de médicaments et vous avez évoqué la possibilité de s'en remettre à eux. Pourriez-vous nous en dire un peu plus à ce sujet?
Mme Jarvis: Je constate, en tant que clinicienne, qu'on accorde très peu de temps au soulagement de la douleur dans le milieu professionnel. Je constate cependant que les fabricants de médicaments contribuent financièrement à des symposiums, ou des dîners-rencontres, où nous parlons de médicaments et de soulagement de la douleur. Il n'est pas du tout question dans ma description de poste du temps que je devrais consacrer à mon perfectionnement.
M. Roy: Mme Jarvis a raison. Les fabricants de médicaments ont mauvaise réputation dans bien des milieux. On s'imagine que leurs contributions s'accompagnent parfois de certaines conditions. Dans le domaine de la recherche médicale, il y a qu'à voir le cas du Dr Olivieri à Toronto, qui s'est révélé être un des pires fiascos que nous ayons connus depuis des années. Le cas est complexe. Dans bon nombre de domaines, il n'y aurait pas du tout d'éducation si ce n'était des fabricants de médicaments. En fait, nous n'aurions pas de séminaire, de symposium ni de colloque. Nous n'en aurions pas du tout.
Au lieu de lever le nez sur l'éducation financée par les fabricants de médicaments, il faudrait cesser de les critiquer si nous ne trouvons pas le moyen de financer publiquement cette éducation dans les hôpitaux, les cliniques, les unités de soins de longue durée et les écoles de médecine, car ils sont bien souvent les seuls à nous aider à ce chapitre.
Les médecins et les infirmiers et infirmières ne sont pas bêtes. La plupart s'en rendent compte quand on exerce des pressions sur eux pour qu'ils utilisent un médicament plutôt qu'un autre. Ce ne sont pas des enfants. Je ne dis pas qu'il n'est pas important, sur le plan éthique, d'être conscient de ces pressions, parce que c'est effectivement important. Nous vivons toutefois dans un monde complexe. Si on me demandait: «Préféreriez-vous que nous n'ayons pas du tout d'éducation, si nous n'arrivons pas à financer publiquement cette éducation, ou préférez-vous avoir une éducation dans le domaine de la médecine et des soins palliatifs qui serait financée par les fabricants de médicaments?», je dirais: «Je vais prendre l'éducation financée par les fabricants de médicaments.»
Mme Jarvis: C'est exactement la situation dans laquelle nous nous trouvons à l'heure actuelle. Dans le domaine des soins infirmiers, par exemple, nous n'avons pas du tout d'argent pour l'éducation. Nous devons nous adresser aux fabricants de médicaments pour pouvoir participer à des conférences ou à d'autres activités. Il n'y a pas d'argent dans les budgets des hôpitaux pour le perfectionnement du personnel infirmier.
M. Roy: Les fabricants de médicaments ne sont pas tous pareils. Certains d'entre eux en sont venus à penser qu'ils ont un rôle à jouer dans la société et dans la collectivité. Ils sont admirables. Il y a aussi les autres dont on pourrait parler, mais pas ici.
Le sénateur Corbin: Je tiens à vous remercier sincèrement d'être venus ici ce matin nous présenter ces témoignages. Ils nous seront très utiles.
Le sénateur Milne: Je suis nouvelle à ce comité. J'y suis pour la première fois aujourd'hui, mais je dois vous dire que les exposés que vous nous avez présentés ce matin étaient des plus convaincants et des plus éloquents. Votre témoignage m'amène à me poser certaines questions.
Le Dr Roy a demandé: comment est-ce de mourir chez soi? Comment est-ce de mourir quand on est pauvre? Voulons-nous vraiment le savoir? Y a-t-il quelque chose qui se fait? Y a-t-il des études qui sont en cours pour essayer de trouver des réponses à ces questions?
M. Roy: Pour ce qui est de savoir comment c'est de mourir quand on est pauvre, il y a trois ans environ, quand je travaillais auprès de gens de la rue dans le domaine du VIH/sida, je me suis dit que ce serait bien de mettre sur pied un programme de recherche-action, dont le volet recherche viserait simplement à recueillir assez d'information pour savoir comment structurer la prestation de soins à domicile. J'ai rédigé une lettre d'intention de quatre pages que j'ai adressée à une très puissante fondation canadienne. Après avoir évalué ma lettre d'intention, la fondation m'a invité avec d'autres personnes clés à un entretien personnel il y a environ un mois. Il est très rare qu'on fasse une invitation semblable, ce qui augure bien. Je dois remettre à la fondation une lettre d'intention plus détaillée d'ici à la fin avril. J'espère que nous pourrons en obtenir les fonds de démarrage nécessaires pour lancer ces travaux de recherche dans plusieurs grandes villes canadiennes et aussi dans des régions rurales, sur les conditions dans lesquelles les pauvres meurent. Nous voulons savoir ce qu'il en est.
Nous serons peut-être surpris. Il se peut que les pauvres meurent dans des conditions bien plus paisibles que les gens de la classe moyenne et les riches; nous ne le savons pas. Je ne crois toutefois pas que ce soit le cas. Quand nous saurons ce qu'il en est, nous aurons une bien meilleure idée de la façon dont nous pouvons mobiliser des gens comme Mme Jarvis et d'autres, dans toutes les régions du Canada, pour mettre en place des programmes de soins palliatifs qui répondent vraiment aux besoins.
On ne sait pas trop comment assurer ces soins aux familles pauvres et dysfonctionnelles. On ne peut pas tout simplement frapper à la porte et dire: «Avez-vous besoin d'aide?» Le cas des familles dysfonctionnelles est vraiment déroutant. Il existe une grande variété dans la pauvreté et le dysfonctionnement. Les troubles sont encore plus évidents quand les membres clés de la famille sont sur le point de mourir.
On sent qu'il y a un mouvement qui s'amorce. Le réseau international des soins de santé aux pauvres à l'OMS a rédigé récemment un éditorial qu'il a envoyé à tous les rédacteurs en chef des revues destinées au personnel infirmier et aux médecins, leur demandant de le publier. Je l'ai publié dans le Journal of Palliative Care, dont je suis le rédacteur en chef, et ce, depuis 16 ans, c'est-à-dire, depuis sa création. Nous avons publié un co-éditorial sur la pauvreté, sur les conditions dans lesquelles les pauvres meurent et sur le fait que nous ne semblons pas avoir d'éthique internationale en ce qui concerne la pauvreté dans le monde, sans parler de la pauvreté chez nous. L'avènement du nouveau millénaire semble avoir marqué le début d'une sensibilisation à ce problème. Les ouvrages sur la pauvreté se multiplient à un rythme incroyable, et le phénomène y est abordé non seulement sur le plan sociologique, mais aussi sur le plan médical -- c'est-à-dire dans l'optique d'une éthique sociale générale, voire mondiale.
Vous avez demandé s'il se passait quelque chose? Je crois qu'on voit là le germe de ce qui pourrait devenir des activités très importantes.
La présidente: Je crois que Mme Jarvis voudrait intervenir.
Le sénateur Milne: Je voulais simplement revenir à quelque chose qu'a dit le Dr Roy, mais je vous en prie, allez-y, madame Jarvis.
Mme Javis: En ce qui concerne les différences entre la classe moyenne et les pauvres, ici même à Ottawa, dans notre établissement, les patients qui n'ont pas d'assurance ne peuvent pas mourir chez eux. Il faut avoir une assurance privée pour avoir droit à des soins infirmiers 24 heures sur 24. Les soins à domicile se limitent à 40 heures, c'est-à-dire à un relais par jour. Cette situation occasionne un coût caché pour notre société, en ce sens que les membres de la famille du patient doivent souvent quitter leur travail pour assurer à leurs êtres chers les soins à domicile dont ils ont besoin. C'est là un coût dont on ne tient jamais compte.
Nous avons aussi un problème en ce qui a trait à la disponibilité des médicaments. Il est souvent possible d'obtenir des médicaments à l'hôpital, mais quand le patient retourne chez lui, ses médicaments ne sont pas couverts par le Programme de médicaments gratuits de l'Ontario et nos patients se trouvent à payer des milliers de dollars par semaine s'ils choisissent de continuer à prendre le médicament qui soulage un peu leur douleur.
Le sénateur Milne: Nous savons tous quels sont les membres de la famille qui quittent généralement leur travail pour rester à la maison.
Docteur Roy, vous avez parlé de ce consensus au sujet du traitement qui se dégage depuis plus de vingt ans et du fait qu'on semble maintenant s'en éloigner aux États-Unis et au Canada. Pourquoi y a-t-il si peu de jeunes qui puissent aider à maintenir le consensus, qui puissent remplacer la population vieillissante qui, d'après ce que vous dites, découvrent la valeur des cours d'éthique et des approches consensuelles? Pourquoi n'y a-t-il pas de relève?
M. Roy: Je crois qu'il y a des jeunes qui s'intéressent à l'éthique, mais je ne suis pas tellement sûr qu'ils soient aussi prêts à se salir les mains sur le plan affectif, c'est-à-dire à descendre dans l'arène des émotions, comme les combattants de la première heure aux États-Unis, au Canada, au Royaume-Uni et, dans une certaine mesure, en Europe. La nouvelle génération semble plus intéressée par la rédaction de documents plus nobles, si on veut.
En d'autres termes, on semble maintenant préférer planer dans les hautes sphères de la recherche clinique, médicale et bioéthique. Nous avons besoin de ces études théoriques, mais les médecins et le personnel infirmier en pratique clinique doivent pouvoir se libérer de leur pratique professionnelle -- comme l'infirmière psychiatrique qui voudrait continuer à exercer son métier mais qui devrait aussi pouvoir s'occuper de l'éthique des soins infirmiers ou comme le médecin qui voudrait continuer à travailler tant d'heures par semaine aux soins intensifs mais qui devrait aussi pouvoir passer tant d'heures par semaine à s'occuper d'éthique clinique. C'est un modèle qui, jusqu'à maintenant, n'a pas fonctionné très bien, pour des raisons économiques, pour des raisons de rémunération.
Certains médecins et certains infirmiers et infirmières ont entrepris une formation spéciale en éthique clinique, mais ils ne sont pas très nombreux. Ceux qui n'ont aucune formation en médecine ou en soins infirmiers et qui s'intéressent à l'éthique clinique et médicale sont plutôt rares, car il leur faut une formation scientifique suffisante pour pouvoir comprendre le monde de la médecine et des soins infirmiers. Ils ont plutôt tendance à s'en aller du côté théorique. Ils discutent des mêmes questions dont nous discutons ici aujourd'hui, mais d'un point de vue très philosophique et savant.
On en trouve beaucoup qui s'intéressent à l'éthique médicale et clinique dans les milieux universitaires, mais nous n'en avons pas beaucoup sur le terrain qui font du travail de consultation clinique. Ce n'est d'ailleurs pas une profession reconnue. J'ai fait des centaines de consultations au cours des 20 dernières années, mais je n'ai jamais accepté la moindre rémunération. Je n'avais pas besoin d'être rémunéré parce que je dirigeais un laboratoire de recherche dans un institut de recherche clinique et que je pouvais prendre le temps de faire ces consultations, mais mon cas était exceptionnel.
Les bioéthiciens qui enseignent à l'université voient leurs classes grossirent de plus en plus au fur et à mesure qu'on réduit le nombre de professeurs. Ils ont tellement de travaux à corriger et il leur est très difficile de laisser leur poste pour se rendre à l'autre bout de la ville faire une consultation en clinique.
Il s'agit d'une question complexe à laquelle il n'y a pas de réponse simple. Nous devons trouver des moyens novateurs d'attirer les jeunes dans ce domaine.
La présidente: Pendant que vous parliez, je pensais à Mme Jarvis; cela me rappelle toute cette question du choix qu'on doit faire dans les milieux universitaires entre «publier ou mourir», ou du choix entre «enseigner ou faire de la recherche» ou entre «la pratique et la recherche» ou encore entre «les soins infirmiers de chevet et les soins infirmiers administratifs».
Comment pouvons-nous effectuer ce virage dans les soins infirmiers, par exemple? Il me semble que l'infirmière spécialisée dans les soins palliatifs est la seule dont on peut encore dire qu'elle est «infirmière de chevet». De nos jours, les étudiants qui entrent en soins infirmiers font quatre ou cinq ans d'études dans un établissement d'enseignement. Puis, on leur dit que leur travail, ce n'est pas vraiment de dispenser des soins de chevet, mais d'accomplir des fonctions administratives. Comment pouvons-nous changer la vapeur? Devrions-nous changer la vapeur?
Mme Jarvis: Il s'agit là d'une question importante mais à laquelle il est très difficile de répondre. Les soins infirmiers ont changé au fil des ans avec notamment le vieillissement de la population. Sur le plan des soins palliatifs, il est absolument essentiel pour les Canadiens d'avoir des infirmiers et infirmières qui aient reçu une bonne formation en soins palliatifs. Pour exercer mes fonctions d'expert-conseil en soins palliatifs, j'ai eu besoin d'un important bagage de connaissances. Je ne pourrais pas acquérir ces connaissances en travaillant simplement comme infirmière de chevet. Je ne dispense pas de soins de chevet, même si je suis souvent au chevet de patients, beaucoup trop souvent, aux dires de ma famille.
Il faut commencer par les universités. J'ai l'air de rabâcher toujours la même chose. Je ne cesse de demander pourquoi on ne pourrait pas mettre sur pied un cours de formation pour apprendre à des gens comme moi-même à donner des soins palliatifs. Ensuite, nous pourrons former d'autres personnes. Nous pourrons former les infirmiers et infirmières de chevet à avoir de meilleures compétences et à mieux comprendre leur travail. Nous nous noyons dans des titres et des théories pompeux. Je crois qu'on perd de vue l'essence des soins aux patients aux échelons supérieurs de l'enseignement des soins infirmiers.
M. Roy: Nous ne devons pas oublier où nous nous situons dans le temps. Nous venons de terminer un millénaire et d'entrer dans le nouveau. Avec les répercussions de la mondialisation financière et économique, les temps sont devenus très difficiles depuis quatre ou cinq ans. Les gouvernements et les régimes de soins de santé du monde entier ont été touchés par des contraintes et des restrictions budgétaires. On a commis de nombreuses erreurs de jugement dans bien des endroits, comme au Québec, en octroyant la possibilité de prendre une retraite anticipée à des médecins et des infirmières ou infirmiers éminemment qualifiés. Nous en avons perdu des milliers à cause de la «Rochon-isation» du système. C'est Rochon qui était le ministre à l'époque. Il n'est pas le seul coupable, mais les résultats de cette décision sont épouvantables.
Les infirmiers et infirmières sont complètement épuisés et surchargés de travail. Cela se traduit par les mots clés «démoralisation» et «démotivation». On ne peut pas s'attendre à des soins de chevet de grande classe quand on se contente de proposer de nouvelles idées, alors que le personnel est démoralisé, démotivé, épuisé et qu'il se bat avec toutes sortes de difficultés. Rien ne s'améliore, la situation ne fait qu'empirer.
Nous allons fermer des milliers de lits cet été quand les infirmiers et infirmières et les techniciens de laboratoire vont partir en vacances. Il y a un arriéré de milliers d'échantillons sanguins qui attendent d'être testés. Les patients attendent pendant quatre ou cinq mois les résultats de tests importants et, dans certains cas, quatre ou cinq mois pour un traitement radiologique. Certains d'entre eux partent se faire traiter aux États-Unis s'ils en ont les moyens.
Je sais que vous avez déjà entendu tout cela, mais il faut tenir compte de ce contexte dans vos débats. Le contexte n'était pas le même en 1990, et j'espère qu'il ne sera plus le même dans trois ans, mais c'est la réalité actuellement. Certaines des réponses à vos questions seront fatalement pessimistes ou négatives ou évasives, mais il y a beaucoup de dirigeants jeunes et moins jeunes qui sont prêts à élever la voix pour dire que cela suffit. Peut-être faudrait-il que nous exigions publiquement la démission des ministres de la Santé. À un moment donné, nous allons devoir monter sur les barricades, et ce moment approche.
Le sénateur Beaudoin: Vous avez parlé du rapport de la Commission de réforme du droit. J'ai une profonde admiration pour cette commission. Je connaissais plusieurs des commissaires, notamment le juge en chef du Canada et le juge Jean-Louis Beaudoin.
Est-ce que ces conclusions sont encore valables? Certains ont modifié leur point de vue. Je me souviens par exemple de l'affaire Sue Rodriguez, une affaire d'aide au suicide, bien que ce ne soit pas notre préoccupation ici. À votre avis, ce rapport de 1983 ou 1984 est-il toujours valable ou faudrait-il le mettre à jour?
M. Roy: Non, il est toujours valable. Vous voulez peut-être y réfléchir et demander à d'autres personnes s'il faut y ajouter quelque chose, mais ces cinq grandes lignes fondamentales demeurent à mon avis nos principes directeurs comme ils l'étaient à l'époque. Il ne faut pas modifier les deux recommandations concernant l'aide au suicide assisté ou l'euthanasie. Les trois autres points couvrent exactement les sujets dont nous parlons aujourd'hui, pratiquement 20 ans après.
Le sénateur Beaudoin: C'est pour cela que je posais la question.
M. Roy: Je les conserverais tels quels.
Le sénateur Beaudoin: J'estime aussi que ces arguments sont parfaitement judicieux. L'autre jour, certains médecins nous ont dit que nous ne devrions pas légiférer autant. D'autres disent que nous devrions mettre en application les cinq points de ce rapport sur la réforme du droit. Je n'ai aucune objection à cela.
Quoi qu'il en soit, vous avez répondu à ma question; vous avez dit que ce rapport était toujours valable.
Le sénateur Corbin: Je crois que le conflit entre le droit et l'éthique professionnelle, c'est vraiment l'histoire du serpent qui se mord la queue. Il y a d'une part la maxime générale qui dit que l'on ne doit pas tuer; cela s'applique à tout le monde, la guerre étant peut-être l'exception à cette règle. Je n'ai pas envie de voir des policiers, des législateurs, des jurys, des juges et peut-être même le coroner au chevet des mourants. Autrement dit, je fais confiance au professionnalisme, qu'il s'agisse de celui du personnel infirmier, des médecins ou de tous les intervenants de ce domaine en général.
Vous avez parlé de la tentation peut-être exagérée de légiférer dans le détail pour préciser exactement tout ce qui est autorisé ou interdit en termes de soins palliatifs et de traitements des personnes en phase terminale. Auriez-vous un dernier commentaire à ajouter à ce que vous nous avez déjà dit?
M. Roy: Vous avez parlé de «faire la police». Il y a un certain nombre d'années, lors de la célèbre affaire Baby Doe, les États-Unis ont créé ce que l'on a appelé les équipes volantes. Dès qu'il y avait un appel d'urgence, ces équipes se précipitaient pour voir si l'on s'occupait bien des bébés dans les unités de soins intensifs ou si on les laissait mourir faute de soins. Cela a été une bourde épouvantable comme seuls les Américains peuvent en commettre, et cela n'a pas duré. En gros, ça consistait à mettre des policiers à côté des lits.
Le seul moyen de maintenir correctement la proposition de la Commission de réforme du droit visant à ne pas criminaliser l'euthanasie et l'aide au suicide, c'est d'avoir assez de bon sens pour savoir quand on ne doit pas appliquer la loi. Dans certaines circonstances, nous sommes amenés à la frontière entre l'éthique et le droit, lorsqu'il devient très difficile de faire la distinction entre l'administration de doses très fortes d'un médicament et l'euthanasie. Comme le disait un célèbre juriste belge, il faut maintenir la loi interdisant l'euthanasie, en sachant quand on ne doit pas l'appliquer ou quand on ne doit pas l'appliquer intégralement. Si nous ne sommes pas sensibilisés à la complexité qui caractérise la vie humaine dans ces circonstances, nous basculerons dans un extrême ou un autre. Il n'y en a pas que deux. Vous en avez signalé un, et je suis tout à fait d'accord avec vous. Je ne me préoccupe pas tellement de l'idée d'avoir des équipes d'enquêteurs et des soi-disant policiers chargés de faire respecter l'éthique au chevet des mourants, car cela ne marcherait pas et cela ne durerait pas bien longtemps.
M. Jarvis: Je suis bien d'accord.
Le président: Quand j'ai proposé au Sénat du Canada de revoir nos recommandations unanimes du rapport de 1995, je l'ai fait parce que je pensais que les Canadiens voulaient de nouveau écouter des témoins comme vous. Merci beaucoup pour votre intervention de ce matin.
Honorables sénateurs, le ministre de la Santé ne pourra pas venir nous rencontrer lundi prochain. Nous le verrons plus tard, à une date qui n'a pas encore été fixée.
Notre prochaine réunion est fixée à mardi prochain 9 heures. Ce sera une réunion à huis clos. Nous commencerons la rédaction. Même si nous n'avons pas de nouvelles du ministre, je pense qu'il est important de délimiter les paramètres de notre ébauche de rapport. Vous recevrez les documents dans deux communiqués distincts. J'ai dit clairement qu'il n'était pas question de sortir quoi que ce soit qui ne sera pas dans les deux langues officielles. L'un des documents sera prêt demain et vous sera distribué. L'autre ne sera pas prêt avant lundi, malheureusement, et il vous sera alors distribué. Nous commencerons notre ébauche mardi, et vous aurez, je l'espère, les deux documents en fin de journée lundi.
Le sénateur Corbin: Je me demande si nous aurons assez de temps pour examiner le texte français avant la réunion si nous l'avons seulement lundi. Comment pensez-vous procéder lors de cette réunion?
La présidente: Vous allez recevoir, plus tard aujourd'hui ou demain, l'ébauche d'un plan que nous voulons que nos attachés de recherche suivent. C'est peut-être tout ce que nous ferons à notre réunion de mardi. Plus tard, vous recevrez de la documentation de fond sur les recommandations que nous pourrions formuler ou nous abstenir de formuler. Je ne suis même pas persuadée que nous en serons rendus là mardi prochain. Nous vous transmettrons l'information le plus rapidement possible et ce, dans les deux langues officielles.
Le sénateur Beaudoin: Après le ministre de la Santé, entendrons-nous d'autres témoins?
La présidente: Nous avons terminé d'entendre des témoins, sauf le ministre de la Santé. Après son témoignage, nous pourrons apporter des modifications au texte, au moment approprié.
La séance est levée.