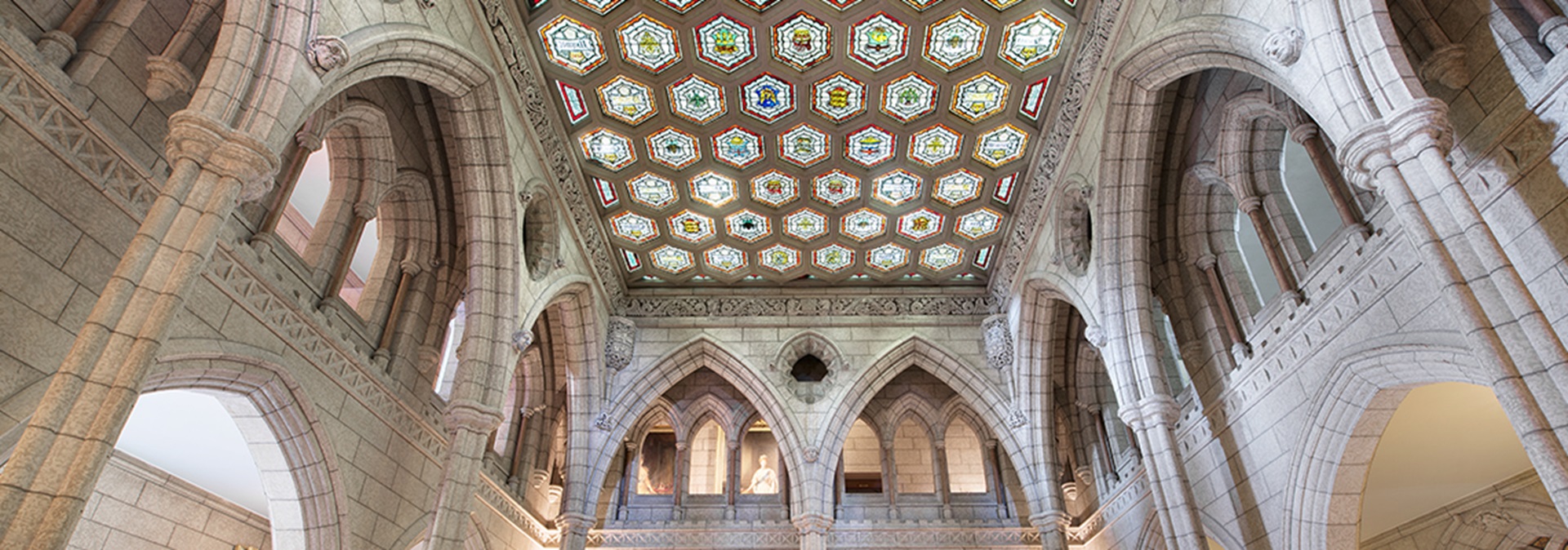Délibérations du sous-comité de
mise à jour de «De la vie et de la mort»
Fascicule 3 - Témoignages
OTTAWA, le mardi 22 février 2000
Le sous-comité de mise à jour de «De la vie et de la mort» du Comité sénatorial permanent des affaires sociales, des sciences et de la technologie se réunit ce jour à 9 h 08 pour examiner les faits nouveaux survenus depuis le dépôt, en juin 1995, du rapport final du Comité sénatorial social sur l'euthanasie et l'aide au suicide intitulé «De la vie et de la mort».
Le sénateur Sharon Carstairs (présidente) occupe le fauteuil.
[Traduction]
La présidente: Nous tenons aujourd'hui notre troisième audience en vertu de notre mandat portant sur la mise à jour des recommandations unanimes du rapport du comité sénatorial spécial sur l'euthanasie et l'aide au suicide publié en 1995 sous le titre «De la vie et de la mort». Je rappelle aux honorables sénateurs et, plus particulièrement, aux témoins, que le comité n'ouvre pas à nouveau le débat sur l'aide au suicide et l'euthanasie. Il s'occupe exclusivement des parties du rapport dans lequel ce comité avait présenté des recommandations unanimes. Je demande à tout le monde d'en tenir compte dans la suite de nos délibérations.
Nous recevons aujourd'hui cinq témoins qui ont été invités à nous parler des soins palliatifs: le Dr Michel Brazeau, qui est accompagné du Dr Henry Dinsdale, le Dr Gordon Crelinsten, Sharon Shlozberg-Gray, Jeff Poston et Mme Sharon Nield.
Dr Michel Brazeau, directeur général, Collège Royal des médecins et chirurgiens: Madame la présidente, je vous remercie de votre invitation. Médecin microbiologiste infectiologue, je suis directeur général du Collège Royal des médecins et chirurgiens du Canada. Je ne suis pas expert en éthique médicale. Je suis toutefois accompagné du Dr Henry Dinsdale, ancien président-directeur général du Collège Royal des médecins et chirurgiens du Canada et également ancien président du Conseil national d'éthique en recherche sur l'humain. Je le considère comme tout à fait expert en matière d'éthique. Il est ici pour m'aider à répondre à vos questions.
J'ai l'intention de vous parler d'abord brièvement du Collège Royal. Je ne perds jamais une occasion de le faire. Je passerai ensuite à des déclarations générales sur les questions dont nous sommes saisis et je continuerai en faisant des commentaires précis au sujet des chapitres des recommandations précédentes.
Le Collège Royal des médecins et chirurgiens du Canada est une organisation composée de 32 000 médecins spécialistes vouée à l'établissement de normes élevées et à la qualité des soins de santé. Le collège agrée les programmes de formation en médecine spécialisée dans les 16 facultés de médecine du Canada. Il émet aussi des certificats de spécialité et de sur-spécialité dans 53 disciplines et organise deux programmes spéciaux, dont un en médecine palliative.
Je vous signalerai immédiatement que j'ai fourni le texte de mon mémoire, des documents au sujet du collège ainsi que des documents qu'il a publiés depuis 1995 sur les questions dont vous êtes saisis. Il y a aussi plusieurs extraits de nos annales de l'automne 1999 qui portent spécifiquement sur la bioéthique pour les cliniciens.
Le collège a commencé récemment à s'intéresser beaucoup plus activement à l'organisation et à la prestation des services de soins de santé. Il se rend compte qu'il ne peut pas établir les normes en matière de formation des médecins spécialistes sans participer très directement à définir la nature du contexte dans lequel ils travaillent. Nous sommes convaincus que nous nous trouvons dans une période de renouvellement en profondeur du système de soins de santé du Canada, qui prendra quelques années. Nous ne nous contentons pas de réparer ce système.
Pour devenir et rester associés du Collège Royal, les détenteurs de nos certificats doivent assurer leur perfectionnement, le démontrer publiquement et s'engager à respecter les normes de comportement professionnel les plus élevées. Les cotisations annuelles que versent nos membres et les remarquables contributions bénévoles de plus de 1 500 d'entre eux, pendant jusqu'à 40 jours par an, permettent au collège de s'acquitter de sa mission, qui porte en grande partie sur l'éducation.
Comme beaucoup d'autres collèges de ce type le constatent dans le monde entier, nous devons maintenant nous intéresser à nouveau à un aspect fondamental de notre rôle et comprendre que l'éthique est une partie importante de notre comportement professionnel.
Le Collège Royal a adopté le code de déontologie de nos collègues de l'Association médicale canadienne, qui énonce les règles et les principes applicables à chacun de nos membres dans ses activités professionnelles. Toutefois, notre comité de bioéthique médicale et les administrateurs du collège étudient actuellement les questions d'éthiques qui deviennent d'actualité, notamment les responsabilités collectives des médecins, du public et des gouvernements dans le cadre du contrat social qui nous lie tous. L'organisation des services de soins de santé au Canada se prête à l'étude de cette question.
Est-il nécessaire de rappeler combien nos perceptions ont changé entre 1990 et 2000? En 1990, on mettait l'accent sur le nombre excessif de médecins et d'infirmières et la surutilisation du système. Aujourd'hui, on s'intéresse aux pénuries de médecins et d'infirmières et à la sous-utilisation potentielle des services de soins de santé découlant de l'accès plus limité à ces derniers -- ce sont là deux importantes sources de préoccupation pour la population.
Depuis 1996, le Collège Royal établit une nette distinction entre les compétences générales des médecins spécialistes et celles qui sont propres à chaque spécialité. Notre projet CanMEDS 2000 définit les compétences de base des médecins spécialistes du Canada: chacun doit être un expert médical, un communicateur, un collaborateur, un gestionnaire, un promoteur de la santé, un chercheur et un professionnel. C'est la mise en valeur de ce dernier rôle qui permet aux médecins spécialistes de faire face aux dilemmes moraux auxquels ils sont confrontés tous les jours. Les objectifs de formation propres à chaque spécialité fournissent à ces médecins les compétences dont ils ont besoin, par exemple pour utiliser dans les meilleures conditions l'arsenal actuel de thérapeutiques modernes permettant de soulager la douleur.
Je ferai un dernier commentaire général. Le Collège Royal est convaincu que les Instituts de recherche en santé du Canada doivent jouer un rôle clé dans l'étude de nombre de ces questions.
Nous allons maintenant passer en revue certains des chapitres contenant les recommandations présentées en juin 1995.
Premièrement, nous vous remercions de nous donner l'occasion d'attirer votre attention sur le nouveau programme de formation complémentaire en soins palliatifs qui est conjointement accrédité par le Collège des médecins de famille du Canada et le Collège Royal des médecins et chirurgiens du Canada. Les normes d'accréditation de ces programmes sont jointes en annexe à vos documents. Le Collège Royal a déjà approuvé quatre programmes qui sont dispensés à l'Université d'Alberta, à l'Université du Manitoba, à l'Université McGill et à l'Université Laval. Les demandes présentées par l'université McMaster, l'Université d'Ottawa et l'Université de Montréal sont présentement à l'étude.
Malheureusement, ces programmes de formation en médecine palliative ne bénéficient pas, jusqu'à présent, du financement nécessaire. De plus, l'infrastructure et les moyens permettant de fournir des soins palliatifs adéquats, d'assurer la formation d'un nombre suffisant de professionnels de la santé, d'informer la population et d'effectuer les recherches requises font cruellement défaut. La population, vieillissante, a de plus en plus besoin de soins palliatifs. L'incidence du cancer augmente, et de nombreux autres facteurs nécessitent aussi un accès accru aux services de soins palliatifs. Il faut prolonger la période pendant laquelle ces services sont fournis aux patients. Il ne suffit pas d'intervenir seulement au moment où quelqu'un va mourir.
Je voudrais profiter de cette occasion pour vous donner une idée de ce que pensent certains de nos membres des soins palliatifs et de la situation actuelle. Je citerai d'abord ce qu'a dit le Dr John Seely à propos de la recommandation selon laquelle les gouvernements devraient accorder une grande priorité aux programmes de soins palliatifs dans la restructuration du système de santé.
Les gouvernements fédéral ou provinciaux n'ont absolument rien fait pour régler cette question. Pour autant que je sache, il n'existe aucune stratégie nationale sur les soins palliatifs ou ceux qui sont fournis aux termes de la vie, et aucune province n'a cherché à faire des programmes de soins palliatifs une de ses priorités principales.
Il est peut-être bon d'ajouter qu'il y aura vraisemblablement une forte augmentation de la demande de soins palliatifs et de soins pour les personnes en fin de vie dans les années à venir, et ce pour plusieurs raisons: l'augmentation du nombre de personnes âgées (en termes absolus aussi bien qu'en proportion de la population), l'augmentation de la prévalence du cancer et les recours plus fréquents aux soins palliatifs pour les victimes d'autres maladies (p. ex. défaillance terminale d'un organe, sclérose latérale amyotrophique, sida et patients qui refusent de continuer la dialyse). Par ailleurs, toutes les études que je connais ont montré qu'on ne répond pas aux importants besoins concernant le soulagement de la douleur et des symptômes chez les patients en phase terminale dans les établissements dispensant des soins actifs, à long terme ou pour malades chroniques ou encore ambulatoires, sans oublier les besoins psychosociaux, affectifs et spirituels qui sont négligés.
Les services modernes de soins palliatifs sont nés en Grande-Bretagne en 1967. D'après nombre d'éminents spécialistes canadiens, nos confrères américains ont largement rattrapé leur retard initial et sont un excellent exemple de ce qu'on peut faire avec de la détermination et des moyens appropriés. Suivons leurs traces.
Un accès adéquat à des soins palliatifs de qualité aurait des répercussions positives sur plusieurs des autres questions abordées dans le rapport du sous-comité sénatorial. Nous sommes d'avis que les cinq recommandations rédigées en 1995 au sujet de la médecine palliative restent très valables et sont plus que jamais applicables.
Le chapitre 4 concerne les traitements de la douleur et la sédation. Le rapport de 1995 reconnaît qu'il est légal d'administrer un traitement visant à soulager la douleur et les souffrances au risque d'abréger la vie. Par ailleurs, le rapport recommandait de clarifier les dispositions correspondantes du Code criminel. À notre avis, l'accent doit être mis sur l'information et l'éducation plutôt que sur une modification du Code criminel.
La deuxième et la quatrième recommandations de ce chapitre proposaient à Santé Canada d'élaborer les lignes directrices et les normes sur l'administration de traitements visant à atténuer la douleur et susceptibles d'abréger la vie, ainsi que sur la pratique de la sédation complète des patients. Ce travail devait se faire en collaboration avec les provinces, les territoires et les associations nationales de professionnels de la santé. Le collège recommande de reconsidérer cette question. L'appui de Santé Canada est certes essentiel, mais ce sont les associations professionnelles qui ont des rapports avec la population qui devraient assumer principalement la responsabilité de ces initiatives.
Pour ce qui est de la troisième recommandation de ce chapitre, qui porte sur l'éducation et la formation en matière de traitement de la douleur, le Collège Royal reconnaît sa propre responsabilité en la matière. Il utilisera donc les puissants moyens dont il dispose pour l'accréditation, la certification et le perfectionnement des spécialistes. Nos discussions mettront particulièrement l'accent sur l'intégration des meilleures connaissances des lois régissant la prestation des soins de santé dans nos objectifs d'éducation.
Le chapitre 5 concerne l'abstention et l'interruption de traitement de survie. Vu l'expérience clinique des cinq dernières années, une modification du Code criminel est peut-être bien moins nécessaire qu'on ne le pensait auparavant. Les équipes spécialisées sont probablement mieux en mesure d'analyser chaque situation, de prendre des décisions et d'appliquer les mesures appropriées. Aujourd'hui, les communications avec les patients et leurs familles sont plus directes et plus ouvertes. Un meilleur accès aux conseillers en éthique aide beaucoup les prestataires de soins dans leur travail. Nous répétons notre commentaire précédent sur la participation de Santé Canada à l'élaboration des lignes directrices cliniques.
Pour ce qui est du chapitre 7, sur l'aide au suicide, la majorité des recommandations nous paraissent encore valables et il faudrait leur donner suite.
Le chapitre 8 concerne l'euthanasie. Le Collège Royal considère les recommandations de 1995 encore valables, sauf peut-être celles qui demandent qu'on modifie le Code criminel. Même si cette question prête manifestement à controverse, les spécialistes médicaux que nous avons consultés sont d'avis qu'une telle modification ne paraît pas véritablement nécessaire pour le moment.
En conclusion, la mise en oeuvre des recommandations de 1995 sur les soins palliatifs doit rester hautement prioritaire pour tous. Le Collège Royal reste déterminé à améliorer la qualité de la formation des médecins spécialistes pour ce qui a trait aux questions couvertes dans votre document.
La présidente: Merci.
M. Jeff Poston, directeur général, Association des pharmaciens du Canada: Je vous remercie de cette occasion de comparaître ici aujourd'hui. L'Association des pharmaciens du Canada est l'organisation nationale bénévole qui représente les pharmaciens exerçant leur métier dans tous les secteurs au Canada.
Nous avons abordé l'examen et la mise à jour des recommandations du comité en nous adressant à nouveau aux pharmaciens avec lesquels nous avions parlé en 1995, et nous leur avons demandé quels changements ils ont observé à la base dans l'exercice quotidien de leur profession dans les hôpitaux et dans le reste de la société. Si nous réexaminons certaines des recommandations que nous avons présentées au sujet des soins palliatifs à cette époque, plusieurs tendances positives semblent se faire jour.
Premièrement, nous constatons que les jeunes diplômés en médecine, en pharmacie et en sciences infirmières sont mieux au courant des soins palliatifs en général et ont un niveau de connaissance plus élevé. Certains éléments donnent aussi à penser que les gens qui s'occupent d'un membre de leur famille, les médecins, les infirmières et les pharmaciens travaillent de plus en plus en équipe à cet égard. Les consommateurs eux-mêmes, le grand public, semblent avoir davantage accès à l'information relative à la question des soins palliatifs en général.
Toutefois, plusieurs domaines paraissent susciter encore des préoccupations. Dans l'ensemble, aucune crise importante n'ayant porté cette question à l'attention du public dans les grands médias, elle semble avoir quitté le devant de la scène et ne fait guère l'objet de débats.
Si nous voulons progresser dans ce domaine, le comité sénatorial pourrait envisager de réaliser un sondage et de consulter la population pour déterminer ce que les consommateurs pensent de cette question.
Nous constatons que les soins palliatifs à domicile sont loin d'être considérés comme une partie intégrante de notre système de soins de santé. Les réductions de crédit et les querelles de compétence ont empêché d'inclure dans le système global de soins de santé les soins à domicile et les soins palliatifs pour pouvoir atténuer les symptômes, les traiter et soulager la douleur afin que les patients puissent mourir dignement dans le confort de leur propre domicile entourés de leurs familles et de leurs êtres chers.
À cause des pénuries actuelles de professionnels de la santé, il est difficile de trouver assez de personnes pour fournir des soins palliatifs, surtout à domicile ou à l'extérieur des établissements spécialisés.
Le sondage que nous avons réalisé auprès de pharmaciens de l'ensemble du pays a révélé des différences importantes entre les provinces en ce qui concerne la disponibilité des soins palliatifs et l'accès à ces services. Dans certaines provinces, l'accès varie d'une région à l'autre, et il y a certainement des différences importantes entre les zones rurales et urbaines.
Le financement reste une question critique. Les gens doivent faire des choix difficiles à cause du coût des médicaments et du fait que certains ne sont pas couverts. Dans les provinces où les régimes d'assurance-médicaments prévoient des franchises ou des quotes-parts d'un montant élevé pour les personnes âgées, les patients doivent se demander s'ils ont les moyens d'utiliser des médicaments coûteux pour soulager leurs symptômes, et on signale que certains d'entre eux renoncent à un traitement pour ne pas laisser leur conjoint sans ressources.
Nous observons une augmentation du nombre de patients hospitalisés pour recevoir des médicaments gratuitement de façon à pouvoir traiter leurs symptômes et leur offrir des soins palliatifs à la fin de leur vie.
Nous observons certainement une tendance à l'approfondissement et à l'expansion de notre connaissance des méthodes de soulagement de la douleur et de sédation. On a aujourd'hui de nouveaux médicaments et davantage d'expérience dans l'utilisation d'un assortiment de médicaments, et les praticiens sont davantage prêts à prescrire ces médicaments quand ils administrent des soins aux patients en phase terminale. Nos membres signalent encore que certains praticiens, surtout les plus âgés, restent réticents à prescrire des opiacés en quantité nécessaire pour assurer une absence relative de douleur aux derniers instants de la vie.
Nous observons de nouveaux développements. Mon confrère du Collège Royal des médecins et chirurgiens a parlé de la sédation complète. Dans la littérature, on utilise l'expression «sédation terminale». Ce sont des domaines dans lesquels nous avons observé certains développements. J'ai annexé à notre mémoire un document récent qui expose le point de vue des pharmaciens sur la sédation terminale.
Nous sommes heureux qu'on reconnaisse le rôle des pharmaciens en tant qu'experts en matière d'utilisation de médicaments pour les soins palliatifs. De nombreux protocoles ont été mis en place pour permettre aux pharmaciens et aux infirmières d'ajuster le dosage des analgésiques administrés aux patients qui reçoivent des soins palliatifs à l'hôpital ou à leur domicile.
Nous constatons également que de nombreux patients et leurs familles semblent mieux informés, se rendent compte qu'ils ne sont pas obligés de mourir dans la douleur et qu'ils sont plus enclins à solliciter une sédation terminale, en particulier en milieu hospitalier. Les patients et leurs familles soulèvent apparemment la question de la sédation terminale plus tôt que par le passé.
Nous recommandons au comité de promouvoir la réalisation d'études sur la sédation terminale et la sédation complète pour en déterminer la prévalence, ce qui va certainement dans le même sens que les recommandations présentées par le Dr Brazeau à propos de la nécessité d'élaborer des lignes directrices cliniques dans ce domaine.
Pour ce qui est des directives préalables et des testaments biologiques, les praticiens nous ont indiqué qu'ils sont de plus en plus utilisés depuis cinq ans. Les patients, mieux informés, commencent à utiliser ces instruments auxquels ils ont accès par l'Internet. De plus en plus de prestataires de soins les considèrent comme juridiquement contraignants, mais nous entendons encore parler de cas où les familles des patients retirent ces derniers de l'hôpital quand les prestataires leur indiquent qu'ils ne sont pas prêts à respecter les directives préalables. Il y a encore du travail à faire, et nous recommandons la reconnaissance officielle du statut juridique du testament biologique ou des directives préalables par les autorités compétentes de divers niveaux.
Je vais maintenant passer à la question de l'aide au suicide fournie par les médecins et de la sédation terminale. Conformément à ce que j'ai dit tout à l'heure, il faut continuer les recherches sur la sédation terminale. Certains disent que cette question pourrait être examinée dans le cadre de la nouvelle structure des ICRS. Il serait peut-être bon que certains des instituts participent à cette nouvelle structure. Il est difficile de faire des recherches sur le dosage des médicaments à utiliser dans les situations de ce genre et sur la durée de la thérapie. La recherche doit se faire de façon empirique, et nous appuierions certainement de telles initiatives.
Dans notre mémoire de 1995, nous avons présenté une liste de conditions qu'à notre avis, il faudrait respecter si on devait autoriser ou envisager la prestation d'une aide au suicide par les médecins au Canada. Nous aimerions attirer votre attention sur l'expérience réalisée en Oregon, où une loi appelée Oregon Death with Dignity Act a légalisé une forme de prestation d'aide au suicide par les médecins. Cette loi a été adoptée fin 1997, et cette initiative a fait l'objet d'une évaluation récente. Aux termes de cette loi, le médecin prescrit à un patient en phase terminale des médicaments létaux que celui-ci peut s'administrer lui-même.
Le sénateur Corbin: J'invoque le Règlement. Cette question ne se situe-t-elle pas hors du cadre de notre étude? Nous parlons maintenant spécifiquement de l'euthanasie et de l'aide au suicide. Je pensais que votre mise en garde au début de la réunion était claire. Nous ne voulons pas nous mêler de ça.
La présidente: Monsieur Poston, le sénateur a raison. Cela ne fait pas partie de l'examen entrepris par notre comité. Je vous remercie toutefois de nous fournir ces renseignements, puisqu'ils représentent une mise à jour de notre mémoire initial. Nous mettrons à jour certaines sections en tenant compte des renseignements disponibles, même s'il ne s'agit pas des recommandations. De ce point de vue, ces renseignements sont utiles.
M. Poston: C'est dans ce but que nous les avons présentés. Nous voulions mettre à jour notre mémoire antérieur sur cette question.
Pour terminer, je voudrais répéter que les patients doivent pouvoir librement choisir l'option qui leur convient au moment de quitter la vie. Une autre question qui a suscité des débats considérables au sein de notre profession est la nécessité que les prestataires soient libres de refuser d'exécuter certaines procédures pour des raisons éthiques ou morales.
Notre association est préoccupée par le fait que l'accessibilité et la disponibilité des services de soins palliatifs varient beaucoup d'un endroit à l'autre dans le pays. Nous sommes aussi d'avis que, pour assurer l'accès à ces services dans le cadre de l'assurance-maladie et la transférabilité des droits correspondants, les provinces doivent s'efforcer d'harmoniser les niveaux de services offerts et, le cas échéant, en étendre l'application. L'accès aux services de soins palliatifs ne devrait pas dépendre de l'endroit où on vit mais des besoins qui existent à un endroit donné.
La présidente: Merci. Nous allons maintenant entendre Sharon Sholzberg-Gray, de l'Association canadienne des soins de santé.
Mme Sharon Sholzberg-Gray, présidente-directrice générale, Association canadienne des soins de santé: L'Association canadienne des soins de santé, connue sous le sigle ACS, est heureuse de comparaître devant votre sous-comité. Comme vous nous l'avez demandé, nous présenterons une mise à jour relativement aux faits nouveaux concernant les recommandations contenues dans le rapport publié en 1995 par le Sénat sous le titre «De la vie et de la mort».
L'ACS est une fédération qui regroupe des organisations provinciales et territoriales du secteur des hôpitaux et de la santé qui sont déterminées à préserver et à renforcer le système de santé du Canada. Par l'entremise de ses membres, l'ACS représente des autorités régionales de ce secteur, des hôpitaux, des centres de soin de santé et des organismes qui emploient approximativement 1 million de prestataires de soins de santé et desservent la population de l'ensemble du Canada. Ces organisations sont administrées par des fiduciaires qui servent l'intérêt public.
La mission de l'ACS est d'améliorer la prestation des soins de santé au Canada en participant à l'élaboration des politiques, en défendant les intérêts de ses membres et en faisant preuve de leadership.
Les membres de l'ACS dans les provinces et les territoires représentent toute la gamme des soins, notamment dans les domaines suivants: hôpitaux, établissements de soins de longue durée, organismes offrant des soins à domicile ou au niveau communautaire, services de santé communautaires, services pour les toxicomanes, services pour les enfants, les jeunes et les familles; services de logement, ainsi que les organismes professionnels et d'accréditation. Beaucoup de nos membres sont donc confrontés quotidiennement aux réalités de la vie et de la mort.
Dans notre exposé, nous mettrons aujourd'hui l'accent sur des mises à jour concernant trois types d'initiatives: des initiatives propres à l'ACS, des initiatives auxquelles participe l'ACS et d'autres initiatives dont nous connaissons l'existence.
En ce qui concerne les initiatives de l'ACS, le comité du Sénat sur l'euthanasie et l'aide au suicide a recommandé que les gouvernements accordent une grande priorité aux programmes de soins palliatifs dans la restructuration du système de santé et qu'on adopte une approche intégrée des différents types de soins palliatifs. Ces recommandations ne pourront pas être appliquées tant que nous n'aurons pas mis en oeuvre un système de santé intégré et que nous ne le financerons pas de façon adéquate.
L'ACS souhaite que nous ayons un système de santé financé par l'État offrant l'accès à une vaste gamme de services de santé comparables dans tout le Canada. De ce fait, et étant donné également la diversité de nos membres, les initiatives que prend l'ACS en matière d'élaboration de politiques et de promotion des intérêts des secteurs qu'elle représente mettent principalement l'accent sur les questions concernant ce système. Dans ce contexte, les soins palliatifs font partie d'un système global de services nécessaires en faveur desquels l'ACS intervient constamment.
Certaines de nos initiatives actuelles de cette nature mettent l'accent sur l'élaboration d'un système de santé viable et sur les mesures permettant d'en assurer adéquatement le financement à long terme. Plus précisément, les initiatives de l'ACS concernant les soins palliatifs incluent la publication d'un document intitulé «CHA's Framework for a Sustainable Health Care System in Canada. A Discussion Paper», qui présente sept éléments clés, dont la nécessité de tenir compte de l'évolution des besoins de la population canadienne en matière de santé et de la mise en place d'un système de soins de santé intégré et innovateur.
L'ACS a notamment élaboré ce document pour encourager et faciliter la tenue d'un débat public sur notre système de soins de santé et les composantes qu'il doit inclure pour assurer sa durabilité. Ce document peut être consulté sur le site Web de l'ACS et sera bientôt disponible auprès de notre service de diffusion. J'en ai amené des exemplaires à votre intention. Les soins palliatifs font partie intégrante de notre conception de ce que devrait être un système de soins de santé intégré et innovateur.
Une autre initiative de l'ACS est le mémoire que nous avons présenté au Comité des finances dans le cadre de la préparation du budget fédéral 2000. Nous avons rédigé un mémoire intitulé «Creating a Sustainable Healthcare System for the New Millennium», dont nous avons mis des exemplaires à votre disposition.
Je consacrerai quelques minutes à l'examen de nos recommandations en matière de financement parce qu'un financement adéquat du système de santé existant et de tout l'éventail des soins est nécessaire pour que les soins palliatifs reçoivent des ressources appropriées dans le cadre du système de financement public.
L'ACS est d'avis que, pour fournir des soins de façon globale et intégrée, il faut un financement permettant l'accès à tous les types de services de santé, c'est-à-dire la protection contre la maladie, la protection de la santé, la promotion de la santé, le traitement des maladies et les soins palliatifs sous toutes leurs formes, qu'ils soient dispensés à domicile, dans des établissements spécialisés ou ailleurs.
À moins qu'on exploite le plein potentiel de toutes les composantes du système de soins de santé, les hôpitaux resteront exposés à des crises suite aux efforts qu'ils entreprennent pour répondre à la demande accrue de services et à la réduction de leur financement.
Le système de soins de santé doit s'adapter à l'évolution de la situation, mais l'utilisation à d'autres fins des ressources qui étaient consacrées à l'infrastructure institutionnelle traditionnelle des hôpitaux ne doit pas mettre en danger les services de soins de santé qui sont nécessaires. Il faut investir dans tous les types de soins et les amplifier pour essayer de mettre en place un système optimal offrant tout un éventail de soins intégrés et axés sur les clients.
Le système de soins de santé actuel est en crise. Sans un financement adéquat et durable, de nombreux services importants et nécessaires comme les soins palliatifs seront à nouveau ou continueront d'être considérés comme des «créneaux spécialisés».
Je suis sûre que vous avez déjà entendu cette expression dans certaines des discussions entre les premiers ministres des provinces et le gouvernement fédéral en matière de santé. À notre avis, tous ces services forment une partie essentielle du système de soins de santé du Canada. Aucun de ces services soi-disant «supplémentaires» ne peut être qualifié de «créneau spécialisé».
Dans ses recommandations, l'ACS invite instamment le gouvernement fédéral à affecter immédiatement, d'ici le 1er avril 2000, au moins 1,5 milliard de dollars au système de soins de santé du Canada pour stabiliser le système existant et préparer la création d'un système de soins de santé durable, accessible, intégré, novateur et financé par l'État pour le nouveau millénaire.
Nous pressons aussi instamment le gouvernement fédéral de prévoir un facteur de croissance ou une indexation des fonds versés dans le cadre du TCSPS pour assurer à long terme la durabilité de notre système de soins de santé. Ce facteur de croissance devrait être mis en place d'ici le 1er avril 2001, sinon, des services importants resteront vulnérables aux mesures de réduction des coûts.
En outre, l'ACS presse instamment le gouvernement fédéral d'étudier de nouveaux mécanismes de financement des soins de santé en consultation avec les gouvernements et les organisations de soins de santé des provinces et des territoires. De tels mécanismes pourraient permettre à l'ensemble des Canadiennes et des Canadiens d'avoir accès à un plus large éventail de services de soins de santé comparables.
Dans le climat actuel de crise, les établissements et les organismes de soins de santé de notre pays ont du mal à élaborer et mettre en place des services novateurs, notamment pour offrir des soins de santé appropriés.
Une troisième initiative de l'ACS est le document «Watching Brief» publié par notre conseil d'administration. En octobre 1999, lors de l'examen annuel de nos orientations stratégiques, le conseil d'administration de notre organisation a confirmé que l'ACS devait suivre de près l'évolution des soins de santé, notamment en appuyant ceux qui dispensent des soins de façon informelle et en renforçant l'accès à ces services.
Quatrièmement, l'ACS a pris des initiatives concernant les soins de santé dans le cadre des politiques de son conseil d'administration. Au fil des ans, ce dernier a approuvé diverses politiques concernant les soins palliatifs et des questions connexes. Depuis 1994, nos politiques en la matière incluent une déclaration conjointe sur les interventions de réanimation, publiée en 1995 et remise à jour depuis lors, ainsi qu'une déclaration conjointe sur la prévention et le règlement des conflits éthiques entre les prestateurs de soins de santé et les personnes recevant les soins. Je reviendrai sur cette question dans une minute ou deux.
Outre ces initiatives spécifiques, l'ACS collabore activement avec d'autres organisations dans le cadre de projets concernant les soins palliatifs.
À cet égard, l'ACS continuera, comme par le passé, à soutenir d'autres groupes qui collaborent à d'importantes initiatives concernant les soins palliatifs ou en sont le moteur. Le comité spécial du Sénat sur l'euthanasie et l'aide au suicide a présenté plusieurs recommandations concernant l'élaboration de lignes directrices régissant l'abstention et l'interruption de traitement de survie, la formation des prestataires professionnels de soins de santé de toute nature et la collecte d'informations relatives à des traitements spécifiques.
Je vais vous décrire brièvement trois activités auxquelles a récemment participé l'ACS et qui sont directement liées aux questions concernant les soins palliatifs.
La déclaration conjointe sur la prévention et le règlement des conflits éthiques entre les prestateurs de soins de santé et les personnes recevant les soins est le fruit d'une collaboration entre les conseils d'administration de l'Association canadienne des soins de santé, de l'Association médicale du Canada, de l'Association des infirmières et infirmiers du Canada et de l'Association catholique canadienne de la santé, et a été approuvée par toutes ces organisations. Cette déclaration est diffusée par toutes les associations qui la parrainent -- dont certaines sont représentées ici aujourd'hui -- et figure sur le site Web de chacune. J'en ai amené des exemplaires à votre intention.
Cette déclaration conjointe porte principalement sur les conflits entre les personnes recevant des soins, ou leurs mandataires, et les prestataires de ces soins. Elle donne des conseils sur la façon d'élaborer des politiques permettant de prévenir et de régler les conflits éthiques soulevés par les décisions d'entreprendre, de poursuivre, de refuser de dispenser ou d'interrompre un traitement.
Une autre initiative de ce type est le projet de l'Association canadienne de soins palliatifs intitulé «Palliative Care Training for Support Workers», qui est financé par Santé Canada. L'ACS est heureuse de participer à cet important projet en tant que membre du groupe consultatif national. J'ai apporté un bref résumé de ce projet à votre intention. Je suis sûr que vous entendrez parler davantage de ce projet novateur de l'Association canadienne des soins palliatifs.
L'ACS s'y intéresse pour faire en sorte que tous les prestataires de services, y compris le personnel auxiliaire, aient accès à une formation appropriée et à des réseaux de soutien.
L'ACS et d'autres groupes nationaux collaborent aussi avec l'Institut canadien d'information sur la santé dans le cadre d'un projet sur les indicateurs concernant les soins à domicile qui inclut des indicateurs relatifs aux soins palliatifs.
L'ACS est heureuse d'être associée à ces initiatives qui encouragent l'élaboration et la mise en oeuvre d'activités et de ressources essentielles concernant les questions de la vie et de la mort.
Pour ce qui est d'une mise à jour à propos des autres initiatives auxquelles l'ACS n'est pas directement associée, le comité spécial du Sénat sur l'euthanasie et l'aide au suicide a présenté diverses recommandations concernant l'élaboration de lignes directrices et de normes pour les soins palliatifs. Dans mon mémoire, que j'ai remis à la greffière du comité, je signale que l'Association canadienne des soins palliatifs a reçu des fonds de Santé Canada pour travailler dans ce domaine. Je voudrais corriger cela en précisant que cette association cherche encore à obtenir ces fonds, mais ne les a toujours pas reçus. En fait, elle cherche aussi à en obtenir de la part de sources privées.
À cet égard, j'aimerais signaler que l'Association canadienne des soins palliatifs, au travail de laquelle nous attachons beaucoup de prix, n'a pas reçu de financement de base de la part de Santé Canada. Elle aura donc plus de mal à l'avenir à s'acquitter de son importante tâche dans le domaine des soins palliatifs. J'aimerais intervenir en son nom devant votre comité pour demander à Santé Canada d'accorder à nouveau un financement de base à l'Association canadienne des soins palliatifs et à d'autres associations de même nature pour qu'elles puissent continuer à s'acquitter de leur importante tâche.
Une autre recommandation du comité spécial du Sénat sur l'euthanasie et l'aide au suicide disait que les services de répit sont un élément essentiel d'une approche intégrée des soins palliatifs. L'Association canadienne des soins de santé a mis ses membres au courant de l'existence d'un excellent rapport sur les soins de répit qu'on peut se procurer auprès de l'Association canadienne des soins et services communautaires. Je suis fière d'avoir joué un rôle dans ce projet. J'étais autrefois directrice générale de cette association.
Certains progrès ont été réalisés au cours des cinq dernières années relativement au règlement des problèmes concernant les soins palliatifs, mais il reste encore beaucoup à faire pour qu'ils soient intégrés dans le système de soins de santé du Canada. Il faut les financer de façon satisfaisante pour que tous les Canadiens puissent y avoir accès. Leur prestation doit être régie par des normes ou des lignes directrices nationales, et ils doivent être inclus dans une base nationale de données sur les services de santé. Les moyens nécessaires pour assurer la formation de tous les prestataires doivent être fournis, et ils doivent inclure les soins de répit nécessaires. L'Association canadienne des soins de santé et ses membres des provinces et des territoires continueront à collaborer avec d'autres organisations pour élaborer les ressources nécessaires et faire en sorte qu'elles soient mises à la disposition des organisations de soins de santé, des prestataires et des consommateurs dans tout le pays.
Je vous remercie de m'avoir donné la possibilité de comparaître devant vous aujourd'hui.
La présidente: Merci, madame Sholzberg-Gray.
Dr Gordon L. Crelinsten, président, Comité d'éthique, Association médicale canadienne: Madame la présidente, je suis cardiologue en pratique privée à Montréal et professeur agrégé de médecine à l'université McGill. Je suis accompagné de M. John Williams, titulaire d'un doctorat et directeur de l'Éthique à l'Association médicale du Canada.
[Français]
L'Association médicale canadienne remercie le sous-comité de lui permettre de le rencontrer. Comme vous entendrez d'autres organisations médicales et d'autres personnes au sujet des enjeux que vous avez décidé d'étudier, nous n'essaierons pas de couvrir tous ces aspects. Nous concentrerons nos propos sur certains enjeux et nous répondrons au meilleur de notre capacité aux questions portant sur les autres aspects.
[Traduction]
Certains membres du sous-comité se rappelleront notre exposé du 23 novembre 1994. Nous maintenons les recommandations que nous avions alors présentées et nous ne les reprendrons pas ici. Notre intervention portera plutôt sur ce qui s'est produit depuis la publication de votre rapport en 1995.
En 1996, le conseil général de l'AMC a approuvé une nouvelle version du Code de déontologie de l'Association, fruit d'une révision importante qui a duré quatre ans. Plusieurs articles de la version révisée du Code ont trait spécifiquement aux questions sur lesquelles vous vous penchez. Par exemple, l'article 3 stipule:
Voir à ce que votre patient reçoive tous les soins nécessaires, y compris un réconfort physique et un appui spirituel et psychosocial, même lorsqu'il est incurable.
L'article 15 stipule:
Respecter le droit d'un patient apte pour accepter ou refuser tout soin médical recommandé.
L'article 18 indique:
Déterminer, dans la mesure du possible, et reconnaître les désirs de votre patient au sujet de la mise en oeuvre, du maintien ou de l'interruption des traitements essentiels au maintien de la vie.
L'article 19 stipule:
Respecter les intentions qu'un patient inapte a exprimées avant de devenir inapte (en donnant des directives préalables ou en désignant un mandataire).
L'article 21 déclare:
Faire preuve de prévenance envers les membres de la famille du patient et envers ses proches et collaborer avec eux dans l'intérêt du patient.
L'article 42 ajoute:
1. Collaborer avec d'autres médecins et professionnels de la santé aux soins des patients et au fonctionnement et à l'amélioration des services de santé.
En 1998, l'AMC a mis à jour sa politique sur «L'aide médicale à la mort», que nous avions présentée en novembre 1994, et l'a rebaptisée «L'euthanasie et l'aide au suicide». Les changements relativement mineurs visaient à rendre la politique conforme à la version 1996 du Code de déontologie.
Au cours de notre intervention précédente devant le comité, nous avons discuté en détail de la «Déclaration conjointe sur la réanimation» produite en collaboration avec l'Association canadienne des infirmières et infirmiers du Canada et l'Association catholique canadienne de la santé. Une version révisée du document a paru en 1995. Les quatre organismes ont produit par la suite un dépliant à l'intention des patients, des membres de leur famille et des fournisseurs de soins de santé intitulé: «Prendre la bonne décision au sujet de la RCR».
Les mêmes organismes ont produit récemment une déclaration conjointe sur la prévention et le règlement des conflits éthiques entre les prestateurs de soins de santé et les personnes recevant les soins. Nous avons joint à la présente des copies de tous les documents.
Ces publications démontrent que l'AMC ne s'est pas croisé les bras face aux enjeux abordés par le comité dans son rapport de 1995.
Sur les 28 recommandations du rapport, aucune ne s'adressait toutefois à notre Association. Beaucoup de ces recommandations préconisaient des modifications de la loi ou d'autres initiatives des gouvernements fédéral ou provinciaux et territoriaux. Comme les gouvernements n'ont pas donné suite à ces recommandations dans la plupart des cas, l'AMC n'a pas eu beaucoup la chance de participer à leur mise en oeuvre.
Même si nous sommes d'accord au sujet de l'esprit de la plupart des recommandations figurant dans votre rapport de 1995, nous manifestons respectueusement notre désaccord face aux appels lancés pour que Santé Canada établisse des directives et des normes sur la prestation de traitements visant à atténuer les souffrances lorsqu'ils peuvent raccourcir la vie, sur la sédation totale des patients et sur la gestion de l'abstention et du retrait des traitements de maintien de la vie.
Ni Santé Canada, ni aucun autre service gouvernemental, qu'il soit fédéral, provincial ou territorial, n'est capable de produire des directives sur la pratique médicale. Il y a quelques années, l'AMC a piloté un exercice de production de guides qui a permis de présenter en 1994 une série de principes directeurs concernant les guides de pratique clinique au Canada. Le principe 7 se lit comme suit:
les médecins devraient élaborer les guides de pratique clinique en collaboration avec les représentants des personnes touchées par les interventions spécifiques en question, y compris les groupes de médecins pertinents, les patients et les autres fournisseurs de soins de santé s'il y a lieu.
Le gouvernement peut avoir un rôle à jouer dans le financement de la création de ces lignes directrices par les organismes compétents, mais il ne devrait pas essayer de s'en charger. Il n'a ni les compétences nécessaires ni la crédibilité requise dans le domaine de la pratique clinique. Nous demandons au gouvernement de coopérer très activement pour aider les organisations nationales à élaborer ces lignes directrices à l'intention des professionnels de la santé de ces secteurs.
Sur une note plus positive, l'AMC appuie ferment les efforts déployés par les organismes qui s'intéressent aux soins palliatifs afin de généraliser davantage ces services. Nous avons suivi avec intérêt les publications sur les lacunes des soins en fin de vie aux États-Unis, et en particulier l'Étude SUPPORT, étude visant à comprendre les pronostics et les préférences relatives aux résultats et aux risques de traitements. Grâce à l'aide financière de la Fondation Robert Wood Johnson, l'American Medical Association a mis au point une série de programmes d'études détaillées pour son programme d'éducation des médecins sur les soins en fin de vie. Ces programmes visent à améliorer les soins en question.
À notre connaissance, le Joint Centre for Bioethics de l'Université de Toronto a reçu des fonds pour diffuser cette excellent programme au Canada.
En 1998, Mme Donna Wilson et ses collaborateurs de l'Université de l'Alberta ont produit un rapport volumineux intitulé «Social and Health Care trends Influencing Palliative Care and the Location of Death in Twentieth-Century Canada». L'Association canadienne des soins palliatifs a entrepris la révision de son document intitulé «Les soins palliatifs: vers un consensus pour une normalisation de la pratique». Santé Canada finance actuellement un projet qui vise à produire un guide sur les soins en fin de vie des personnes âgées, qui devrait être terminé au cours des prochains mois. Le Centre de bioéthique de l'Institut de recherche clinique de Montréal publie toujours son Journal of Palliative Care, reconnu sur la scène internationale. L'AMC se réjouit de ces activités et espère en voir sous peu les résultats intégrés à l'éducation médicale et à la pratique clinique générale.
En ce qui concerne l'abstention et le retrait des traitements de maintien de la vie, les directives préalables, l'aide au suicide et l'euthanasie, nous considérons que les politiques de l'AMC que nous avons présentées en 1994 ont bien résisté à l'épreuve du temps et qu'il n'est pas nécessaire de les réviser. Nous maintenons les recommandations que nous avons présentées lorsque nous avons comparu devant vous le 23 novembre 1994.
Je vous remercie de cette occasion de nous entretenir avec vous. Je serai heureux de répondre à vos questions.
La présidente: Merci.
Mme Sharon Nield, directrice, Politique des soins infirmiers et soutien à la réglementation, Association des infirmières et infirmiers du Canada: Je vous remercie d'avoir invité l'Association des infirmières et infirmiers du Canada à participer à cette importante discussion. L'AIIC est une fédération composée de 11 associations des provinces et des territoires qui représentent 110 000 infirmières autorisées de l'ensemble du pays. Nous saluons cette remise à jour de votre rapport «De la vie et de la mort» pour diverses raisons.
Premièrement, quand nous avons comparu devant le comité en octobre 1994, une de nos principales recommandations était qu'un vaste débat public ait lieu au sujet des questions concernant la fin de la vie. Cet examen donne l'occasion de poursuivre les discussions entamées à cette époque et d'attirer à nouveau l'attention du public sur cette question.
Deuxièmement, nous sommes heureuses de la possibilité de réfléchir sur nos activités liées à l'application des recommandations du comité et de celles de notre organisation et de vous les résumer. Conformément à l'objectif de notre tâche, nos propos porteront seulement sur les progrès qui nous paraissent avoir été réalisés, nos propres contributions et nos recommandations relativement à ce sur quoi il faudrait mettre davantage l'accent.
Nous félicitons le comité pour la publication de ce rapport. Les recommandations portent sur plusieurs des préoccupations que nous avions exprimées, en particulier en ce qui concerne les soins palliatifs, le soulagement de la douleur, les directives préalables et l'éducation. Votre rapport exhaustif reflète la diversité des points de vue exprimés par vos témoins à propos de cette question complexe et difficile.
Le paysage qu'offre le système de soins de santé a énormément changé au cours des cinq dernières années. L'adoption des recommandations du comité a été facilitée par certains de ces changements, notamment l'expansion des soins multidisciplinaires, le désir croissant des consommateurs d'être mieux informés et de contrôler eux-mêmes les soins qu'ils reçoivent et les progrès technologiques concernant le soulagement de la douleur et le traitement des symptômes. D'autres changements, par exemple le transfert des soins au niveau communautaire sans fournir des ressources suffisantes et le fait que les questions liées à la fin de la vie restent tributaires des ressources qui leur sont consacrées, ont empêché de mettre en place la structure plus complète et plus appropriée qui était envisagée et à laquelle notre consoeur de l'Association canadienne des soins de santé a également fait référence.
Les questions liées à la fin de la vie semblent ne plus faire la une de l'actualité et reviennent seulement à la surface quand les médias mettent en relief les cas comme l'affaire Latimer, sur laquelle portaient en grande partie les déclarations des témoins lors des audiences du comité. Nous restons d'avis qu'il faut encore une discussion publique et une éducation de la population indépendamment des cas individuels qui suscitent beaucoup d'émotion. Avec le vieillissement de la population, ces questions nécessiteront de plus en plus une approche politique nationale vis-à-vis des problèmes concernant la fin de la vie.
Les infirmières, de concert avec nombre de nos collègues présents ici aujourd'hui, ont participé à la mise en oeuvre de nombre des recommandations contenues dans «De la vie et de la mort».
Le code de déontologie des infirmières autorisées de l'AIIC, qui définit les responsabilités déontologiques des infirmières et infirmiers du Canada, a été mis à jour et réédité en 1997 à la suite d'un processus national de consultation aplomb et approfondi. Les révisions visaient tout particulièrement à renforcer les valeurs éthiques de «choix» et «dignité». Pour aider les infirmières à prendre des décisions en matière d'éthique, le code souligne qu'elles sont sensées associer leurs clients à la prise de décision, respecter les décisions éclairées prises par des personnes compétentes qui refusent un traitement et respecteront la législation pertinente régissant le consentement de choix. Il souligne également que les infirmières doivent respecter les décisions et les directives légitimes concernant les choix en matière de soins ainsi que respecter et honorer les désirs de leurs clients en ce qui concerne leur qualité de vie.
En plus de présenter le code de déontologie, l'AIIC a élaboré un abondant matériel pédagogique relatif à l'application du code destiné aux écoles de sciences infirmières ainsi qu'aux associations professionnelles des provinces et des territoires. Nous avons aussi constitué un comité national consultatif sur la déontologie pour conseiller l'AIIC au sujet des autres mises à jour nécessaires pour refléter l'évolution du système de soins de santé et la nécessité d'aider les infirmières à savoir comment se comporter à l'intérieur de ce système.
Quand nous avons comparu devant le comité il y a cinq ans, nous venions de terminer la déclaration sur les directives préalables élaborées conjointement avec six autres organisations nationales du secteur de la santé à laquelle on a fait référence ce matin. Elle a été largement diffusée auprès des infirmières. En mai 1998, nous avons lancé une série de documents intitulés «Déontologie pratique», dont le premier portait sur le rôle des infirmières vis-à-vis des directives préalables. Ce document a été aussi largement diffusé et utilisé par les associations d'infirmières des provinces et des territoires. Il fournit des renseignements à propos de divers types de directives avancées et il présente plusieurs études de cas.
La déclaration conjointe sur la prévention et la résolution des conflits éthiques a aussi été mentionnée par mes collègues. Elle a été publiée en juin dernier et a été diffusée largement auprès de nos membres. Énonçant les principes sur lesquels on peut se baser pour faire des choix éclairés, elle fournit aussi aux organisations et aux professionnels des soins de santé des conseils précis sur la façon de régler les conflits éthiques. C'est un document très important puisque nous sommes de plus en plus confrontés à des choix difficiles en matière de soins dans un contexte éminemment complexe.
Les associations professionnelles jouent un rôle de leadership, mais, à titre individuel, les infirmières ont aussi pris des mesures pour clarifier les questions concernant les soins en phase terminale et les dilemmes éthiques correspondants. On peut citer l'exemple des infirmières autorisées de Montréal qui ont participé à des séances de perfectionnement avec une personne spécialisée en déontologie infirmière. Suite à cela, deux des participantes ont décidé de mettre sur pied un projet d'éducation destiné à toutes les infirmières de leur unité pour leur permettre de rédiger des protocoles sur la fin de la vie et de discuter des directives préalables avec chaque patient. Elles ont présenté leur projet à la conférence de la Société canadienne de bioéthique, puis au Congrès biennal de l'AIIC ainsi qu'au Congrès international des infirmières à Londres en juin dernier. La clef de leur réussite a été de permettre aux infirmières et au reste du personnel qui travaille avec elles d'être plus à l'aise pour traiter cette question avec les patients. C'est un des nombreux exemples des efforts entrepris par les infirmières pour appuyer les choix de leurs clients et prévenir les problèmes éthiques liés aux soins en phase terminale.
De façon générale, les éléments clés sont une discussion ouverte, le respect des soins des clients et de leurs familles et des processus institutionnels clairs. Les infirmières sont convaincues que les questions concernant la fin de la vie doivent être envisagées dans le contexte de la finalité des soins. L'adoption d'une telle orientation peut nous permettre de faire en sorte que les patients trouvent que la prise de décision a un sens puisque leurs différentes options ont un sens.
Toutefois, malgré les progrès réalisés en matière d'éducation, d'élaboration des politiques et de plans de soins, nous savons qu'il y a encore beaucoup à faire. Comme nous l'avons souligné dans notre mémoire de 1994, le domaine des soins palliatifs, surtout les soins à domicile, reste une source de préoccupations.
Suite aux compressions budgétaires des années 90, nous nous retrouvons avec un système de soins à court terme qui renvoie les gens chez eux «plus vite et moins bien» et peu de fonds ont été fournis pour les soins communautaires. La recommandation du comité en faveur d'une approche intégrée des soins palliatifs n'a pas été mise en oeuvre, comme l'ont aussi indiqué mes collègues ce matin.
Les malades en phase terminale peuvent choisir de mourir dans leur foyer, mais il faut leur donner la possibilité de le faire en recevant des soins, en souffrant le moins possible et dans la dignité. Il faut éviter que les gens aient l'impression de constituer un fardeau. Le fardeau des soins ne devrait pas peser sur les membres de la famille, qui supportent déjà celui de la perte et du deuil. C'est souvent l'absence de tels appuis et le fardeau que doivent supporter leurs êtres chers, plutôt que la maladie elle-même, qui amènent les malades à envisager l'aide au suicide.
Nous recommandons d'encourager les gouvernements à financer des programmes de soins palliatifs de qualité dans le milieu hospitalier et à domicile. Comme l'a signalé le comité, les soins de répit sont un élément essentiel d'un tel programme.
Nous serions également en faveur d'un accroissement de la recherche sur les questions liées aux soins palliatifs, au soulagement de la douleur et à la qualité de la vie et nous espérons que c'est ce que feront les futurs Instituts canadiens de recherche sur la santé une fois mis en place.
Nous avons trouvé intéressants les commentaires présentés par les autres témoins au sujet de vos recommandations sur la nécessité de clarifier le Code criminel. Nous avons pris pour principe qu'avec un programme d'éducation, un dialogue ouvert et une orientation politique appropriée, il devrait y avoir très peu de procès portant sur des questions liées à la fin de la vie, mais nous savons que beaucoup de nos membres, en particulier les infirmières qui fournissent des soins au domicile des patients, sont encore préoccupées au sujet de leur responsabilité civile.
En résumé, cet examen nous paraît opportun, et nous présentons les recommandations suivantes:
Premièrement, que le gouvernement fédéral continue à chercher comment renforcer le débat public à propos des questions concernant l'euthanasie, l'aide au suicide et la fin de la vie afin de déterminer véritablement à quelles valeurs nous attachons de l'importance dans notre pays, et que les consommateurs soient mieux informés de leurs options en matière de soins et de refus de traitement.
Deuxièmement, que la recherche sur les soins palliatifs et la qualité de la vie soit encouragée sous les auspices des Instituts canadiens de recherche sur la santé.
Troisièmement, qu'un plan national intégré pour les soins communautaires et à domicile doté d'un financement adéquat soit créé pour assurer aux Canadiennes et Canadiens des soins palliatifs à domicile de qualité; et
Quatrièmement, que les personnes travaillant dans le secteur des soins de santé soient informées des changements apportés à la législation.
Dans l'ensemble du pays, nos infirmières sont quotidiennement confrontées aux problèmes difficiles et complexes du traitement des patients en phase terminale. Vu l'état actuel du système de soins de santé, il leur est difficile d'avoir l'impression qu'elles répondent à leurs propres exigences et à celles de la loi pour ce qui est de la qualité des soins qu'elles fournissent et de la possibilité qu'elles ont de respecter les normes de déontologie. L'AIIC continuera de faire preuve de leadership en aidant et en éduquant ses membres, et nous espérons que vous appuierez nos efforts.
La présidente: Je voudrais vous remercier toutes et tous. Nous allons maintenant passer aux questions.
Le sénateur Roche: Je voudrais d'abord remercier les témoins qui nous ont appris beaucoup de chose.
Je voudrais demander au Dr Brazeau ce qu'il pense de la phrase suivante: il y a des gens qui meurent en subissant des souffrances épouvantables; il y a des gens qui essaient de se suicider, n'y parviennent pas et se retrouvent dans un état pire qu'avant leur tentative de suicide. Cette phrase se place dans le contexte d'un plaidoyer en faveur de la création d'un plus grand nombre d'installations offrant des soins palliatifs.
Je peux voir que cette question vous pose un problème. Permettez-moi de la reformuler: êtes-vous d'avis qu'il y a des gens qui meurent en subissant des souffrances épouvantables et qu'il y en a qui essaient de se suicider, n'y parviennent pas et se retrouvent dans un état pire qu'avant leur tentative de suicide?
Dr Brazeau: Je répondrai à la première partie de la question que, d'après ce qu'on me dit, c'est quelque chose qui se produit au Canada, il y a des gens qui subissent des souffrances épouvantables et qui meurent dans ces conditions. Les médecins spécialistes qui s'occupent d'eux avec leurs collaborateurs me disent aussi que cela arrive maintenant moins souvent. Ces spécialistes me disent surtout que nous devons faire beaucoup plus pour que cela n'arrive plus.
Le sénateur Roche: La présidente et la greffière se rendront compte que la phrase que j'ai lu était extraite du mémoire de Mme Downie, qui a comparu devant nous et qui, en réponse à la question que je lui ai posé, a dit qu'elle nous fournirait des preuves empiriques. Avons-nous déjà reçu quelque chose?
Mme Heather Lank, greffière du comité: Pas encore.
Le sénateur Roche: Ce qui s'est passé ce matin, avec le rappel au règlement et l'intervention du sénateur Corbin, montre le problème auquel notre comité est confronté. Lorsqu'un des témoins a abordé la question de l'euthanasie et de l'aide au suicide afin, m'a-t-il semblé, de défendre un certain point de vue -- et je crois que le sénateur Corbin l'avait également interprété de cette façon --, on nous a signalé que le sous-comité a pour mandat de s'occuper non pas de ces questions, mais des décisions unanimes du comité, qui portaient sur l'augmentation de l'offre de soins palliatifs. J'ai l'impression que les témoins qui comparaissent devant le comité -- pas tous, mais certains d'entre eux -- nous incitent à nous pencher sur les questions qui ont divisé le comité dans son rapport initial, l'aide au suicide et l'euthanasie non volontaire. Cela m'amène à me demander s'il est, en fait, réaliste de faire une telle distinction. Le public, même certains de ses membres bien informés, considère-t-il que les soins palliatifs incluent l'aide au suicide et l'euthanasie involontaire?
Dans son excellente déposition, Mme Nield, a terminé ses observations en disant que son association demandait qu'on discute davantage des questions relatives à l'euthanasie pour «déterminer à quelles valeurs nous attachons de l'importance dans notre pays».
Je n'ai pas l'intention de chercher à résoudre ce dilemme maintenant. Toutefois, j'attire l'attention sur lui pour montrer que je crains fortement que la discussion sur les questions délicates à propos desquelles nous ne sommes pas parvenus à un accord pèse nécessairement sur ce que nous avons l'intention de faire -- et, en particulier, il est particulièrement évident qu'il faut davantage de soins palliatifs dans les hôpitaux et à domicile. Personnellement, je ne sais pas quoi faire à ce sujet.
La présidente: Sénateur Roche, je ne suis pas sûre que le moment soit opportun pour cette discussion.
Le sénateur Roche: Peut-être pas, madame la présidente.
La présidente: Je veux apporter publiquement une correction. Ce matin, quand nous avons entendu l'exposé de l'Association des pharmaciens du Canada, vous avez laissé entendre que son mémoire indiquait que ses représentants allaient faire des commentaires manifestant leur appui à l'euthanasie. Si vous lisez la quatrième chose qu'ils disent dans leur mémoire, sénateur, vous constaterez que c'est très clair. Ils ont déclaré que ce qu'ils ont dit et recommandé en 1995 reste valide si le gouvernement devait légaliser l'euthanasie. Ils n'ont certainement pas plaidé -- et ne le font pas maintenant -- en faveur de l'euthanasie. Cela doit être clairement indiqué au procès-verbal.
Le sénateur Roche: Madame la présidente, j'accepte votre remarque. Toutefois, la déposition antérieure de Mme Downie a certainement donné lieu à une discussion de ce point de vue, sinon à un plaidoyer en sa faveur.
Je poserai peut-être la question suivante à Mme Nield. Dans toute cette affaire, les infirmières sont sur la ligne de front. À votre avis, le public fait-il une distinction entre, d'une part, les soins palliatifs de qualité et, d'autre part, l'aide au suicide?
Mme Nield: Je ne suis pas sûre d'être en mesure de parler de ce que croit le public. Ce que les infirmières constatent est qu'une grande confusion règne à propos de certaines questions concernant les patients en phase terminale et les responsabilités des infirmières. Je pense qu'on sait aujourd'hui mieux que jamais ce que sont des soins palliatifs de qualité. Je crois également que l'accès aux soins palliatifs soulève des questions importantes. Je crois que cela influe sur l'impression que s'en fait le public. Je n'ai pas constaté personnellement l'existence d'un lien intrinsèque entre les soins palliatifs et l'aide au suicide.
Dr Crelinsten: Je me ferai l'écho de ce qui vient d'être dit. Je ne peux pas parler au nom du public. Je peux parler de l'impression qu'ont, à mon avis, les membres de l'Association médicale du Canada, c'est-à-dire que la participation à l'euthanasie et à l'aide au suicide n'est pas le travail des membres de l'association.
En tant que médecin qui s'occupe souvent de gens qui vont bientôt mourir d'une grave maladie cardiologique en état avancé, mon expérience personnelle me dit que les patients dont je m'occupe et aux soins desquels je participe ne font aucune confusion entre les soins palliatifs et le soulagement de la souffrance, qu'elle soit physique, mentale, spirituelle ou affective, d'une part, et l'aide au suicide, d'autre part. En fait, nombre des patients qui en discutent ont l'impression que l'aide au suicide constitue peut-être un échec de la médecine palliative. Pour eux, l'aide au suicide est une issue envisageable quand les préceptes et la compétence des médecins spécialisés en soins palliatifs ne sont pas mis à leur disposition ou ne suffisent pas à régler leurs problèmes.
Le sénateur Roche: Madame Sholzberg-Gray, après avoir reçu le rapport «De la vie et de la mort», qui demandait à l'unanimité qu'on offre davantage de soins palliatifs et auquel le gouvernement n'a pas répondu alors que des témoins avaient dit au comité qu'il y avait une crise dans ce domaine, pensez-vous que la raison pour laquelle le gouvernement n'a pas répondu à ces recommandations est qu'il ne voulait pas aborder des questions qui font entrer en jeu le sujet fortement controversé de l'aide au suicide et de l'euthanasie?
Mme Sholzberg-Gray: Non. Le fait que le gouvernement -- et je parle ici du gouvernement fédéral aussi bien que des gouvernements des provinces et des territoires -- n'a pas financé de façon adéquate les soins de santé, ce qui inclut tous les services y compris les soins palliatifs, n'a aucun rapport avec la crainte de discuter de questions telles que l'aide au suicide, mais est plutôt dû à une méconnaissance du problème ou à son refus de financer suffisamment le système de soins de santé de notre pays. Rappelez-vous qu'il y a quelques années -- en fait, à l'époque où le comité a présenté initialement son rapport --, tous les gouvernements du Canada cherchaient surtout à réduire leur coût. C'était l'objectif du gouvernement à cette époque. Nous commençons maintenant à nous rendre compte que transférer le fardeau du déficit au secteur de la santé n'est pas nécessairement une bonne solution. Cela n'a aucun rapport avec la crainte de discuter de ces questions, mais plutôt avec la crainte de dépenser de l'argent pour offrir ces services bien nécessaires. J'espère que ces services, y compris les soins palliatifs, bénéficieront d'un financement approprié.
La présidente: Madame Sholzberg-Gray, pensez-vous également que cela peut être dû en partie au fait que les soins palliatifs étaient, en quelque sorte, une chose nouvelle à l'époque où on réduisait ainsi les dépenses et que, comme ils ne faisaient pas partie du financement de base, ils n'y ont jamais été intégrés?
Mme Sholzberg-Gray: Je pense que vous avez raison. Ce n'était pas la seule chose nouvelle à ce moment-là. Il y a toute une gamme de services communautaires qui ne sont pas financés correctement et qui ne font pas partie des services de base couverts dans notre pays par l'assurance-maladie, qui, ne l'oublions pas, est censée couvrir les services fournis par les hôpitaux et les médecins. Nous n'avons pas encore étendu ces services comme nous devrions le faire.
Certaines provinces ont récemment inclus les soins palliatifs à leurs services de base. À ma connaissance, par exemple, votre propre province du Manitoba, madame la présidente, est juste en train d'inclure les soins palliatifs dans les services couverts par le financement de base. C'est une décision importante. Le fait est qu'il serait utile que, quand le gouvernement fédéral discutera avec les provinces et les territoires -- peut-être dès le mois de mai -- l'extension de l'éventail des soins, cette discussion ne se limite pas aux soins à domicile ou aux soins communautaires, mais inclue divers autres services et mentionne nommément les soins palliatifs et d'autres types de services auxquels les Canadiens n'ont pas nécessairement accès. Il faut signaler que la situation varie beaucoup d'un endroit à l'autre et que, dans une province, les gens reçoivent peut-être le matériel et les produits pharmaceutiques dont ils ont besoin pour les soins palliatifs à domicile, alors que ce n'est pas possible dans d'autres provinces. Dans certaines d'entre elles, on peut mourir chez soi en toute dignité alors qu'ailleurs, c'est impossible. On ne sait pas très bien, par exemple, quel est le rôle des établissements de soins de longue durée dans tout cela.
Il est important d'envisager le système de santé de façon intégrée, comme le comité l'a lui-même recommandé, et c'est dans ce contexte qu'il faut comprendre la nature des soins palliatifs et les financer. Nous attendons avec impatience les discussions qui auront lieu en mai, maintenant que nous cherchons à mettre sur pied un système de santé répondant aux besoins des Canadiennes et des Canadiens en ce qui concerne tous les types de services et quelle que soit la façon dont ils sont fournis.
[Français]
Le sénateur Pépin: Nous avons reçu la semaine dernière les représentations des associations de soins palliatifs. Suite à vos représentations, nous sommes tous d'avis que le pourcentage de personnes agées de la population a augmenté considérablement et que plus de gens sont atteints et meurent du cancer. Nous constatons donc, à l'unanimité, que nous devrions consacrer plus de fonds aux différentes associations et à la recherche.
Toutefois, j'aimerais souligner un point soulevé dans le mémoire de l'Association des infirmières. Vous dites, dans une des recommandations au chapitre 8, qu'il n'est pas nécessaire de modifier le Code criminel. C'est aussi ce qu'ont dit les médecins spécialistes après avoir été consultés. Les gens qui dispensent des soins palliatifs nous ont dit qu'il fallait absolument faire quelque chose dans ce domaine. Les infirmières ont aussi mentionné dans leur présentation qu'il fallait éclaircir cette situation. Pourriez-vous m'indiquer pourquoi vous avez une approche différente des gens qui sont impliqués sur le terrain?
M. Brazeau: Le point de vue différent exprimé par les médecins spécialistes reflète le progrès technique marqué acquis depuis les cinq dernières années. Ce progrès technique a permis de dissiper la confusion qui existait dans la population et la profession médicale.
Les gens impliqués dans le traitement de la douleur et le domaine des soins palliatifs ont bénéficié également de cette évolution de telle sorte que l'information s'est étoffée. Ils sont plus à l'aise pour prendre des dispositions médicales et professionnelles susceptibles de choquer.
Nous parlons beaucoup de nos jours de l'imputabilité des médecins. Nous serions tout à fait prêts aujourd'hui à défendre des décisions qui trancheraient nettement avec celles que nous aurions prises il y a cinq ans.
Ce genre de commentaire témoigne du pouvoir décisionnel que les médecins ont pris suite à une expérience clinique bien définie, à savoir qu'une meilleure compréhension des problèmes leur facilite la tâche. C'est ce qui amène le Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada à mettre l'accent sur des programmes éducatifs visant une meilleure compréhension des lois canadiennes, entre autres, comme l'une des solutions importantes qui nous permettra d'aller de l'avant.
Le sénateur Pépin: Est-ce une des raisons pour lesquelles nous devrions investir plus de fonds dans les programmes de formation?
M. Brazeau: Nous vivons une période importante au Canada quant au changement d'attitude concernant le financement des services de santé. Il ne s'agit pas que d'un problème de financement. Nous ne devons pas perdre de vue la nécessité d'une meilleure intégration de ces services. Les gens travaillent de plus en plus en équipe ou de concert avec d'autres personnes ou d'autres groupes. Développer des modèles nécessaires pour une meilleure intégration des services est un processus complexe. C'est le défi majeur des prochaines années. Nous avons la capacité de développer des modèles de gestion différents, adaptés aux régions, d'un océan à l'autre du pays. Ce n'est pas en un an ou deux que nous pourrons le faire, mais la communauté médicale est prête à relever ce défi. C'est de cette façon que la population devrait observer le renouvellement des services de santé.
Le sénateur Pépin: Nous devons simplement continuer d'apprendre à travailler avec les différents paliers.
M. Brazeau: Nous devons oser le faire et ne pas oublier le temps que cela a pris pour implanter les services de santé tels que nous les connaissons aujourd'hui au Canada.
[Traduction]
Le sénateur Pépin: J'ai une question pour la représentante de l'Association des infirmières et infirmiers du Canada.
C'est vous qui travaillez jour après jour avec la loi ou les recommandations. Quels sont certains des éléments d'un système de soins palliatifs de qualité? Quelles sont les choses que vivent aujourd'hui les familles des patients?
Mme Nield: L'élément le plus important est l'accès dans le cadre d'un système intégré et coordonné. Par exemple, les infirmières qui travaillent dans des centres de santé communautaires en Ontario nous ont dit qu'elles ne peuvent pas aider leurs clients à bénéficier d'un programme de soins palliatifs sans un diagnostic particulier leur y donnant droit. Le patient n'est peut-être pas en train de mourir assez activement pour avoir droit au programme de son secteur. Si l'accès à un programme est limité aux patients en train de mourir très activement parce qu'il y a peu de ressources disponibles pour ce programme, cela ne va pas dans le sens du vaste système intégré que nous demandons aujourd'hui. Il faut qu'il soit intégré dans cet éventail de soins, en particulier avec les soins de longue durée et le traitement des maladies chroniques. Il faut offrir à la fois un traitement approprié ainsi que l'atténuation de la douleur et des symptômes, de même qu'un soutien psychologique, spirituel et affectif au malade dans le contexte de sa famille.
Dans quelle situation les gens se trouvent-ils aujourd'hui? Certaines personnes qui ont beaucoup de chance se trouvent dans cette situation-là. Les infirmières qui travaillent à l'intérieur de ce système ont l'impression d'avoir beaucoup de chance d'y être et de pouvoir fournir des soins dans ce contexte. Toutefois, beaucoup de gens n'y ont pas droit, pour toutes sortes de raisons. À cause du manque d'accès, à cause de l'endroit où ces personnes vivent, de son éloignement, elles ne peuvent pas avoir accès à des services de soins palliatifs. Elles sont peut-être confrontées aux problèmes liés à une mort prochaine dans un hôpital de soins actifs qui ne dispose pas des ressources nécessaires pour offrir des soins palliatifs, manque de personnel, est sous-financé et surchargé. Elles sont peut-être confrontées à cela dans leur foyer où elles ne peuvent bénéficier que d'une aide à domicile très limitée. Les infirmières qui fournissent des soins communautaires ou à domicile nous disent que c'est une situation très difficile. Je pense que les patients et leurs familles seraient du même avis.
Le sénateur Pépin: Quelqu'un a dit que nous devions apprendre à travailler ensemble. Je conviens qu'il y aura des variations d'une région à une autre parce que nous envisageons les choses différemment. Toutefois, vous avez dit que l'accès serait difficile et vous avez dit pourquoi. Est-ce aussi parce que le patient manque d'argent? M. Poston a dit que le coût des médicaments varie. Il a aussi dit que, selon la quantité d'argent qu'ils ont, certains peuvent recevoir des meilleurs médicaments. Est-ce que cela varie parce que la législation varie d'une province à une autre?
M. Poston: Cela varie à cause des différences entre les régimes d'assurance-médicaments des diverses provinces, et cela dépend aussi, bien entendu, de l'âge du patient et de sa situation financière. En règle générale, plusieurs de ces facteurs ont une incidence sur la capacité de quelqu'un à avoir droit à une aide pour l'achat de médicaments.
Le sénateur Pépin: Je vous ai peut-être mal comprise, mais n'avez-vous pas dit que les familles ou des gens retiraient les patients de l'hôpital?
M. Poston: Nous avons entendu parler de patients qui, malgré les codes de déontologie en vigueur en médecine, signalaient que les directives préalables n'avaient pas été respectées.
Lorsque cela s'était produit dans le milieu hospitalier, la famille avait décidé de s'occuper du patient à son domicile.
Le sénateur Pépin: Quelles sont les principales questions qui se posent aux infirmières quand elles doivent s'occuper d'un patient en phase terminale?
Mme Nield: Le manque de clarté au sujet de la façon de tenir compte des directives préalables et des souhaits du patient pose un gros problème aux infirmières qui fournissent des soins à domicile ou au niveau communautaire.
Je crois que les problèmes déontologiques individuels sont mieux maîtrisés. Je crois qu'il y a plus d'éducation, de compréhension, de collaboration, mais l'utilisation accrue des techniques de pointe, d'une part -- la possibilité de faire appel à des modalités de soins actifs d'une très haute technicité -- et le manque de ressources pour les soins communautaires et à domicile, de l'autre, créent une situation très délicate.
Nos spécialistes de l'éthique infirmière nous rappellent que, quand nous utilisons des expressions à connotation négative comme «l'abstention et l'interruption de traitement», il en résulte souvent que les patients ont l'impression qu'on va les priver de quelque chose. Si nous pouvons essayer davantage de fixer des objectifs en matière de soins qui tiennent compte des options offertes aux patients et de leurs besoins individuels, cela créera de meilleures conditions.
[Français]
Le sénateur Corbin: Docteur Brazeau, j'essaie de comprendre quel est le rôle spécifique du Collège Royal des médecins et des chirurgiens du Canada quant à la formation générale des cadres médicaux. Y a-t-il à l'heure actuelle, dans les facultés de médecine réparties à travers le Canada, une formation adéquate des médecins avant d'atteindre un niveau quelconque de spécialisation? Y a-t-il une formation adéquate au niveau des soins palliatifs? Ou serais-ce plutôt un sujet qui ne serait qu'effleuré? On nous a dit, il y a cinq ans, qu'on y consacrait quelques heures, pour ensuite passer à des sujets plus intéressants.
M. Brazeau: Je dois vous répondre par la négative, ce n'est pas adéquat. Je dois aussi vous répondre que c'est précisément pour cette raison que des dispositions ont été prises pour corriger la situation. Il y a donc eu intégration des services. En ce qui concerne la profession médicale, le premier aspect de l'intégration des services sur lequel on doit se pencher est l'intégration des services médicaux entre les spécialistes, les médecins de famille et les collègues.
Nous avons abordé la question de la médecine palliative conjointement avec le Collège des médecins de famille du Canada et nous avons convenu d'un programme d'une année de formation supplémentaire en médecine palliative. Il est certain que cela n'est pas suffisant, mais c'est un début.
Le sénateur Corbin: C'est toutefois beaucoup plus que ce qui se faisait.
M. Brazeau: Oui, et je vous ai d'ailleurs remis la liste des facultés de médecine qui ont déjà des programmes et celles dont les programmes seront bientôt approuvés. Néanmoins, les modifications qui découlent de nos standards et de nos règles par spécialité, par rapport à ces questions sont encore plus importantes.
Il y a même un élément peut-être plus important: certains disent que l'on fait encore, en médecine, les frais de la révolution industrielle et qu'on a un peu trop fragmenté le patient en médecine spécialisée.
C'est donc pour adresser des questions de ce genre, que dès 1996, le Collège Royal s'est penché sur la formation générale, ainsi que sur tous les aspects de cette formation concernant le médecin spécialiste qui doit accorder beaucoup plus d'importance à ces divers rôles, et non seulement à celui de médecin-expert, mais aussi à celui de communicateur. J'associe d'emblée le rôle de communicateur aux défis qui l'attendent en termes d'intégration des services.
Ce n'est pas adéquat, mais ce n'est pas une situation que nous laissons aller. Des actions se prennent depuis des années, les premiers résultats sont manifestes et il y a plusieurs autres actions qui seront prises pour s'assurer d'une progression.
[Traduction]
Le sénateur Corbin: Je voudrais aborder une question plus générale et inviter n'importe lequel des témoins à répondre s'il le souhaite.
J'ai eu l'impression que les organisations représentées ici ce matin désiraient -- plus ou moins manifestement -- élaborer elles-mêmes les codes de déontologie, et j'entends par là, dans une certaine mesure, à l'exclusion du gouvernement ou des gouvernements.
En d'autres termes, vous nous dites: «Parmi tous les gens de notre pays, c'est nous qui sommes les mieux placés pour élaborer des codes de déontologie et des pratiques en matière de soulagement de la douleur humaine qui soient importants et en accord avec la réalité actuelle. Mais le gouvernement peut nous fournir les fonds nécessaires, bien entendu.» Je suis d'accord avec la dernière partie. Il y a des initiatives sous-financées qui méritent davantage d'attention. Je reviens à ce que j'appelle votre «conception corporatiste». Dans une certaine mesure, je suis aussi de cet avis. C'est vous les praticiens, avec votre éducation, votre formation, votre expérience, vos connaissances et l'enrichissement mutuel qu'apporte la pratique quotidienne, qui êtes les mieux à même, si vous décidez de le faire, d'élaborer un code de déontologie et de pratique de caractère général visant à soulager la douleur humaine et à rendre plus supportable le passage à la mort.
Je me demande si vous comprenez ce que je veux dire.
Dr Henry Dinsdale, président sortant, Conseil national d'éthique en recherche sur l'humain, Collège Royal des médecins et chirurgiens du Canada: Madame la présidente, si vous me permettez de répondre à cela, c'est une question extrêmement importante. Je m'appuierai peut-être sur une comparaison avec le Royaume-Uni, où, en 1973, le ministère de la Santé a demandé au Collège Royal des médecins de Londres de préparer des lignes directrices pour examiner du point de vue éthique l'utilisation d'êtres humains dans la recherche. Le gouvernement souhaitait nettement une interaction. Le Collège Royal des médecins a répondu en composant un ensemble de lignes directrices que le ministère de la Santé du Royaume-Uni a adopté deux ans plus tard.
Je pense qu'un des problèmes que nous avons au Canada est le fait que le gouvernement sous-utilise nettement la force et la sagesse immenses des professionnels de notre pays. La situation est très confuse. Je pense que le Dr Crelinsten y a fait en partie référence.
Nous le constatons, par exemple, à la direction générale de la protection de la santé et dans certains éléments de la réglementation des médicaments; il y a déjà une interaction très étroite entre les responsables gouvernementaux de la réglementation et l'industrie, mais il y a énormément de choses à apprendre en ce qui concerne l'interaction avec les professionnels qui sont désireux et capables de conseiller les autorités.
Pour moi, c'est un des problèmes concrets à régler dans le système de soins de santé.
Il est un peu étrange que, dans un système fédéral, on puisse promulguer des normes nationales principalement par l'entremise d'organisations non gouvernementales ou relativement indépendantes.
Par exemple, au Collège Royal, nous pouvons établir des normes nationales pour la formation des spécialistes et l'exercice de leur profession, même si, bien entendu, chaque province a son propre organisme d'accréditation. Il en va de même pour les associations d'hôpitaux. C'est un peu étrange, mais ces groupes qui sont un peu en retrait et ont une grande force morale sont capables de fixer des normes, de les faire respecter et de les faire agréer dans l'ensemble du pays.
Quelqu'un a posé une question à propos du fait que Santé Canada n'avait pas répondu à certaines des suggestions antérieures concernant les lignes directrices. J'aurais aimé savoir si le ministère était resté muet à ce sujet ou y avait répondu. C'est seulement au cours des derniers mois que Santé Canada a commencé à préparer quelque chose sur l'éthique. Le ministère commence à réfléchir à cette situation et à se demander quel rôle il devrait jouer vis-à-vis de certaines de ces questions. Je n'ai aucune idée de ce qu'il trouvera comme réponses, mais je pense qu'il commence à se poser les questions pour la première fois.
Le Dr Brazeau a mentionné que je suis président sortant du Conseil national d'éthique en recherche chez l'humain, un groupe qui reçoit l'appui du Collège Royal, des trois conseils de recherche subventionnaires et de Santé Canada. Une importante question qui se pose maintenant est de savoir comment nous allons évaluer les commissions de déontologie de la recherche de tout le pays? Le Collège Royal offre des modèles pour les types de mécanisme dont nous avons besoin. Il faudrait poser une question claire à ces organisations professionnelles, et le gouvernement peut faire ce qu'il veut de leurs réponses. Nous devons développer davantage cette interaction.
Mme Sholzberg-Gray: Je pense que le Dr Crelinsten parlait de l'importance de l'élaboration de lignes directrices cliniques et du rôle de l'Association médicale du Canada à cet égard. Je pense que son rôle est important. Cela dit, il est toutefois important que Santé Canada joue une sorte de rôle d'intermédiaire par l'entremise des comités fédéral, provinciaux et territoriaux qui se rencontrent régulièrement. Là encore, cela montre la complexité de notre pays, où nous avons un système fédéral et un partage des responsabilités en matière de santé. Selon certains, le gouvernement fédéral devrait établir des normes nationales et utiliser son pouvoir de dépenser. Mais certaines provinces ne seraient pas d'accord et diraient que la prestation des services relève des gouvernements provinciaux. D'une façon ou d'une autre -- c'est-à-dire par l'entremise des comités fédéral, provinciaux et territoriaux -- du travail reste à faire. En outre, l'aide du gouvernement fédéral pourrait se manifester en finançant certaines activités, par exemple en réunissant un certain nombre d'intervenants comme les associations nationales, qui ne sont pas les seuls experts en la matière, en tenant compte du fait que l'intérêt public doit être représenté dans tout mécanisme de coopération.
Le gouvernement fédéral pourrait agir de différentes façons pour regrouper les gens sans imposer quoi que ce soit. Nous avons tous dit qu'il ne devrait établir des lignes directrices et les imposer à qui que ce soit. Je pense que c'est une question complexe à propos de laquelle nous avons tous un rôle à jouer, y compris les gouvernements et le public.
M. Poston: Vous avez dit que les professions peuvent jouer un rôle clé dans l'élaboration de la déontologie et des lignes directrices. Toutefois, faut-il faire des recherches pour que ce processus puisse s'appuyer sur leurs conclusions et faut-il collecter et analyser systématiquement des données qui serviront à formuler des lignes directrices et des énoncés déontologiques? Comme l'a dit Mme Sholzberg-Gray, une consultation publique est réellement nécessaire pour que nous sachions clairement quelles sont les valeurs sociétales fondamentales sur lesquelles baser cette déontologie. C'est particulièrement important, étant donné la nature multiculturelle du Canada.
Comme la présidente l'a signalé, nos commentaires au sujet de ce qui s'est fait en Oregon reposent uniquement sur le fait que, dans notre mémoire de 1995, nous posions certaines conditions en disant «si le gouvernement faisait telle ou telle chose...» Nous attirons l'attention du comité sur certaines recherches et sur quelque chose qui avait été fait à propos de certaines des conditions que nous avions mentionnées, du type «s'il en était ainsi». Ce sont les leçons tirées de ce qui s'est fait ailleurs, ce qui fait partie du processus de recherche, qui nous aideront à savoir comment élaborer ces lignes directrices et les codes de déontologie appropriés.
Le sénateur Beaudoin: Je voudrais revenir à la question fondamentale du Code criminel. Je suis très surpris d'entendre dire qu'une modification du Code criminel est moins nécessaire aujourd'hui qu'en 1995.
Il est difficile d'amender le Code criminel, même si nous le faisons régulièrement de temps à autre. C'est toutefois beaucoup plus difficile dans ce domaine. Le public est-il au courant des différences entre l'abstention et l'interruption d'un traitement, etc.? À mon avis, il ne l'est pas.
Je me rappelle une discussion que j'avais eue avec des experts de ce domaine. En 1995, nous sommes parvenus à établir un glossaire. Qu'est-ce que l'euthanasie? Qu'est-ce que l'aide au suicide? Dieu merci, nous avons réussi à le faire. C'est un élément très positif, à mon avis. Toutefois, cela ne veut pas dire que tout le monde est d'accord avec ce glossaire. C'est le problème. L'unanimité s'est faite dans de nombreux domaines, mais dans deux autres, il y avait des avis majoritaires et minoritaires. En fin de compte, nous rédigerons un projet de loi à propos des questions sur lesquelles nous nous sommes entendus unanimement. Nous aurions dû le faire beaucoup plus tôt, mais nous n'avons pas réussi à le faire.
Il y a deux façons de régler ce problème. Nous pouvons nous en remettre aux tribunaux ou faire notre travail. Notre travail, ici, est d'élaborer de meilleures lois. Pour moi, il ne fait aucun doute que nous avons beaucoup à faire. Les provinces ont une compétence très grande dans ce domaine. En ce qui concerne le Code criminel, c'est nous qui sommes rois, mais pas en ce qui concerne la santé et le bien-être. Notre rôle est très important, mais il n'y a pas que nous.
[Français]
Docteur Brazeau, pourquoi dites-vous qu'on n'a pas besoin d'amender le Code criminel?
M. Brazeau: Nous ne disons pas qu'il n'est pas nécessaire de modifier le Code criminel. Nous disons que dans la perspective de la médecine spécialisée, il n'est pas nécessaire de changer le Code criminel. Nos médecins spécialistes nous affirment qu'avec l'expérience acquise au cours des dernières années, une meilleure compréhension du contenu du Code criminel, de sa signification ainsi que de la façon de l'appliquer dans le quotidien a largement répondu à leurs préoccupations et enlevé les obstacles présents quant à l'administration de soins spécialisés au Canada. Nous n'excluons pas pour autant qu'il pourrait être nécessaire de le faire pour d'autres raisons.
[Traduction]
Le sénateur Beaudoin: Je suis tout à fait d'accord avec vous.
La présidente: Sénateur Beaudoin, j'ai une question supplémentaire. Quand il a comparu ici la semaine dernière, le représentant des médecins de famille a indiqué qu'à cause de l'affaire Dre Nancy Morrison en Nouvelle-Écosse, certains étaient très réticents à fournir des quantités suffisantes d'opiacés -- pas du chlorure de potassium, c'était une question tout à fait différente. Les médecins ne voulaient plus donner maintenant des quantités suffisantes d'analgésiques. Quelle est votre réaction à ce sujet?
Dr Brazeau: Nous avons fait spécifiquement allusion à cela quand nous avons discuté de cette question avec les médecins spécialistes. En fait, ils n'ont pas exprimé le même point de vue que les médecins de famille. Ils disent qu'ils voient les choses différemment. J'ai indiqué tout à l'heure au sénateur Pépin que ceux qui commentent maintenant cette situation nous disent que, dans leurs propres unités, ils peuvent interpréter plus clairement les dispositions de la loi, la façon dont elle devrait être appliquée et ce qu'il leur est possible de faire.
Ils ont l'impression que leur liberté d'action est plus grande et ils sont prêts à aller plus loin, à faire les analyses nécessaires pour prendre les décisions requises et à prendre les mesures nécessaires et, finalement, ils sont prêts à défendre leurs actions et à en assumer la responsabilité.
Le sénateur Beaudoin: Je serais d'accord avec vous en ce qui concerne les soins palliatifs. À mon avis, il n'y a aucun problème à leur sujet. Il y a une question d'argent et certains autres facteurs, mais les soins palliatifs ne posent pas un gros problème. Nous sommes tous en faveur de cela. Les provinces ont beaucoup à faire, puisque l'hospitalisation relève d'elles. Il ne faut pas oublier cela.
Nous avons aussi beaucoup à faire en matière de santé au niveau des autorités fédérales. Il y a une jurisprudence dans le domaine de l'abstention et de l'interruption d'un traitement. À mon avis, ce n'est pas suffisant. Il faudrait que ce soit plus clair, et la seule façon de rendre cela plus clair est d'amender le Code criminel afin de protéger les médecins et les infirmières. Ils sauront enfin ce qu'ils peuvent ou ne peuvent pas faire. À mon avis, ce n'est pas une mauvaise chose.
Dr Brazeau: Je répète que notre intention n'est pas de vous empêcher de faire cela. D'après nos discussions avec les spécialistes que nous avons mentionnées, j'ai l'impression qu'on peut se livrer à d'autres réflexions. Il est tout à fait clair que les spécialistes auxquels nous avons parlé sont convaincus que si l'on va plus loin et qu'on progresse beaucoup sur le plan des soins palliatifs, cela aura des répercussions sur d'autres questions dont nous sommes saisis, y compris l'abstention et l'interruption de services, et que cela simplifierait probablement considérablement certaines des autres questions auxquelles ils sont confrontés ou auxquelles ils l'ont été dans le passé.
La préoccupation fondamentale est que, si le Code criminel est modifié, comme l'ont proposé beaucoup de nos membres, il nous faudra alors passer par l'étape de l'interprétation des nouvelles règles. Pour le moment, ils s'inquiètent des importantes conséquences que pourrait avoir une modification du Code criminel. Ils ne considèrent pas nécessairement que ces conséquences seraient essentiellement et fondamentalement positives.
Dr Crelinsten: Dans notre exposé, ce matin, nous avons dit que l'Association médicale du Canada maintenait les recommandations qu'elle avait faites le 23 novembre 1994. Il est important de répéter publiquement notre recommandation à ce sujet. Comme le sénateur Beaudoin, nous pensons qu'il est important de clarifier la partie générale du Code criminel afin que les médecins ne commettent pas un délit si, quand un patient ne veut pas d'un traitement, ils abstiennent de l'administrer ou l'interrompent. Nous avons fait cette recommandation en 1994, et je pense que l'Association médicale du Canada défendrait encore ce point de vue.
Mme Sholzberg-Gray: J'hésite un peu à parler de la loi. Je dois admettre qu'il fut un temps où j'exerçais le métier d'avocat. Plus maintenant. Je comprends la préoccupation du sénateur Beaudoin à propos du fait de se fonder sur la jurisprudence, car celle-ci n'est pas toujours très claire et ne dit pas toujours aux gens de ce secteur ce qu'ils doivent faire -- aux médecins, aux infirmières et à d'autres, y compris les hôpitaux qui sont membres de mon association nationale.
La déclaration conjointe sur le règlement des conflits éthiques à laquelle nous avons fait référence est un pas dans la bonne direction. Elle repose notamment sur une clarification et une compréhension de ce que signifie l'abstention et l'interruption de traitements et de la nécessité d'établir une communication appropriée entre les familles et les prestataires de soins. Espérons que cela veut dire que les hôpitaux et les professionnels ne feront pas l'objet de poursuites ou de procès. Les choses seraient apparemment plus claires si ces questions étaient clarifiées dans le droit criminel, domaine dans lequel le gouvernement fédéral a une compétence absolue.
Toutefois, une raison que les gens avancent pour ne pas le faire est que les déclarations conjointes de ce genre ont eu pour effet que, dans la pratique, les gens semblent arriver très bien à expliquer ce que sont l'abstention et l'interruption de traitements et qu'il n'est donc peut-être pas nécessaire de modifier le Code criminel. Mais il est possible que ce soit nécessaire pour clarifier davantage les choses.
Le sénateur Beaudoin: C'est une chose intéressante parce que cela vient des experts, et je fais confiance aux experts. Il y a aussi les lignes directrices. Vous dites qu'au Royaume-Uni, la Chambre des lords a entrepris des consultations pour en savoir davantage au sujet des lignes directrices. Je pense qu'elle a raison, et nous devrions aussi le faire dans notre pays. Notre problème est toutefois plus compliqué. Nous avons parfois besoin de lignes directrices dans la loi, en particulier en ce qui concerne la Charte des droits et libertés. Il y a une jurisprudence énorme -- 400 décisions -- au sujet de cette Charte. Il faut être un véritable expert pour comprendre tout cela. Cela s'applique à chacun, et notre monde devient de plus en plus complexe.
Je conviens que nous, qui représentons le pouvoir législatif, ne devrions pas rédiger ou établir des lignes directrices sans consulter les médecins, les infirmières, les hôpitaux, et cetera. parce qu'ils savent des choses que nous ne connaissons pas. Nous devons toutefois faire notre travail. Le Parlement ou le Gouverneur en conseil doivent parfois élaborer des lignes directrices après avoir consulté les autorités concernées pour que la population sache exactement ce qu'elle peut ou ne peut pas faire.
Si vous donnez ce pouvoir à certains groupes, pour aussi brillants qu'ils puissent être, les résultats pourraient varier d'une province à une autre. Nous avons besoin de certaines normes dans notre pays en matière de soins de santé. Quand quelque chose figure dans le Code criminel, il n'y a aucun problème parce que cela s'applique dans tout le pays. C'est un élément très positif. Ceux qui n'ont pas un tel système voient ce qui se passe au Canada et disent que nous avons bien raison. Dans ce sens, même si nous devrions pratiquer une vaste consultation, nous devons reconnaître qu'en fin de compte, les lignes directrices devraient être contenues dans nos lois et nos règlements. Voulez-vous vous en remettre pour cela aux médecins et aux associations, au risque qu'il y ait des différences d'une province à une autre? Cela m'inquiète.
Dr Brazeau: Nous convenons que nous devrions avoir des normes nationales, et nous sommes une organisation nationale de normalisation. Nous considérons que notre rôle est très efficace dans notre domaine d'intervention. Au plan international, tout comme vous l'avez signalé antérieurement, on considère que c'est un net atout pour le Canada d'avoir une association de ce type pour établir des normes.
Plus précisément, pour ce qui est de la façon éventuelle de clarifier les choses, je ne prescris rien, mais j'indique que nos membres ne jugent pas que c'est nécessaire pour le moment. Cela pourrait l'être pour d'autres groupes de la société. Il est aussi important d'établir des distinctions entre les questions dont nous avons parlées pour ce qui est des lignes directrices concernant les questions éthiques et les pratiques utilisées. Nos propres organisations prennent de plus en plus conscience de la nécessité d'associer le public à tout ce que nous faisons. Nous réalisons maintenant nos activités avec la participation de profanes au sein de nos commissions, de nos groupes et de nos comités, et leur contribution est très importante. Cela nous aide certainement à progresser.
Je n'ai pas d'avis définitif à propos de ce que nous devrions faire au sujet du Code criminel. J'ai seulement présenté notre propre opinion là-dessus.
Dr Crelinsten: Ce n'est pas une situation facile à examiner. Ce qu'il faut clarifier tient probablement en grande partie beaucoup plus à la signification réelle des mots qu'à l'organisation opérationnelle des lignes directrices.
Je faisais référence aux types de lignes directrices que les professionnels des soins de santé utilisent pour la pratique clinique. Elles permettent aux professionnels des soins de santé, d'après les preuves accumulées, de procéder d'une façon telle qu'il y a plus de chances que les résultats soient bons plutôt que mauvais.
Il vaut mieux que ce soit des professionnels de ce secteur qui établissent des lignes directrices de ce type, qu'elles portent sur le traitement de l'infarctus aigu du myocarde, les patients en phase terminale ou les cancers complexes.
Il ne fait aucun doute que Santé Canada, en tant que branche du gouvernement, est tenu d'aider, moralement ou financièrement, les groupes professionnels qui pourraient avoir à préparer ces lignes directrices et à faire effectivement ce travail. Le ministère pourrait même mettre à la disposition de sociétés professionnelles les experts appropriés dont elles pourraient avoir besoin pour améliorer leurs lignes directrices. Ce sont toutefois les professionnels censés exercer en vertu de ces lignes directrices qui devraient être responsables en dernière instance de déterminer les connaissances, les habiletés et les attitudes nécessaires pour réaliser ces lignes directrices sur la pratique clinique qui influencent les interactions entre les professionnels des soins de santé et les patients.
Si vous me le permettez, je parlerai maintenant à titre personnel plutôt qu'au nom d'une organisation. En fin de compte, les législateurs et le gouvernement ont pour rôle de fournir aux organisations professionnelles de notre pays une référence morale en fonction de laquelle mesurer les valeurs de la société, pour que nous puissions alors les rendre opérationnelles à votre intention.
Quand vous nous dites quelles sont valeurs, nous avons du mal à les rendre opérationnelles, principalement à cause des questions qui tournent autour du financement, des ressources humaines et du savoir. Voilà ce que je voulais dire à propos de l'élaboration des lignes directrices par des organisations professionnelles qui doivent aussi administrer ce règlement elles-mêmes et veiller à obtenir le meilleur résultat possible, mais en comptant sur la forte contribution que peuvent fournir des organisations comme Santé Canada pour ce qui est des références morales et de la structure organisationnelle.
M. Poston: Mon collègue de l'AMC a signalé avec éloquence que l'élaboration de lignes directrices qui seront utilisées par les praticiens pour prendre les décisions relatives aux soins à administrer à leurs patients incombe aux professions. Santé Canada, de concert avec les provinces, a toutefois un rôle absolument essentiel qui consiste à fournir la structure, le financement et l'administration relativement au système de soins de santé. Le contexte dans lequel les praticiens auront à prendre ces décisions et à fournir ces soins pourra ainsi les aider à accomplir leurs tâches et sera adapté à leurs besoins.
Un exemple de cela est la récente initiative de Santé Canada à propos du développement des soins à domicile. C'est un très bon exemple, même s'il s'agit d'une tâche extrêmement difficile. Les soins à domicile varient beaucoup, sont fragmentés et sont financés de diverses façons. Santé Canada a toutefois un rôle essentiel à jouer pour ce qui est de faciliter et de développer ce processus. Nous pourrons ainsi parvenir à une plus grande harmonisation pour ce qui est de l'accessibilité aux services, de leur nature et du financement disponible. Les praticiens pourront alors travailler dans un contexte leur permettant de fournir des soins dignes de nos patients.
Le sénateur Beaudoin: Cela se situe dans le cadre de notre pays, qui est une fédération. Nous devons respecter la constitution et la division des pouvoirs. Toutefois, il y a de nombreuses façons d'avoir une coopération entre Ottawa et les provinces. Nous sommes des experts dans ce domaine. Il y a aussi la question de l'argent et du fameux pouvoir de dépenser. Si nous avons trop d'argent, nous pouvons le dépenser à bon escient. Je pense que c'est le cas pour la santé.
[Français]
Le sénateur Pépin: Mon approche est quelque peu différente et se base sur mon expérience sur le terrain. Lorsque j'étais infirmière et que nos médecins spécialistes venaient, nous devions appliquer les règlements. Évidemment, ils étaient les patrons du département.
Souvent on leur disait: «C'est vrai ce que vous dites mais quand vient le temps d'appliquer les règlements, il faudrait arrondir certains coins, améliorer certaines façons de faire. Ce serait plus facile et cela nous causerait beaucoup moins d'ennuis». Nous faisons face au quotidien des infirmiers et infirmières qui appliquent les règlements en matière de soins palliatifs et nous faisons face aux experts qui nous donnent leur avis.
Je crois qu'il sera bien intéressant de communiquer de nouveau avec vous.
[Traduction]
La présidente: Madame Nield, vous avez indiqué qu'on laisse les patients sortir des hôpitaux «plus vite et moins bien». Je pense que c'est ce que vous avez dit. Je pense que nous sommes tous d'accord. J'ai toutefois constaté personnellement qu'on les laisse toutefois quitter l'hôpital sans leur donner beaucoup de directives ni d'appui et sans leur fournir beaucoup d'aide financière.
D'après ce que vous observez, qu'est-ce qui vous paraît nécessaire pour que des soins palliatifs de qualité, que fournissent, je pense, nombre de nos hôpitaux pour personnes âgées, puissent aussi être fournis dans le cadre d'un système de soins à domicile?
Mme Nield: Ce qui est nécessaire est un système intégré permettant d'offrir des soins communautaires et à domicile du même type que ceux qui sont offerts dans les hôpitaux. Cela inclurait l'accès à des professionnels appropriés, le financement des médicaments et des traitements et l'offre de services de soutien aussi bien au patient lui-même qu'aux membres de sa famille qui s'occupent de lui.
On nous a dit aujourd'hui qu'on se décharge souvent des soins communautaires et à domicile en les confiant aux membres de la famille des patients. J'ai ici un rapport de recherche publié par Condition féminine Canada qui indique qu'on s'en décharge souvent en confiant les soins à domicile aux femmes qui en souffrent de différentes façons, qu'il s'agisse de l'avancement de leur carrière, de leur santé ou de la pauvreté.
Une des questions auxquelles les infirmières ont été confrontées au cours de la dernière décennie est la forte réduction des fonds disponibles pour le perfectionnement et l'éducation de celles qui travaillent à titre d'employées. Elles ont beaucoup de mal à améliorer leurs compétences en matière de soins palliatifs et de soins à domicile.
L'Association canadienne des soins palliatifs a un comité des sciences infirmières qui nous a demandé de mettre sur pied un programme d'agrément pour les infirmières spécialisées en soins palliatifs. Actuellement, il n'existe aucun financement pour cela. Si cette question était réglée, cela permettrait de progresser à cet égard.
La présidente: Monsieur Poston, quand vous avez présenté votre information, j'ai trouvé préoccupant que vous indiquiez apparemment que votre association ne croit pas qu'on met suffisamment d'opiacés à la disposition d'un grand nombre de patients de notre pays pour les traiter.
M. Poston: Depuis 1995, nous avons constaté une amélioration dans l'utilisation de médicaments pour les soins palliatifs. Ce qu'on nous signale -- et je pense que c'est aussi ce que vous a dit le Collège des médecins de famille -- est que certains médecins sont encore réticents à fournir un dosage adéquat, ce qui montre qu'une formation et une éducation permanente sont nécessaires dans ce domaine.
La présidente: À votre connaissance, y a-t-il plus de chances qu'il en soit ainsi dans le cas des soins à domicile ou en milieu hospitalier?
M. Poston: Il y a plus de chances qu'il en soit ainsi pour les soins communautaires ou à domicile, parce que les médecins n'ont pas reçu une formation pour cela. Cela montre réellement la nécessité d'une éducation et d'une formation en ce domaine, oui.
La présidente: Je pense que la profession s'est maintenant rendu compte que le temps des médecins est également précieux.
Je félicite les médecins d'avoir finalement décidé qu'ils doivent aussi avoir le temps de s'épanouir dans leur vie privée. Personne ne peut être médecin pendant 24 heures par jour, pas plus qu'on ne peut être n'importe quoi d'autre 24 heures par jour.
Il me semble que cela nous amène à considérer un dilemme de plus en plus fréquent dans la société. Si nous voulons fournir de plus en plus de soins en dehors des établissements spécialisés, comment allons-nous restructurer l'horaire des médecins afin qu'ils puissent le faire alors que la structure actuelle repose principalement sur les consultations à leur cabinet et le milieu clinique? À mon avis, ils n'effectuent plus que rarement des visites à domicile. Comment allons-nous changer cette dynamique?
Dr Brazeau: Les médecins ont déjà indiqué qu'ils sont prêts à relever ce défi. Les références à la nécessité d'une meilleure intégration des services dans l'optique d'une gamme continue de services sont importantes. En fait, les membres du milieu médical sont rassemblés au sein du Forum médical canadien, organisme qu'appuie l'Association médicale du Canada. Il a examiné la question de l'insuffisance actuelle du nombre de médecins dans certaines spécialités, mais il met encore davantage l'accent sur la nécessité de commencer maintenant à oublier les idées reçues et de cesser d'examiner ces questions comme on le faisait autrefois en ce qui concerne les organisations du secteur de la santé. Nous commençons à parler des besoins.
En fait, cela n'étonnera personne, pour ce qui est des effectifs du corps médical, nous n'avons jamais tenu compte des besoins dans le passé. Nous avons simplement pratiqué une gestion de l'offre et essayé de définir indirectement les besoins. Nous devons maintenant aborder cette question de façon beaucoup plus efficace. Par chance, on commence maintenant à disposer de méthodologies appropriées qui n'existaient pas autrefois. Dans les milieux médicaux et en dehors d'eux, nous devons maintenant mettre l'accent sur la meilleure façon de collaborer, d'intégrer des services et de fournir toutes les formes de soins. Cela veut dire qu'il faudra probablement modifier le partage des responsabilités.
Dans notre société, les médecins ont déjà sollicité notre aide pour que, par exemple, dans les zones rurales, ils puissent se perfectionner, acquérir des compétences spéciales et à mieux soigner leurs patients. La collaboration des spécialistes sera nécessaire. Le Collège Royal a déjà déclaré publiquement que nous allons collaborer avec les médecins de famille pour y parvenir. Cela donne l'exemple. Le type d'intégration que nous pourrons peut-être réaliser au sein du milieu médical, qui nécessitera une éducation et une formation plus poussées ainsi que de nouveaux partages des responsabilités, est quelque chose que nous pouvons commencer à examiner et à modifier en ce qui concerne les relations entre les différents professionnels de la santé. Nous sommes prêts à le faire, nous avons commencé à relever ces défis. Les milieux médicaux le font au sein du Forum médical canadien qui regroupe toutes nos organisations différentes.
Dr Dinsdale: En fait, la question que vous soulevez concerne notamment l'utilisation du temps des médecins. À cet égard, outre l'interaction avec les autres professionnels de la santé, il est important que les médecins comprennent qu'on peut diviser leurs activités quotidiennes en quatre groupes différents. Il y a le rôle fondamental qu'ils doivent jouer en matière de diagnostic et de traitement. Il y a un rôle pastoral qui entraîne parfois diverses confusions. Il y a un fardeau administratif très lourd qui est imposé à de nombreux spécialistes dans les hôpitaux. Nous attendons aussi de beaucoup d'entre eux qu'ils fassent de la recherche. Ce sont quatre domaines importants et, dans leur esprit, les médecins savent très clairement quels rôles ils jugent essentiels dans un domaine où les professionnels sont beaucoup trop peu nombreux. L'interaction avec d'autres groupes est extrêmement importante, et, bien entendu, l'interaction avec les infirmières et les travailleurs sociaux est essentielle. Les gens doivent savoir clairement quel est leur rôle.
Cela dit, il me paraît très clair que, même si nous entendons beaucoup parler des soins communautaires, il s'agit-là, en réalité, de soins fournis par la communauté. On entend parler de l'immense fardeau que doivent supporter les femmes dans notre société à cause de cela. Je pense que nous devons nous rendre compte que c'est le résultat logique de la décision de se décharger des soins en les confiant à la communauté. Il n'y aura tout simplement pas assez de professionnels de la santé pour s'acquitter de cette tâche et, à cet égard, il faut examiner comment fournir une forme d'assistance, en particulier aux femmes qui ont à s'occuper de cela. Il y a une véritable réaction en chaîne qui se produit entre tous ces éléments.
Mme Sholzberg-Gray: Je sais que vous avez adressé votre question aux médecins, et il est évident qu'ils jouent un rôle important pour la prestation de toutes sortes de soins, y compris pour les patients en phase terminale, mais nous parlons des soins dispensés au niveau communautaire. Nous parlons non seulement des médecins, des infirmières et des travailleurs sociaux, mais de toutes les formes de soutien communautaire qui permettent aux gens de vivre dans cette communauté. Cela inclut les services d'aide ménagère et les services d'aide à domicile auxquels on n'a pas encore fait référence et qui pourraient aider les familles, en particulier les femmes, à s'occuper des gens qui sont en train de mourir dans leurs foyers. Nous devons examiner la multiplicité des services -- pas seulement les services professionnels, mais les services auxiliaires qui permettent aux gens de vivre dans la communauté. Il ne faut pas oublier cela. C'est un des éléments permettant de fournir toute une gamme de soins.
Le sénateur Corbin: M. Poston a fait une déclaration que je trouve troublante ou déconcertante. Il a dit que, dans certains provinces, on admet parfois des patients dans les hôpitaux pour qu'ils puissent recevoir des médicaments gratuitement. Il a dit aussi que, quand on considère que les patients vivent plus longtemps et que le fait de passer leurs derniers jours dans le milieu familial améliore beaucoup leur qualité de vie, il est apparemment contre productif et un peu inhumain de leur imposer l'hospitalisation à cause des médicaments.
Jusqu'à quel point cette pratique est-elle généralisée et qui est responsable d'imposer l'hospitalisation aux patients?
M. Poston: Je dirai que c'est quelque chose qui arrive assez souvent dans le système de soins de santé du Canada. Comme les médicaments ne sont pas couverts par la Loi canadienne sur la santé, on finit par garder les patients à l'hôpital pour les traiter en utilisant des médicaments coûteux.
Le sénateur Corbin: Parce qu'ils sont trop pauvres ou parce que leur famille ne veut pas payer?
M. Poston: Parce que les médicaments ne font pas partie de la Loi canadienne sur la santé, qu'ils ne sont pas couverts. Dans le système de soins de santé du Canada, il n'y a que les régimes provinciaux d'assurance-médicaments ou les régimes privés qui couvrent les médicaments. Cela a des répercussions sur les gens qui ne peuvent pas bénéficier d'un régime provincial. Il peut s'agir de chômeurs, mais cela concerne particulièrement les travailleurs faiblement rémunérés parce que, même s'ils ont un emploi, ils ne peuvent peut-être pas bénéficier des régimes d'assurance fournis aux assistés sociaux, tout en n'ayant peut-être pas les moyens de payer un traitement. Dans certaines provinces, pour les médicaments, le régime d'assurance n'entre en vigueur que quand les frais dépassent 1 700 $. C'est un réel problème.
Le sénateur Corbin: Cela s'ajoute donc au problème du nombre trop élevé de patients et des listes d'attente dans les hôpitaux pour les gens qui ont besoin d'une intervention médicale directe importante.
M. Poston: Une partie très importante de l'initiative fédérale concernant les soins à domicile consiste à examiner comment fournir une des choses que notre association a fortement recommandées, c'est-à-dire une assurance-médicaments dans le cadre de cette initiative nationale sur les soins à domicile, quelle que soit sa forme finale. Si cela existait, la décision de faire sortir un patient de l'hôpital n'exposerait pas celui-ci au risque de ne pas recevoir la thérapie médicamenteuse avec laquelle on avait peut-être stabilisé son état à l'hôpital. Un élément très important du développement des soins communautaires et à domicile est de veiller à ce que les gens aient accès aux médicaments appropriés.
Le Dr Dinsdale a parlé du fardeau administratif qui pèse sur les médecins. Un important fardeau administratif pour les pharmaciens privés et les médecins de famille est de s'y retrouver dans l'accès aux médicaments. Nous avons réalisé une étude qui montre que jusqu'à 70 p. 100 des nouvelles ordonnances établies au Canada imposent une tâche administrative supplémentaire aux pharmaciens, et souvent aux médecins de famille, pour déterminer la couverture du patient. Notre président travaillait dans sa pharmacie la semaine dernière, et il a dû envoyer une demande de remboursement de médicaments à six reprises pour six médicaments différents. Il essayait de trouver un antibiotique couvert par le régime d'assurance d'un patient et, pendant que le médecin était en attente au téléphone, il a transmis six demandes par Internet avant de trouver un antibiotique qui pouvait être couvert par le régime d'assurance du patient. C'est un bon exemple du lourd fardeau imposé aux pharmaciens privés et aux médecins de famille quand ils essaient d'améliorer l'accès aux médicaments.
Le sénateur Pépin: Je voudrais avoir une clarification. Monsieur Poston, vous avez mentionné que les prestataires de soins devraient être libres de refuser d'administrer un traitement donné, mais ne pensez-vous pas qu'ils devraient alors faire en sorte que le patient soit pris en charge par un autre médecin ou un centre de soins palliatifs?
M. Poston: Oui. Notre code de déontologie, et notre récente déclaration nationale sur le refus de soins exigent que, dans un tel cas, le patient soit orienté vers un autre endroit où il pourra avoir accès à ce service ou à ce produit.
La présidente: Je vous remercie beaucoup toutes et tous. Cette séance nous a beaucoup appris.
La séance est levée.