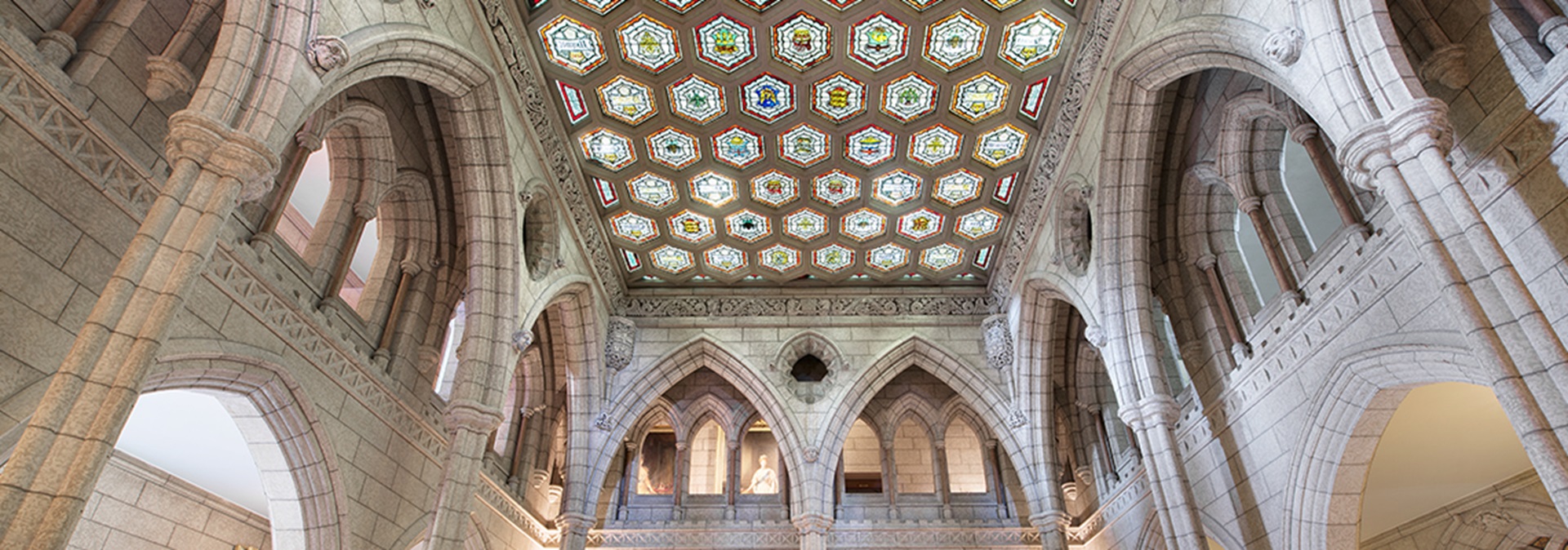Délibérations du sous-comité de
mise à jour de «De la vie et de la mort»
Fascicule 8 - Témoignages
OTTAWA, le mardi 28 mars 2000
Le sous-comité de mise à jour de «De la vie et de la mort» du comité sénatorial permanent des affaires sociales, des sciences et de la technologie se réunit aujourd'hui à 9 h 15 en vue d'étudier les faits nouveaux survenus depuis le dépôt, en juin 1995, du rapport final du comité sénatorial spécial sur l'euthanasie et l'aide au suicide intitulé: «De la vie et de la mort».
Le sénateur Sharon Carstairs: (présidente) occupe le fauteuil.
[Traduction]
La présidente: Honorables sénateurs, aujourd'hui marque le huitième jour des audiences tenues dans le cadre de notre mandat visant à mettre à jour les recommandations du rapport de 1995 sur l'euthanasie et l'aide au suicide intitulé: «De la vie et de la mort».
Je vous rappelle, à vous et à nos témoins, que le sous-comité ne reprend pas le débat sur l'aide au suicide et l'euthanasie. Il se concentre uniquement sur les parties du rapport où le comité initial avait fait des recommandations unanimes. Je vous demanderais de ne pas l'oublier.
Nous entendrons aujourd'hui deux groupes de témoins. Nous entendrons d'abord le Dr Neil MacDonald, du Centre de bioéthique de l'Institut de recherche clinique de Montréal. Je rappelle au sénateur Roche et au sénateur Beaudoin que le Dr MacDonald a déjà comparu devant notre premier comité. À cette époque, son témoignage portait sur la formation des médecins. Nous l'avons invité à comparaître de nouveau aujourd'hui pour parler plus précisément de la formation des médecins dans le domaine de la gestion de la douleur et des soins palliatifs. Bienvenue de nouveau, docteur MacDonald.
Dr Neil MacDonald, Centre de bioéthique, Institut de recherche clinique de Montréal: C'est avec plaisir que je viens vous rencontrer de nouveau, cinq ans après ma première comparution devant le comité sur l'euthanasie et l'aide au suicide. J'exerce la médecine palliative. Je travaille également dans un programme de bioéthique et je suis un ancien administrateur du centre d'oncologie. J'ai déjà été directeur du programme provincial d'oncologie et du Cross Cancer Institute d'Edmonton, en Alberta, il y a quelques années.
Puisque nous parlons d'enseignement, mes observations porteront uniquement sur l'enseignement des soins palliatifs. Je pourrais vous parler de l'enseignement général qui est dispensé aux professionnels, de la formation en soins palliatifs et, plus encore, de la formation offerte aux patients, aux familles et aux collectivités en soins palliatifs. Mes observations se limiteront toutefois à la formation des étudiants en médecine et des résidents des facultés de médecine. Je suis toutefois prêt à répondre à toutes vos questions sur les autres aspects de l'enseignement des soins palliatifs, si le temps le permet.
Il y a cinq ans environ, j'ai déclaré que la formation des médecins dans le domaine de la médecine palliative était clairement insatisfaisante. Cinq ans et cinq mois plus tard, j'aimerais bien pouvoir vous dire qu'il y a eu des améliorations spectaculaires, mais ce n'est pas le cas. La situation demeure insatisfaisante dans une grande mesure, même si dans certains domaines il y a eu quelques améliorations.
Je ne veux pas me limiter à la théorie, je veux aussi vous donner des exemples de ce que je dis, comme on peut le voir sur le transparent sur les soins en fin de vie. On a fait un examen de 50 grands manuels médicaux qu'étudient nos étudiants et nos résidents. Les gens qui ont réalisé cette étude ont examiné les chapitres sur les principales causes de décès. Comme vous le remarquerez, ils ont constaté que dans plus de la moitié de ces manuels on ne trouvait aucun renseignement utile pour les étudiants sur les patients qui meurent de cancer, de défaillance cardiaque, et cetera. On dirait presque que, dans les manuels de médecine, les gens ne meurent pas.
Vous remarquerez également que tant dans les meilleurs manuels que dans les pires la cote était un peu plus élevée en gériatrie et en médecine familiale, mais que les pires manuels étaient ceux qui portaient sur le cancer et le sida, deux maladies chroniques mortelles dans lesquelles la souffrance est évidente.
Parallèlement -- c'est-à-dire à la fin de 1998 ou en 1999 -- on a fait une étude intéressante sur les gens qui dirigent les stages des internes dans nos hôpitaux, plus particulièrement dans les hôpitaux américains. Dans le cadre de cette étude, on a demandé quels étaient les sujets les plus importants à enseigner aux résidents et aux étudiants. Aucun des répondants n'a parlé des soins en fin de vie. En tête de liste, on trouvait des sujets qui sont traditionnellement enseignés, entre autres l'hypertension, la gestion des maladies coronariennes et la gestion des maladies pulmonaires chroniques. Personne n'a parlé de la souffrance liée au cancer non plus que des soins en fin de vie.
Cela nous a intrigués, un certain nombre de mes collègues et moi. Vous vous souviendrez peut-être que je vous avais fourni des données provenant du Canadian Palliative Care Education Group. Ce groupe a des représentants dans chacune de nos facultés. Ils sont chargés d'observer le nombre d'heures d'enseignement des soins palliatifs. Nous avons fait des enquêtes régulièrement, et en 1999 nous avons commencé à demander aux étudiants en médecine ce qu'ils pensaient de leur expérience et du calibre de notre enseignement des soins palliatifs.
Voici un tableau illustrant les résultats d'une enquête menée à l'Université de l'Alberta et à McGill. Ces deux facultés sont probablement les meilleures facultés de médecine canadiennes pour l'enseignement des soins palliatifs, en raison de la nature de leurs programmes de recherche et de leurs heures d'enseignement.
On a demandé à nos étudiants ce qu'ils pensaient de l'enseignement relatif à l'hypertension et au cancer du sein. Nous avions prévu que les résultats de ces questions seraient extrêmement positifs. Une cote «1» signifie très bien et une cote «4» très mauvais. D'une façon générale, les étudiants ont estimé que l'expérience était bonne. Dans le cas des soins palliatifs, par contre, les étudiants ont jugé que l'enseignement était loin d'être aussi bon.
Au chapitre de la gestion de la douleur provoquée par le cancer, seulement trois des 110 groupes combinés d'étudiants -- qui représentaient environ 50 p. 100 de toute la classe -- jugeaient que tant leur expérience que l'enseignement avaient été excellents. Deux trouvaient que l'expérience était bonne, mais la majorité, 49 plus 7, trouvaient que l'expérience avait été plutôt médiocre, sinon mauvaise.
Comparativement, l'enseignement relatif à l'hypertension a permis d'obtenir des résultats entièrement différents. D'après la majorité des étudiants, l'expérience avait été excellente ou très bonne.
Nous nous trouvons ici devant un paradoxe. Tous les professeurs qui enseignent dans les facultés de médecine sont évalués. À McGill, je sais que les cotes attribuées aux cours magistraux et aux présentations en petits groupes sont excellentes. J'ai travaillé également à l'Université de l'Alberta et je sais que les cotes y sont également excellentes. Les étudiants écoutent nos cours magistraux et trouvent que l'enseignement est très bon. Mais au bout de quatre ans ils nous disent qu'en général leur expérience est insatisfaisante.
Le paradoxe revient à ce que je disais dans mon témoignage précédent sur ce qui se fait dans les services hospitaliers. D'après les recherches, c'est surtout dans l'expérience clinique auprès des patients, sous la direction de modèles dans les services hospitaliers, que les étudiants et les résidents font leur apprentissage. Mais dans les services hospitaliers il n'existe pas de modèles pour enseigner comment offrir de bons soins en fin de vie. Les cours magistraux ne suffisent pas. Leur efficacité est limitée si nous n'avons pas de modèles qui puissent tous les jours faire preuve d'excellence devant nos étudiants.
Les oncologues et les médecins de médecine palliative du Québec ont récemment effectué une étude sur les facteurs qui limitent le contrôle de la douleur. Dans ce cas-ci, la cote «1» correspond à excellent et «5» à médiocre. D'après ces médecins, le grand problème dans la gestion de la douleur liée au cancer ne vient pas de l'accès aux médicaments, mais plutôt de la réticence des médecins à utiliser des opoïdes et à l'incompréhension des patients quant à l'utilisation des médicaments contre la douleur. Le problème vient également de l'enseignement. D'après ces médecins, le problème au Canada, ce n'est pas l'accès à de bons soins contre la douleur, mais plutôt l'enseignement et l'application de la gestion de la douleur.
Voici une liste des principaux objectifs d'enseignement auxquels souscriraient probablement les 16 doyens des facultés canadiennes. Cette liste est tirée d'un examen des ouvrages sur l'enseignement dans les facultés de médecine. On veut enseigner les soins à domicile et dans les collectivités, offrir des soins ailleurs qu'en établissement et enseigner les soins holistiques. Nous devons apprendre à travailler en équipe, car c'est de cette façon que sont offerts les soins médicaux à notre époque. Nous devons améliorer les compétences en communication, et, bien sûr, situer les questions médicales dans un cadre déontologique. Ce sont des objectifs qui ne touchent pas seulement les soins palliatifs, mais aussi l'enseignement de la médecine en général.
À quoi est consacré le temps dans les facultés de médecine? J'ai remarqué que dans nos hôpitaux je vois souvent nos résidents, nos internes ou nos étudiants porter l'habit des salles d'opération. J'ai pensé que c'était peut-être une question de mode, en partie, mais c'est plus que cela. Dans notre enquête, nous avons comparé le temps que nos étudiants passent dans les salles d'opération au temps réel qu'ils passent dans la collectivité ou dans des cadres d'enseignement interdisciplinaire. Nous avons constaté un écart énorme.
Nous avons demandé aux étudiants s'ils aimeraient avoir davantage de cours sur les soins palliatifs, et 85 p. 100 d'entre eux ont répondu oui. Ils se sont empressés d'ajouter qu'ils ne souhaitent pas nécessairement qu'on les retirent des salles d'opération mais, dans ces deux facultés, les étudiants ont été en mesure de suggérer des plages horaires qui pourraient être réservées à l'enseignement des soins palliatifs cliniques.
Les étudiants des facultés de médecine se plaignent régulièrement de l'abondance d'information à assimiler et du manque de temps à l'horaire des cours. Cette information donne à croire qu'il aurait moyen de trouver le temps nécessaire en réaménageant les priorités. Les soins palliatifs n'intéressent pas que des groupes d'intérêts particuliers. L'enseignement de la médecine palliative est un excellent laboratoire, pour ainsi dire, qui se prête à l'enseignement des principes généraux d'éducation médicale auxquels croient les gens.
Il y a eu certaines améliorations. Il y a cinq ans, j'ai dit que notre groupe mettait à jour le programme d'enseignement de la médecine palliative, et nous l'avons fait. Nous avons publié un ouvrage intitulé: Palliative Medicine auquel ont contribué les représentants de 12 de nos 16 facultés de médecine. Grâce à la subvention d'une société pharmaceutique, nous avons pu faire don une année de cet ouvrage, imprimé au prix coûtant par Oxford Press, aux diplômés de chacune de nos facultés de médecine. Nous pourrons faire la même chose une deuxième année, et la version française de l'ouvrage est en cours. L'ouvrage sera distribué dans nos facultés francophones pour la prochaine année universitaire.
C'est là un excellent exemple de ce que l'on peut faire quand on travaille de concert. Je suis très fier de signaler que cet ouvrage est en vente partout dans le monde et a été très bien reçu. En raison de ce succès, Oxford Press nous a demandé de préparer une deuxième édition. Je suis également fier de dire que ceux qui ont contribué à cet ouvrage ont fait don de toutes leurs redevances à un fonds canadien pour l'éducation en médecine palliative.
Les acétates suivantes illustrent une initiative importante due, en partie à certains médecins, dont un d'Ottawa, le Dr John Seely, ancien doyen de l'Université d'Ottawa. Ces médecins ont communiqué avec le comité de liaison sur l'éducation médicale (CLEM), chargé de l'évaluation des facultés de médecine au Canada et aux États-Unis, dans le but de relever les attentes de cet organisme. Pour la première fois cette année, ils ont dit: «L'enseignement clinique doit inclure une expérience en gestion des soins palliatifs et en soins aux personnes en fin de vie.» Les énoncés de mission sont en place, et nous attendons de voir quels seront les résultats.
L'Institute of Medicine de la United States Academy of Sciences a publié un rapport très intéressant. Si les sénateurs n'en ont pas d'exemplaire, je leur recommande fortement d'en obtenir un. Je peux vous expliquer comment l'obtenir de l'Institute of Medicine. Il s'agit d'une analyse des soins palliatifs et des soins aux personnes en fin de vie offerts aux États-Unis, imprimée il y a deux ans, et qui s'intitule: «Approaching Death». Le rapport conclut qu'en règle générale les soins offerts étaient nettement insuffisants. Ce rapport renferme un certain nombre d'excellentes recommandations sur lesquelles je reviendrai un peu plus tard. C'est un excellent document d'analyse sur les soins palliatifs et les soins aux personnes en fin de vie aux États-Unis.
Voici ma question: devons-nous parler d'inégalités ou d'iniquités dans l'enseignement? Nous ne pouvons pas agir contre une inégalité; c'est une différence empirique. Je suis plus âgé que la plupart des personnes assises derrière moi, et même si j'aimerais être plus jeune, je ne le peux pas. C'est là une inégalité, et je n'y peux rien. Cependant, une iniquité est une différence injuste que l'on peut corriger. J'estime que le degré d'intérêt porté à l'enseignement des soins palliatifs et à la recherche sur les soins palliatifs dans nos facultés de médecine est une iniquité, car il est possible de constater les différences et de tenter de les corriger. Il faut pour cela la volonté d'agir et les bonnes priorités.
Comment pouvons-nous le faire? Je vous recommande la lecture d'un livre très intéressant du sociologue Everett Rogers. Il parle de la diffusion des idées dans la société, de la façon dont elles viennent à être acceptées, de la façon dont un meilleur clavier d'ordinateur est néanmoins rejeté par les consommateurs et des façons d'enseigner aux gens à accepter les idées nouvelles. Cet acétate est un synopsis de ses idées exprimées de façon très schématique. Je vous signale la flèche orange. Il dit essentiellement que l'on peut avoir d'excellentes idées, mais qu'elles ne seront jamais acceptées malgré les pressions de la collectivité, des sénateurs et l'élaboration d'une trousse d'information complète par les praticiens dans le domaine des soins palliatifs si l'on ne réussit pas à convaincre les décideurs, ceux qui orientent l'opinion publique, ceux qui élaborent les programmes d'études, ceux qui rédigent les examens, ceux qui évaluent les résultats.
En cinq ans, j'ai vu qu'il y avait beaucoup d'informations et de documents pédagogiques sur les soins palliatifs, mais je vous ai démontré que ce n'était pas suffisant.
Dans les domaines de la médecine palliative et des soins en fin de vie, nous avons constaté que de nouveaux concepts ont été adaptés et qu'un corpus de connaissances s'est élaboré. Il est essentiel de mettre en place un régime de persuasion par des modèles. Des décisions doivent être prises par des leaders capables d'influer sur l'opinion publique. Il faut ensuite mettre tout cela en oeuvre et voir à ce qu'il y ait des évaluations suffisantes de ce qui se fait dans le domaine des soins en fin de vie. De toute évidence, nous en sommes encore aux deux premiers éléments de l'adaptation d'un nouveau concept.
Je m'en voudrais de ne pas mentionner une autre amélioration, bien que je n'en parlerai pas de façon officielle. Pour la première fois, en juillet, nous avons mis sur pied un programme de formation en soins palliatifs à l'intention des résidents. Ce programme est approuvé par le collège royal. Je crois savoir que dès la première année huit des seize facultés offriront ce programme. Nous ne sommes pas certains du nombre total de résidents, mais il y en aura probablement de dix à vingt. C'est un début. Il s'agit toutefois d'un programme d'un an. Ce programme n'offrira pas de formation en recherche ou en enseignement. Nous n'avons pas de soutien pour ce qui est des subventions dont toutes nos facultés canadiennes ont grand besoin.
Je vous signale un élément très positif qui a des connotations importantes pour le Canada; les États-Unis, après avoir accusé un retard par rapport à nous, sont en train de se prendre en main. Ce transparent montre les principes essentiels des soins en fin de vie tirés d'un document de la Milbank Foundation et des travaux de Kathy Foley et Christine Cassel, aux États-Unis. Ces principes essentiels ont été élaborés et transmis aux principales associations médicales américaines. Si nous adoptions ces principes essentiels et que nous les enseignions, ce serait un progrès au Canada.
Voici, en résumé, la liste de toutes les associations que le Dr Cassel et le Dr Foley, en collaboration avec leurs dirigeants, ont pu amener à adopter ces principes essentiels. À ma connaissance, rien ne s'est fait dans ce sens au Canada, et il est important que cela se produise. Nous constatons une augmentation massive des possibilités de formation et du financement de la recherche. Aux États-Unis, par exemple, les National Institutes of Health ont expressément demandé que soient effectuées des recherches en soins palliatifs et ont offert un soutien à cette recherche. C'est bien, parce que dans l'enseignement de la médecine il n'existe pas de frontière. Par contre, ce qui est moins bien, c'est que si nous continuons de ne pas être à la hauteur, d'excellents éléments s'en iront aux États-Unis. Je vous signale qu'une personne très importante du programme de l'Université de Toronto et le chef du programme à l'Université de l'Alberta ont récemment déménagé aux États-Unis. On constate qu'il y a là-bas de plus en plus de possibilités. Si nous tirons de l'arrière dans l'enseignement et la recherche, nous deviendrons une colonie en matière d'éducation, et ce n'est pas acceptable.
Dans cinq ans, j'aimerais pouvoir revenir vous dire que nous sommes passés de la théorie à la pratique. La pratique, c'est par exemple offrir aux sociétés médicales des avenues leur permettant d'adopter les principes des soins en fin de vie, de demander aux doyens et aux chefs des départements et des facultés de médecine ce qu'ils entendent faire au sujet des soins en fin de vie, comment ils ont l'intention de relever le défi américain et comment ils mettront en place les ressources nécessaires pour former les gens à l'enseignement et à la recherche pour faire progresser les travaux essentiels qui sont nécessaires.
La présidente: J'espérais que vous pourriez nous donner de meilleures nouvelles, mais je savais qu'il n'y avait pas eu au cours des cinq dernières années autant de progrès que nous l'aurions souhaité.
Le sénateur Beaudoin: Vous parlez surtout de l'enseignement des soins palliatifs, un domaine où il n'y a pas eu beaucoup de progrès. Qu'en est-il des provinces? Elles ont également été actives dans ce domaine. C'est une question qui relève de notre compétence, dans une certaine mesure, mais de la leur aussi. Que proposez-vous qu'elles fassent? C'est un domaine de compétence partagée.
Dr MacDonald: Cela nous écarte de l'enseignement. Dans un certain nombre de provinces, et vous êtes peut-être plus au courant que moi, il existe des initiatives en soins palliatifs. En Ontario, on a mis sur pied des programmes intéressants, entre autres pour former des médecins dans ce domaine -- pour les ramener sur les bancs d'école et leur donner une formation en soins palliatifs. L'Ontario a également pris des dispositions plus crédibles pour le financement des médecins de soins palliatifs, car ce n'est pas un domaine qui se prête bien à la facturation des clients. Il n'est pas facile d'appliquer un régime de facturation des clients à l'égard du temps nécessaire pour analyser les problèmes complexes des patients et de leurs familles et pour leur offrir des services de counselling et d'aide psychosociale. Ce n'est pas comme une radiographie pulmonaire. Ces initiatives varient d'un endroit à l'autre.
Néanmoins, je préfère parler plus particulièrement des facultés de médecine et des chefs de nos sociétés nationales. Il est important qu'un groupe communautaire, que notre Sénat, jouent un rôle de chef de file et rencontrent les chefs de nos groupes nationaux, ceux qui sont chargés de tout l'enseignement dans nos facultés de médecine, ainsi que les gens qui dirigent les conseils médicaux du Canada. Vous pourriez rencontrer les représentants du collège royal et du collège des médecins de famille pour voir s'ils conviennent également qu'il existe des écarts dans l'enseignement offert dans nos facultés de médecine, s'ils seraient prêts à adopter certains principes fondamentaux et à faire progresser les choses. C'est dans ces facultés que cela se fait, à l'échelle nationale, et cela ne dépend pas uniquement de la participation des provinces au régime de soins de santé. Les provinces peuvent toutefois être fort utiles en favorisant les conditions dans lesquelles travaillent les médecins qui offrent des soins palliatifs, et peut-être aussi en offrant de l'aide dans le domaine de l'éducation permanente. L'interaction entre les facultés de médecine se fait tout autant à l'échelle provinciale qu'à l'échelle nationale.
Le sénateur Beaudoin: Croyez-vous qu'il soit nécessaire de modifier les lois, ou le problème ne vient-il pas de là?
Dr MacDonald: Je ne prétends pas être un expert en matière de lois. Mes observations à ce sujet seraient naïves.
Il y a toutefois une chose qui me frappe. Je m'intéresse également beaucoup à la recherche et j'ai récemment présidé le Comité permanent de l'éthique en recherche humaine du CRM. Nos conseils examinent les recherches dans tout le pays. D'après la définition de la recherche que l'on trouve dans les lignes directrices des trois conseils, il faut que des citoyens participent à l'examen et à la mise en place des programmes de recherche. Il me paraît paradoxal qu'il n'existe pas une nécessité semblable et claire de participation des citoyens à l'examen de l'enseignement dispensé à nos médecins et à nos autres professionnels de la santé.
Il faudrait peut-être discuter si, dans nos comités des grandes facultés de médecine, dans nos comités des programmes d'études, et cetera, nous devrions inclure un certain nombre de citoyens mandatés par la collectivité, tout comme on trouve un certain nombre de personnes mandatées par la collectivité dans le secteur de la recherche.
Le sénateur Roche: Nous savons que quand quelqu'un meurt, il y a d'abord un déni; il semble que la profession médicale vit un déni à peu près semblable quant à la nécessité des soins palliatifs. C'est l'impression que je retire de vos propos. Il semble également qu'une vaste majorité d'étudiants souhaitent recevoir davantage de cours en soins palliatifs. Je me demande ce que vous en pensez, docteur MacDonald. Je suis sûr que tous les sénateurs de notre comité sont en faveur des soins palliatifs et, par conséquent, d'un enseignement dans les facultés de médecine qui permettra aux médecins d'en savoir davantage dans ce domaine. Mais que pouvons-nous faire si la profession médicale elle-même n'accorde pas une plus grande priorité à la formation des médecins en soins palliatifs? Nous pouvons, je suppose, dire que cela devrait être fait dans notre rapport. Ne s'agit-il pas plutôt d'influencer ceux qui établissent les programmes d'enseignement et qui sont chargés de la formation des médecins?
Ce n'est pas nous qui formons les médecins, c'est la profession médicale. Je me demande si nos admonestations peuvent produire de l'effet. Si nous incluons une telle recommandation dans notre rapport, quel en sera l'effet si la profession médicale préfère encore investir son temps et ses ressources à soigner les maladies plutôt que de s'occuper de la mort?
Dr MacDonald: Pour répondre, je répéterai que vous avez un rôle moral très important à jouer au sein de la société canadienne. L'enseignement de la médecine palliative et des soins en fin de vie, ce n'est pas seulement une question d'éducation, c'est aussi une question d'éthique. Vous avez peut-être à votre disposition les moyens ou l'autorité morale voulus pour faire progresser certaines idées, comme par exemple ce qui se fait aux États-Unis, pour voir s'il est possible de mettre en place un leadership doté d'autorité, avec l'aide d'une fondation ou du gouvernement, pour rédiger des principes relatifs à la fin de la vie et demander ensuite à nos principaux groupes médicaux d'adopter ces principes. C'est ce qui s'est fait aux États-Unis, et cela semble avoir eu un effet important.
Il est insatisfaisant, à mon avis, que la population ne participe pas du tout à l'enseignement, qui est si important pour toute la société. Vous devez trouver des moyens pour faciliter une participation réelle de la population.
Le sénateur Roche: Ce que vous dites, c'est que l'enseignement est trop important pour être confié entièrement aux professionnels.
Si je comprends bien, vous croyez que notre rapport serait meilleur s'il contenait une partie sur les principes relatifs à la fin de la vie, n'est-ce pas?
Dr MacDonald: Oui, mais je vous signale que dans votre dernier rapport vous aviez recommandé une augmentation et une amélioration de la formation relative à la fin de la vie, mais ce n'est pas satisfaisant, ni suffisant. Il faudrait que votre rapport contienne également des propositions sur la façon de passer de la théorie à la pratique. Aux États-Unis, il existe des exemples montrant qu'on a réalisé de grands progrès en collaborant avec des leaders d'opinion et avec les dirigeants des principales associations médicales, et en collaborant aussi avec les gens des facultés de médecine. Les Américains font des progrès réels.
Même si vous m'avez invité pour vous parler de l'enseignement, je vais vous signaler deux grands changements qui se sont produits au cours des cinq dernières années dans le domaine des soins palliatifs et des soins en fin de vie, car ces changements sont à mon avis liés à l'enseignement. Le premier, c'est qu'on ne parle pas seulement du cancer. Dans les programmes actuels, une vaste majorité de patients souffrent du cancer, mais aux États-Unis une étude a clairement démontré que les mourants atteints de maladie respiratoire obstructive chronique, de sida, de maladie rénale ou coronarienne terminale souffrent autant que ceux atteints du cancer. Les mêmes principes devraient s'appliquer à tous les patients qui souffrent de maladie chronique.
Le deuxième grand changement, c'est que les soins palliatifs sont à l'heure actuelle à peu près relégués aux tout derniers jours de la vie. Ce n'est ni sensé ni logique, parce qu'un patient qui souffre d'un cancer du pancréas, par exemple, ne commence pas à souffrir ou à perdre du poids aux derniers mois de sa maladie. La souffrance, la perte de poids et la détresse psychosociale commencent dès le moment où le diagnostic est posé. Nous voulons nous assurer que les principes des soins palliatifs s'appliquent à tout le traitement de la maladie chronique et qu'on mette fin à cette division illogique et artificielle entre le «traitement actif» du cancer, au moyen de la chimiothérapie, qui peut ou non prolonger votre vie, et les soins palliatifs. Logiquement, il faut commencer à offrir des soins palliatifs dès qu'une maladie chronique est diagnostiquée, une maladie dont on peut prédire qu'elle mettra fin aux jours du patient.
Le sénateur Roche: Enfin, je m'intéresse aux principes relatifs à la fin de la vie, que vous avez passés rapidement en revue.
Dr MacDonald: Je vous en laisserai copie.
La présidente: Nous les avons, sénateur.
Dr MacDonald: Je vous recommande fortement d'obtenir une copie du document intitulé: «Approaching Death», car on y trouve une excellente description des soins en fin de vie aux États-Unis, une description qui s'applique en grande partie au Canada. L'ouvrage comporte des chapitres sur la recherche et l'enseignement, ainsi que sur les questions économiques liées aux soins palliatifs. C'est un excellent document. J'essayerai de vous en transmettre un exemplaire ou de vous indiquer comment vous pouvez vous en procurer un. Si vous le voulez, je vous laisserai avec plaisir le rapport Milbank, afin que vous puissiez le consulter.
Je serais aussi heureux de vous remettre un exemplaire de Palliative Medicine. Nous sommes plutôt fiers de notre livre. Il en sera sous peu à sa deuxième édition, et nous continuerons de l'utiliser pour influencer l'enseignement qui se donne dans nos facultés de médecine.
La présidente: Cette semaine, en fait probablement demain, le Sénat sera saisi du projet de loi C-13 -- je suis certaine que le Dr Friesen, au fond de la pièce, tend l'oreille -- qui crée les instituts de recherche en santé. Ces instituts seront établis pour mener des recherches. Croyez-vous qu'on pourrait faire progresser le dossier des soins palliatifs s'il y avait un institut s'intéressant uniquement à ce sujet?
Dr MacDonald: Le Dr Friesen et moi sommes des amis de longue date. Nous avons été résidents ensemble à l'hôpital Royal Victoria, et j'ai discuté de cette question avec lui tout récemment. Je suis fermement convaincu d'une chose, à savoir que la fragilité qui caractérise les patients au stade avancé d'une maladie chronique est un problème universel. On prend des mesures pour tenter d'améliorer le sort de bien des personnes fragiles, notamment au chapitre psychosocial et en améliorant les soins infirmiers et les soins à domicile. J'ai discuté avec le Dr Friesen de la possibilité de mener une initiative de recherche en biologie qui s'intéresserait plus précisément aux causes de la faiblesse et de la fragilité musculaire, ainsi qu'à la question de savoir si, à cette étape-ci de nos connaissances, nous pourrions mettre de l'avant des études, des idées et des interventions intéressantes. Je crois que c'est possible.
Le Dr Friesen m'a beaucoup aidé en me suggérant des façons de réaliser cela par l'entremise des instituts de recherche en santé; je tenterai de donner suite à ces suggestions.
La différence, c'est qu'aux États-Unis on a publié ce qu'on appelle des «RFA». Les National Institutes of Health ont jugé que, dans ce domaine, peu de recherche se faisait et ont donc prévu des incitatifs financiers. Je poursuivrai mes discussions avec le Dr Friesen afin de déterminer s'il est raisonnable d'envisager, au Canada, une mesure quelconque pour encourager la recherche sur la perte de fonction et la fragilité. À mon avis, c'est faisable.
Cette discussion soulève l'importante question du lancement d'un projet de recherche. Selon un sondage mené en 1996, le nombre total de médecins appuyés par leur faculté de médecine en soins palliatifs au pays est inférieur à 18. Il y a des départements de biochimie dans diverses facultés de médecine qui comptent 18 personnes. On a donc peu investi dans la capacité.
Il faut prévoir des subventions qui attireraient les plus talentueux et leur permettraient d'étudier dans l'un de nos meilleurs centres de recherche, qui sont peu nombreux au Canada. Il y a d'abord l'Université de l'Alberta, ainsi que les Universités d'Ottawa, Laval et McGill, notamment. On pourrait aussi les envoyer aux États-Unis pour parfaire leur formation, puis leur faire une offre attrayante pour qu'ils reviennent au pays.
Il faut établir une capacité et, pour ce faire, des incitatifs financiers. Sinon, on continuera de dire qu'il faut faire ceci et cela, mais il n'y aura personne pour le faire.
La présidente: Pourriez-vous me donner une précision? Avez-vous dit qu'il y a 18 médecins dans les facultés de médecine du pays qui sont experts en soins palliatifs?
Dr MacDonald: Non, les experts dans le domaine sont bien plus nombreux. Je vous ai plutôt parlé de notre sondage de 1996 sur le nombre de médecins qui jouissent du soutien d'une faculté de médecine dans leurs activités de médecine palliative. Le nombre de ces médecins, qu'ils fassent de la recherche, de l'enseignement ou de la médecine clinique, est à peine de 18.
Dans certaines facultés de médecine, les investissements sont considérables. C'est notamment le cas de l'Université de l'Alberta. À l'Université d'Ottawa, on a fait de bons investissements, mais plusieurs facultés de médecine, en 1996, n'ont pu indiquer, pendant notre sondage, qui recevait du soutien de leur part. Il y a de nombreux médecins dans la collectivité. Moi, je parle plutôt de la capacité, des gens dans les facultés de médecine qui rédigent les articles et les manuels, qui font de la recherche et qui créent les modèles pédagogiques. Ce sont ces gens-là qui nous manquent.
La présidente: Chers collègues, quatre témoins se joignent maintenant à nous: le Dr Henry Friesen, le Dr James Young, et MM. Brian Mishara et Russel Ogden.
M. Brian Mishara, professeur, Département de psychologie, Université du Québec à Montréal: Je vous remercie de m'avoir invité à témoigner devant votre sous-comité de mise à jour du rapport du comité sénatorial spécial sur l'euthanasie et l'aide au suicide, qui est paru en 1995.
J'ai été impressionné par le rapport du comité sénatorial. C'est un document élégant dans lequel les recommandations du comité sont présentées clairement et justifiées par une bonne compréhension des enjeux très complexes en question.
Je ferai de brèves remarques qui se fondent sur mon expérience à titre de directeur du Centre de recherche et d'intervention sur le suicide et l'euthanasie de l'Université du Québec à Montréal ainsi que sur les recherches que j'ai menées sur les questions de droits de la personne relatives à l'euthanasie grâce à une bourse canadienne Bora Laskin pour la recherche sur les droits de la personne, et ma participation à d'autres projets de recherche. Mes remarques se limiteront aux résultats d'études faites depuis la publication du rapport, en 1995.
Le suicide n'est pas illégal au Canada. Toutefois, nous n'encourageons ni ne facilitons le suicide; aux termes de l'article 241 du Code criminel, c'est illégal. Nous contrôlons l'accès aux moyens de se suicider grâce à des lois sur les armes à feu et des garde-fous sur les ponts.
Lorsque quelqu'un est suicidaire ou a tenté de se suicider, nous faisons habituellement l'impossible pour éviter que la mort s'ensuive. Il y a des programmes de prévention du suicide, et nous offrons les meilleurs soins médicaux possible à ceux qui ont tenté de se suicider. Nous le faisons en raison d'une croyance, fondée sur des années d'expérience pratique et de recherche, qui veut que, bien que certains envisagent le suicide dans des situations qu'ils jugent intolérables et interminables, ils ont habituellement tort. En dépit du fait qu'ils croient que leur désespoir perdurera, nous savons que, généralement, la situation peut s'améliorer considérablement.
Ainsi, même si un adolescent ou un homme d'âge moyen croient qu'il ne vaut plus la peine de vivre après que leur amie ou leur femme les a quittés, nous savons que l'angoisse disparaîtra un jour.
De même, lorsqu'une personne souffrant de dépression clinique juge sa vie sans espoir, nous savons que l'on peut traiter la dépression et que le sentiment de désespoir disparaîtra. L'expérience nous a démontré que les intentions suicidaires, même si elles semblent rationnelles à la personne qui les éprouve, reflètent généralement une réaction très émotive, mais transitoire, et que le sentiment de désespoir disparaît habituellement avec toute l'aide nécessaire.
Bien des gens croient que le désir de mourir des patients souffrant d'une maladie chronique ou mortelle diffère des intentions suicidaires des personnes en santé. On estime pouvoir tolérer ou faciliter les mesures visant à abréger la vie de ces «groupes spéciaux» par le biais du suicide, de l'euthanasie, de l'aide au suicide ou de l'interruption ou du refus de traitement en se fondant sur la prémisse selon laquelle rien ne peut faire disparaître leur souffrance ou leur angoisse.
Si nous tolérons l'abrégement de la vie par ces moyens, nous présumons que le désir de mettre fin prématurément à sa vie est déterminé par l'évolution inévitable de la maladie, et que les raisons qui amènent une personne à choisir une mort prématurée sont les conséquences directes du processus irréversible de la maladie.
Il est donc d'une importance primordiale dans toute discussion concernant des décisions de vie ou de mort avec des patients en phase terminale ou souffrant d'une maladie dégénérative chronique de déterminer si les raisons invoquées pour hâter la mort sont véritablement liées aux conséquences irréversibles de la maladie ou si d'autres facteurs, tels qu'un soulagement inadéquat de la douleur ou une dépression clinique non traitée, pourraient expliquer le souhait du patient de mettre fin prématurément à ses jours.
J'ai remis aux membres du comité un exemplaire du périodique Omega -- Journal of Death and Dying de 1999, où j'ai publié une synthèse de la recherche et des constatations sur les facteurs qui influent sur le souhait qu'ont les personnes souffrant d'une maladie mortelle ou chronique de hâter la mort. Dans cette étude, je voulais comprendre pourquoi certaines personnes écourtent leur vie en se suicidant, avec ou sans aide, en se faisant euthanasier ou en refusant ou en interrompant leur traitement, alors que d'autres choisissent de continuer à vivre en dépit de leur maladie mortelle ou chronique. J'estime que les résultats de cette analyse pourraient avoir d'importantes répercussions sur les politiques.
Avant de se pencher sur les résultats de l'étude, il m'apparaît important d'examiner plusieurs questions qui compliquent toute tentative de légiférer dans ce domaine.
Premièrement, toute loi concernant l'euthanasie, l'aide au suicide et l'interruption de traitement limite généralement l'accès à ces méthodes aux personnes qui sont considérées comme souffrant d'une maladie mortelle. Bien des études menées récemment ont indiqué que, dans le cas de bien des maladies, les maladies cardiovasculaires, notamment, il est extrêmement difficile, sinon impossible, de déterminer si une personne est en phase terminale et d'estimer avec précision les chances de survie et le moment de la mort. Pour certaines maladies, telles que certaines formes de cancer, l'évaluation des chances de survie peut être plus précise, mais nous ne sommes pas encore en mesure de préciser la probabilité de survie et d'établir de façon fiable qu'un patient est en phase terminale.
Deuxièmement, on doit faire une importante distinction entre les décisions concernant la vie et la mort qui sont prises pendant les heures et les jours qui précèdent la mort naturelle, et les décisions prises plus tôt. Aux Pays-Bas, le plus souvent l'euthanasie est pratiquée lorsqu'on estime que la personne n'a plus que quelques heures ou quelques jours à vivre.
De plus, les décisions concernant la vie et la mort prises à cette étape sont compliquées par le fait que la majorité des patients sont si près de la mort qu'ils sont souvent incapables de prendre ces importantes décisions. Lynn et ses collègues ont mené une étude prospective qui a fait l'objet d'un rapport en 1996. Ils ont suivi des patients sur une longue période de temps et ensuite déterminé qui était mort. Ils ont commencé avec 9 105 patients en phase terminale. Ils ont constaté que, parmi tous ceux qui avaient un mauvais pronostic, soit de 20 à 29 p. 100 de chances de survivre six mois, plus de la moitié avaient du mal à réagir aux stimulis verbaux ou à bouger leur corps ou leurs yeux délibérément, et que 59 p. 100 étaient trop malades pour participer à une conversation intelligente.
Par conséquent, le consentement éclairé est souvent impossible à cette étape de l'évolution d'une maladie mortelle. La fréquence des déficiences intellectuelles à la fin de la vie peut sembler moins importante si le patient a donné des directives préalables qui indiquent quels étaient ses souhaits antérieurs. Toutefois, des études récentes nous mènent à croire que ce que les gens croient qu'ils voudront dans l'avenir ou lorsque leur situation changera ne correspond pas nécessairement à ce qu'ils feront lorsqu'ils seront dans cette situation.
Par exemple, je viens de terminer une étude longitudinale auprès de 101 personnes souffrant de sida évolué. Nous avons évalué les projets et les intentions d'abréger la vie par le biais du suicide, de l'euthanasie et de l'aide au suicide. Nous avons suivi ces 101 personnes, et plusieurs sont décédées.
Nous avons constaté que les données sur les intentions de ces patients de mettre fin à leur vie prématurément correspondaient peu aux données recueillies six mois plus tard. Ainsi, un de ces patients avait clairement indiqué qu'il ne souhaiterait pas continuer à vivre s'il était confiné à son lit ou un fardeau pour les autres. Il avait déclaré avoir les moyens de mettre fin à ses jours et connaître quelqu'un qui était disposé à l'aider. Lorsqu'il s'est trouvé dans une situation bien pire que ce qu'il avait pu imaginer -- il était confiné à son lit, aveugle et dépendant de dispositifs médicaux pour sa survie -- il a fait l'impossible pour vivre encore quelques minutes, quelques heures, quelques jours, en dépit du fait que son compagnon lui ait plusieurs fois laissé entendre que le temps était peut-être venu pour qu'on l'aide à se suicider.
Une autre personne qui avait déclaré avec véhémence que seul Dieu peut mettre fin à la vie et qu'on doit continuer à vivre coûte que coûte a demandé qu'on mette fin à ses jours sans plus tarder deux jours avant de mourir.
Nombreux sont les Canadiens qui croient que les personnes souffrant de maladies dégénératives chroniques, telles que la démence sénile, la sclérose en plaques et bien des handicaps graves, souhaiteraient ardemment hâter leur mort. Toutefois, les études montrent clairement que ces maladies, ainsi que plusieurs autres handicaps, ne sont pas liées à un désir accru de se suicider, avec ou sans aide, ou de se faire euthanasier. La recherche indique que le souhait de mourir prématurément chez les personnes souffrant d'une maladie chronique varie selon la maladie et l'étape où en est la maladie dans son évolution. Ainsi, les sidéens sont plus susceptibles de se suicider dans les mois suivant le diagnostic de séropositivité, avant même que n'apparaissent les premiers symptômes.
De plus, les raisons pour lesquelles les patients en phase terminale choisissent de mettre fin à leurs jours prématurément dépendent de la nature de la maladie. Chez les cancéreux, la souffrance et la douleur qu'on ne soulage pas est un facteur qui influe grandement sur la décision de hâter la mort. Les résultats des recherches indiquent clairement que, comme le comité sénatorial l'a recommandé, il faut élaborer de meilleures politiques et pratiques afin de s'assurer que l'on soulage la douleur et que l'on réduise la souffrance des patients. C'est vrai pour les cancéreux, mais les données ne nous ont pas permis d'établir de liens significatifs entre la douleur et la souffrance et le souhait de se faire euthanasier ou d'avoir de l'aide pour se suicider chez les patients atteints d'autres maladies.
Chez les cancéreux, en dépit du fait que les soins palliatifs pour les patients en phase terminale sont plus disponibles qu'auparavant, comme l'a mentionné le Dr MacDonald, au Canada on doit être considéré comme étant en phase terminale et avoir interrompu le traitement actif de la maladie afin d'obtenir des soins palliatifs. Au Canada, les soins palliatifs sont réservés à une certaine élite, habituellement ceux qui souffrent du cancer, qui ont mis fin à tout traitement et dont la maladie est très évoluée. Pourtant, rien n'indique qu'ils aient davantage besoin de bons soins palliatifs que les personnes atteintes d'une autre maladie ou à une autre étape de l'évolution de la maladie.
Outre les études sur les liens entre la douleur chez les cancéreux et le souhait de hâter la mort, des recherches considérables ont été menées sur le lien entre la dépression et le souhait de mettre fin à ses jours prématurément, quelle que soit la maladie. La majorité des patients ayant interrompu le traitement, refusé le traitement ou choisi l'aide au suicide ou l'euthanasie peuvent faire l'objet d'un diagnostic de dépression clinique.
Dans certains cas, le patient souffrait de dépression clinique avant de devenir malade, et la maladie n'a fait qu'ajouter un motif à ceux qui le poussaient à souhaiter la mort. Toutefois, le plus souvent, la dépression est un des effets de la maladie ou du traitement. Elle est liée à la perte de capacité, à l'isolement social, à l'impression d'être inutile et un fardeau et aux effets secondaires de certains médicaments. Il est possible que le traitement de la dépression réduise ou élimine le souhait de mourir de façon hâtive.
Comme je l'ai mentionné, dans certains cas la dépression est ce qu'on appelle «iatrogène», c'est-à-dire qu'elle résulte des médicaments servant à soigner la maladie. Dans d'autres cas, comme pour les maladies dégénératives du cerveau, la dépression peut être une conséquence physiologique directe de la maladie.
Dans leur examen d'une loi permettant ou facilitant la mort hâtive, y compris le refus et l'interruption de traitement, j'estime que les membres du comité devraient envisager l'obligation de déterminer si le patient souffre de dépression clinique et, dans l'affirmative, de dispenser le traitement requis avant que l'on donne à un patient les moyens de hâter sa mort.
La plupart des arguments pour l'accès à une mort prématurée se fondent sur la croyance selon laquelle, dans certaines circonstances, il est préférable de mourir. De plus, on tient pour acquis que le patient est en mesure de comprendre que ces circonstances existent ou sont imminentes ou que quelqu'un d'autre, par exemple le médecin ou un membre de la famille, est en mesure de prendre cette décision.
Plusieurs études laissent croire que la plupart des Canadiens estiment qu'il y a des circonstances où la mort est préférable à la vie. Toutefois, il a été démontré à maintes reprises que nous avons souvent tort de juger certaines choses intolérables pour d'autres ou pour nous. Nous ne savons prévoir avec précision ce que nous voudrons dans l'avenir, et nos prévisions de ce que les autres voudront sont encore moins précises.
Enfin, j'aimerais aborder le rôle des soignants, y compris les médecins et les membres de la famille, dans le processus décisionnel de fin de vie. Les recherches indiquent que les membres de la famille vont souvent délibérément à l'encontre des souhaits exprimés par le patient. Des études indiquent que les membres de la famille ont tendance à s'en remettre uniquement aux recommandations des médecins. Les études indiquent aussi que les médecins et les autres dispensateurs de soins se sentent mal à l'aise et ne savent trop comment réagir ni comment conseiller les membres de la famille. Manifestement, il faut élaborer des lignes directrices et prévoir de la formation pour les médecins et les dispensateurs de soins de santé à ce chapitre.
D'après l'examen que j'ai fait des recherches récentes, il faut faire davantage d'enquêtes pour mieux comprendre pourquoi certaines personnes choisissent de mettre fin prématurément à leur vie et pourquoi d'autres continuent de vivre malgré des maladies mortelles ou dégénératives graves. Il faut particulièrement faire des recherches évaluatives pour déterminer l'efficacité des interventions et des programmes qui pourraient réduire le désir, chez les personnes souffrant de maladies mortelles, de mettre fin prématurément à leur vie, que ce soit par le suicide, l'euthanasie, l'aide au suicide, ou encore la décision d'interrompre ou de refuser les traitements.
Même s'il existe un lien clair entre la dépression et le souhait de hâter la mort, nous ne savons pas encore clairement si le soulagement de la dépression réduit ce souhait. Il faut mettre en oeuvre divers programmes pilotes qui mettent l'accent sur l'amélioration de la qualité de vie, ainsi que sur le contrôle et la réduction de la dépression clinique, afin de déterminer quelles sont les interventions les plus efficaces.
La présidente: Sénateurs, notre témoin suivant est le Dr James Young.
Dr James G. Young, coroner en chef, Bureau du coroner en chef de l'Ontario: C'est un plaisir et un honneur d'être invité de nouveau aux audiences du Sénat. Il est plutôt rare que quelqu'un veuille entendre ou voir deux fois un coroner. Je vous remercie de ce privilège.
La dernière fois que j'ai comparu, mon rôle était d'expliquer les aspects pratiques des enquêtes sur les décès et comment l'euthanasie est une réalité de tous les jours en Ontario. Le Bureau du coroner en chef n'avait exprimé aucune opinion quant à l'étendue que devrait avoir la définition de l'euthanasie.
Toutefois, nous appuyons sans réserve le travail de votre comité, y compris le rapport antérieur. Je me dois de vous en féliciter. C'était un excellent rapport.
Je vais récapituler très brièvement. Les coroners de l'Ontario, tous médecins, font enquête chaque année sur 30 000 décès. Ces décès peuvent survenir à la maison, en établissement, dans tous les contextes de la province.
Les enquêtes que nous faisons en matière de soins palliatifs et d'euthanasie possible se divisent en deux grandes catégories, celle des décès à la maison et celle des décès en établissement. Je vais brièvement passer en revue ce qui nous préoccupe dans chacune de ces catégories.
Il ne fait aucun doute pour nous qu'il y a probablement des cas d'euthanasie parmi les décès à la maison. À vrai dire, nous ne savons ni le nombre, ni le lieu ni le moment, et ce, pour un certain nombre de raisons. Très souvent, le coroner n'est pas appelé à se rendre sur les lieux, parce que le décès du patient est prévu. Il n'existe pas de tableaux à ce sujet; généralement, le patient a à sa disposition des opiacés et de puissants analgésiques. Si personne sur les lieux ne signale d'anomalies, nous ne pouvons pas toujours savoir qu'il faut tenir une enquête ou que quelque chose s'est produit.
Il arrive parfois que les coroners sont appelés à travailler les fins de semaine, ou la nuit, quand les autres médecins ne veulent pas sortir de leur lit; les coroners, eux, sont obligés de répondre à l'appel, et ils le font. Nous avons clairement expliqué aux coroners qu'ils doivent apporter une attention particulière aux cas où il y a sur les lieux du décès un nombre inhabituel de personnes, dont certaines semblent être là pour faire du prosélytisme. Dans ces cas, ils devraient apporter une attention particulière à ces enquêtes et, dans certains cas, exiger des autopsies.
Comme je l'ai dit la dernière fois, même les autopsies ne donnent pas toujours des résultats clairs, car le patient a déjà consommé des analgésiques puissants, et il peut être très difficile d'interpréter le rapport entre les doses consommées et le décès. Il existe toutefois des cas où l'on peut trouver dans le système du patient des médicaments qui ne lui avaient pas été prescrits.
Ce qui inquiète plus particulièrement notre bureau, c'est qu'il faut surveiller de près ce qui se fait dans les établissements. Nous craignons la possibilité que quelqu'un ne décide qu'une euthanasie est à propos, sans en avoir discuté avec le patient ou la famille, et que l'établissement, enfin, perde le contrôle de la situation. Les coroners et les médecins légistes d'Amérique du Nord sont malheureusement appelés à faire occasionnellement des enquêtes sur de tels cas. Ce sont des enquêtes très complexes, très difficiles, mais il y en a, et elles révèlent à l'occasion des problèmes de ce genre.
En Ontario, nous préférons ne pas débattre de ces questions devant les tribunaux, mais nous avons dû faire une enquête sur des cas d'euthanasie, et trois procès au criminel ont en lieu dans des cas mettant en cause un membre de la famille, une infirmière et un médecin. Dans ces cas, nous pensions qu'on avait mis fin prématurément aux jours du patient ou qu'on avait essayé de le faire.
Si nous avons entamé ces poursuites devant les tribunaux, c'est entre autres parce que nous pensions que ces gens ne devraient pas prendre de décisions unilatérales de ce genre, qu'ils ne devraient pas être les martyrs d'une cause, mais plutôt répondre de leurs actes devant les tribunaux.
Dans toutes ces affaires, le point commun, c'est qu'il était très difficile de décider quelles accusations porter et comment le procès devait se dérouler.
C'est pourquoi nous avons formulé une recommandation, qui a été adoptée par votre comité et que nous estimons encore très importante, pour que la définition de l'euthanasie soit claire dans les lois et pour qu'un article indique clairement dans le Code criminel quelles sont les limites de l'euthanasie et les sanctions applicables à ceux qui franchissent ces limites. De cette façon, les limites sont claires et fermes. Nous continuons de nous inquiéter de ce que ces limites ne sont pas aussi claires qu'elles le devraient.
Dans les enquêtes sur le foyer Christopher Robin, le problème, c'est que des enfants qui recevaient des soins actifs étaient tout à coup classés comme patients de soins palliatifs, sans que la famille ait été consultée, sans que les tests nécessaires aient été réalisés et sans les mentions qui s'imposent au dossier. Dans bon nombre de cas, on avait ajouté des opiacés aux médicaments administrés à ces patients sans raison évidente. Dans ces cas, nous avons estimé que les soignants étaient de bonne foi lorsqu'ils croyaient offrir des soins visant à réconforter le patient, mais de façon isolée, sans discussion, et sans tenir compte des solutions de rechange. Les enquêtes ont permis de faire un travail important d'éducation.
À l'heure actuelle, il semble que le débat sur l'euthanasie a perdu un peu d'ampleur. D'après nous, il s'agit d'un ralentissement dans le cycle, et les événements susciteront de nouveau ce débat.
Certains cas d'euthanasie ont fait l'objet d'enquête, mais il n'y a pas eu d'autres poursuites en Ontario au cours des cinq dernières années.
Nous avons mis en oeuvre de grandes initiatives d'éducation au sujet des soins palliatifs. Je tiens à dire clairement que, comme tous mes collègues au Canada, je suis très en faveur du concept des soins palliatifs et que je reconnais le besoin d'offrir ces soins.
Au sujet des principes dont le Dr MacDonald a parlé tout à l'heure, je rappelle au comité que quand il y a eu un tollé de protestations au sujet des ordonnances de non-réanimation, les gens ont collaboré et élaboré les principes qui sont devenus la norme. Par conséquent, ce n'est plus un sujet très discuté. Il est très important d'élaborer des principes en matière de soins palliatifs et de rassurer la population à ce sujet.
Dans les cours théoriques que nous donnons, nous constatons qu'il existe un grand malentendu au sujet des soins palliatifs dans le monde médical. Nous ne voulons pas que ces soins palliatifs cessent d'être offerts, mais plutôt qu'ils soient offerts de la bonne façon. Nos lignes directrices sont claires, et nous voulons que les soins palliatifs soient offerts. Nous voulons que des doses raisonnables de médicaments soient administrées et nous comprenons que ces médicaments peuvent abréger la vie d'un patient et que c'est acceptable. Ce que nous ne saurions tolérer, c'est que quelqu'un abrège à dessein la vie d'un patient en lui administrant soit un médicament inapproprié, soit une dose excessive d'un médicament. Nous voulons que ces questions soient précisées.
Depuis que nous avons comparu il y a cinq ans, le Dr Kevorkian a malheureusement pu poursuivre ses activités aux États-Unis. Lorsqu'un citoyen de l'Ontario a traversé la frontière pour le consulter, nous avons lancé après son retour une double enquête, avec l'État du Michigan, sur les activités du Dr Kevorkian. Personnellement, je suis heureux de vous signaler que le Dr Kevorkian languit actuellement derrière les barreaux et ne peut plus rendre ses arrêts de mort.
Il était devenu plus téméraire au cours des dernières années. Il avait élargi ses méthodes et était devenu moins sélectif quant aux cas dans lesquels il accepte d'intervenir. C'est cela qui est dangereux dans les croisades personnelles.
En fait de renseignements, nous avons surtout des anecdotes, mais nous croyons qu'il y a eu des améliorations dans le traitement de la douleur. Je suis entièrement d'accord avec le Dr MacDonald lorsqu'il dit qu'il reste encore beaucoup à faire. C'est ce que nous disent les familles quand nous faisons des enquêtes sur les décès. Nous sommes persuadés qu'il reste encore beaucoup à faire dans l'enseignement des soins palliatifs. J'ai trouvé les observations du Dr MacDonald très intéressantes, et je suis entièrement d'accord avec ce qu'il a dit.
Pour conclure, il reste beaucoup à faire encore dans le contrôle de la douleur. Si on leur offre des moyens suffisants de contrôler la douleur, bon nombre de gens préféreront utiliser ces moyens plutôt que d'envisager l'euthanasie ou d'en discuter.
Comme je l'ai déjà dit, nous pensons que le Code criminel devrait être plus précis et qu'il faudrait créer un délit distinct. Je sais que cela ne fait pas partie du sujet que vous examinez, mais si vous apportiez des changements, nous croyons encore que les coroners et les médecins légistes auraient un rôle à jouer dans la surveillance des cas d'euthanasie.
Il reste encore beaucoup à faire également pour ce qui est de préciser les enjeux du débat. En posant certaines questions, il est très facile de produire un sondage montrant une opinion favorable au changement. Demandez à un patient atteint d'un cancer qui souffre terriblement s'il est en faveur de l'euthanasie, sans lui décrire les solutions de rechange, et il vous répondra certainement par l'affirmative. Posez la même question à un patient qui vient d'apprendre qu'il est atteint du sida, et la réponse sera peut-être bien différente. Je n'accorde pas beaucoup de foi aux sondages, car ils sont généralement biaisés au départ, à mon avis.
Dr Henry Friesen, président, Conseil de recherches médicales du Canada: Madame la présidente, j'ai lu attentivement les témoignages d'un certain nombre de témoins, ainsi que les renseignements de base, et je vais commencer par situer mes remarques au sujet de la recherche dans leur contexte.
Mon mémoire commence par une citation d'un dramaturge américain: «La façon la plus authentique de vérifier notre humanité, c'est d'aider les autres humains et d'alléger leurs souffrances».
En mettant l'accent sur cette question importante, en dirigeant cette enquête, vous exprimez votre humanité.
Les soins en fin de vie ne s'appliquent pas seulement à la douleur et au cancer. Je suis d'accord avec les observations du Dr MacDonald. Les soins en fin de vie s'inscrivent dans un contexte. La fin de la vie diffère de la nature de la maladie. L'âge influe également sur ce contexte. La situation est bien différente si c'est un enfant qui meurt, plutôt que quelqu'un qui souffre d'une maladie chronique, surtout s'il s'agit d'une perte de fonctions neurologiques étendue sur plusieurs années. Les systèmes de soutien familial qui encouragent et appuient les mourants sont également différents. D'après ce que disent un certain nombre d'experts, on reconnaît également que nous manquons d'informations de base et que nous devons encore trop nous fier aux anecdotes lorsqu'il s'agit d'évaluer les progrès réalisés.
Enfin, nous reconnaissons aussi que les soins en fin de vie font partie du régime de soins de santé du Canada et que leurs prestations varient selon les provinces. Il est essentiel que les provinces aient des fonctions dans ce domaine.
Je vais vous parler plus particulièrement du rôle de l'organisme que j'ai l'honneur de diriger, le Conseil de recherches médicales, qui est la principale agence fédérale chargée d'appuyer la recherche d'un océan à l'autre, dans tous les domaines, y compris la recherche sur les soins en fin de vie.
Je suis également venu vous dire ce que le sénateur Carstairs a déjà mentionné, c'est-à-dire que le CRM, avec ses grandes réalisations et ses 40 ans de contribution à l'élaboration de ressources de recherche au Canada, cessera d'exister lorsque le projet de loi C-13 sera adopté. Il se réincarnera dans les Instituts de recherche en santé du Canada.
On demande souvent combien le Conseil de recherches médicales investit dans la recherche sur les soins en fin de vie. La question est claire, mais je dois avouer que la réponse ne l'est pas. La science est sans limite, et les questions liées à la fin de la vie comportent de nombreux facteurs. On pourrait dire que la recherche sur ces facteurs fait partie de la recherche sur les soins en fin de vie.
Permettez-moi de vous donner une exemple. Le Dr Tony Yaksh est l'une des autorités mondiales dans le domaine de la gestion de la douleur. Il a acquis ses compétences en faisant une enquête sur les mécanismes de la douleur dans la moelle épinière. Aujourd'hui, des millions de gens partout dans le monde profitent de l'application de ses compétences à diverses étapes de la gestion de la douleur. La recherche peut porter sur les soins à donner aux personnes souffrant de maladies mortelles, mais, heureusement, les maladies mortelles d'hier peuvent aujourd'hui être traitées et parfois évitées.
À l'époque où j'ai obtenu mon diplôme, il y avait une grave épidémie de polio à Winnipeg. Depuis dix ans, il n'y a plus de polio en Amérique du Nord. Quand j'ai terminé mes études, la gestion des patients atteints de polio en phase terminale posait un énorme problème. Comment peut-on traiter des patients branchés sur des poumons d'acier de façon chronique et sur de longues périodes?
Je suis venu vous dire aujourd'hui que nous avons tous observé l'angoisse de Sue Rodriguez dans sa lutte contre la maladie de Lou Gehrig, la sclérose latérale amyotrophique. Les mécanismes qui entraînent la perte des cellules nerveuses sont en fait les mêmes pour le virus de la polio et la maladie de Lou Gehrig. À mon avis, nous pourrons bientôt cesser de nous concentrer sur l'aide à offrir aux patients atteints des souffrances qui mènent inexorablement à la mort provoquée par la maladie de Lou Gehrig pour nous tourner vers la prévention ou la thérapie. Il en va de même pour le sida. Il y a quelques années, cette maladie correspondait à une sentence de mort inévitable. Aujourd'hui, c'est encore dans bien des cas une maladie très grave, mais on la considère maintenant comme une maladie chronique plutôt que comme une mortelle.
Les questions relatives à la fin de la vie peuvent se manifester à des rythmes et selon des styles qui varient. La science est un continuum, un milieu sans frontière, dans lequel toutes les compétences et tous les outils, de la connaissance la plus fondamentale au sujet des molécules jusqu'à son application dans la recherche, les sciences sociales, la sociologie des collectivités, ont leur importance.
J'ai comparé la situation qui prévalait il y a cinq ans, quand vous avez produit votre rapport, à celle d'aujourd'hui. Nous constatons qu'il y a aujourd'hui une augmentation considérable des investissements. Il y a cinq ans, nous avions choisi d'étendre notre portefeuille de recherche. Aujourd'hui, le CRM verse 16 millions de dollars à des centaines de projets dans le domaine des soins en fin de vie; bon nombre de ces projets portent bien sûr sur la douleur. Permettez-moi de vous donner quelques exemples. Pour ce qui est des aspects psychiatriques des soins palliatifs, vous avez entendu le témoignage du Dr Chochinov, qui a discuté des aspects traités aujourd'hui par M. Mishara; le Dr Cohen, de l'Université McGill, étudie la qualité de vie du patient après son admission dans les unités de soins palliatifs; il y a aussi d'autres études sur la qualité de vie des patients atteints de maladies chroniques et sur les effets psychosociaux de ces maladies, sur l'évaluation de la douleur chronique, sur les programmes d'autogestion; Le professeur McGrath, un éminent scientifique canadien, a entrepris un programme de recherche sur la douleur chez les enfants, qui est financé par le CRM.
Je suis également venu témoigner de ce que la recherche en soins palliatifs n'est pas suffisamment financée. Pour être florissante, la recherche a besoin de quatre éléments essentiels. Il faut des chercheurs, comme le Dr MacDonald a dit. L'Association canadienne des soins palliatifs a fait valoir qu'il faut accroître nos ressources dans ce domaine. Il faut investir dans nos chercheurs, car on ne saura trouver de solutions utiles, quelles que soient les sommes d'argent investies, si nous n'avons pas des chercheurs capables d'utiliser cet argent convenablement. Il faut également des installations. Le Dr MacDonald a également parlé d'un milieu qui soutienne la recherche. Les facultés de médecine ne semblent pas comprendre la situation et investir suffisamment. Cela montre encore une fois qu'aucun organisme ou établissement ne peut à lui seul fournir toutes les solutions.
En collaboration avec l'Association canadienne des soins palliatifs, le CRM a mis sur pied un programme de départ visant à établir des partenariats et à trouver des sources de financement mixtes pour les personnes qui souhaitent se lancer dans une carrière dans ce domaine. C'est le premier programme de ce genre.
Nous sommes sur le point d'adopter au Canada une nouvelle approche en matière d'organisation et d'établissement -- une entreprise plus moderne de recherche en matière de santé, une fois que le projet de loi C-13 sera appliqué. Ce projet de loi entraînera la création des Instituts de recherche en santé du Canada, dont l'objectif le plus fondamental est de créer un climat compétitif à l'échelle internationale. Le premier ministre a déclaré que le Canada doit être un pays de découverte de nouvelles connaissances, de la plus fondamentale à la plus appliquée. Il faut mettre en place une vision intégrée de la recherche en matière de santé et ne pas se concentrer seulement sur la recherche fondamentale, mais aussi sur l'application de la science, sa concrétisation, son adoption et sa diffusion, pour le plus grand profit de tous les Canadiens.
Dans cette nouvelle structure, les organismes comme l'Association canadienne des soins palliatifs auront l'occasion de participer systématiquement à l'établissement de priorités. Les Instituts de recherche en santé du Canada pourront, contrairement au CRM, faire des investissements stratégiques. Le Programme national de recherche et de développement en matière de santé, qui relève de Santé Canada, sera intégré aux Instituts de recherche en santé du Canada, et tout ce domaine, de même que le CRM, fera partie du portefeuille des instituts.
Les programmes de transition, qui ont déjà commencé à être mis en oeuvre grâce au nouveau financement fourni par le gouvernement, offriront eux aussi de nouvelles possibilités. Entre autres, les Alliances communautaires pour la recherche en santé permettront à des organismes comme l'Association canadienne des soins palliatifs de travailler en partenariat avec les chercheurs et de faire des propositions qui pourront être appuyées par les Instituts de recherche en santé du Canada.
J'ai hâte que nous entamions une nouvelle ère, que nous ayons de nouvelles possibilités qui nous permettront de mieux traiter les questions importantes qui nous touchent tous intensément et personnellement à un moment donné de notre vie, grâce aux connaissances que produiront des investissements plus grands dans des recherches plus ciblées que jamais. On encouragera la recherche intégrée et pluridisciplinaire en santé dans le climat créé au moyen des ISRC. J'ai hâte que le projet de loi soit envoyé au Sénat par la Chambre des communes, qu'il soit adopté et proclamé.
La présidente: Notre dernier témoin de ce matin est M. Russel Ogden, qui a également comparu devant nous lorsque nous avons étudié pour la première fois cette question importante.
M. Russel Ogden: Honorables sénateurs, merci de votre invitation à venir vous rencontrer ce matin. Vous vous souviendrez peut-être que lorsque j'ai comparu devant vous, il y a cinq ans, j'avais réclamé que soient effectuées des recherches sur les comportements illégaux que sont l'aide au suicide et l'euthanasie. J'ai donc été très heureux que dans votre rapport, «De la vie et de la mort», vous recommandiez que soit fait un examen de la fréquence des demandes de suicide assisté et d'euthanasie, des raisons pour lesquelles ces demandes sont faites et des solutions de rechange acceptables pour ceux qui présentent ces demandes.
Je ne suis pas venu discuter si la mort illégale est bien ou mal. En tant que chercheur, ce qui m'intéresse, c'est de comprendre pourquoi certaines personnes demandent à être tuées et pourquoi d'autres personnes acceptent de les aider à mourir. Vous conviendrez que ce sont des questions fondamentales pour les soins en fin de vie et que ces questions sont également pertinentes au droit pénal canadien.
En tant que chercheur, je vais vous parler des obstacles auxquels j'ai été confronté lorsque j'ai essayé de faire le genre de recherches que préconisait votre rapport il y a cinq ans. Je dis que sans financement réservé à cette fin et sans aide explicite des gouvernements à de telles recherches, il est peu probable que les établissements d'enseignement supérieur nous aident à trouver les réponses aux questions posées dans les chapitres VII et VIII du rapport «De la vie et de la mort».
Dans le mémoire que je vous avais présenté en 1994, je disais que les recherches sur les questions relatives à l'aide à la mort devaient être assorties d'une forme quelconque de protection, fournie peut-être par le ministre de la Justice. Vous vous souviendrez qu'à cette époque, je venais de terminer une enquête sur le phénomène «clandestin» de l'aide à la mort chez les personnes atteintes du VIH.
Lors de ma première comparution devant le comité du Sénat, cette étude a suscité de nombreuses préoccupations persistantes. Son sujet avait fait l'objet d'une enquête du bureau du coroner régional de Vancouver. Afin d'en savoir davantage sur le cas d'une femme qui avait été asphyxiée après avoir tenté de se suicider avec l'aide de quelqu'un, le coroner régional de Vancouver avait voulu m'obliger à divulguer des renseignements confidentiels que j'avais obtenus dans le cadre de cette recherche. Je lui ai opposé un refus car en divulguant ces renseignements, j'aurais miné le secret professionnel qui était essentiel à ma recherche. Évidemment, je n'aurais jamais pu être informé d'actes secrets et illégaux d'aide au suicide si mes répondants craignaient d'être ensuite traînés devant les tribunaux.
En fin de compte, le coroner a décidé que je jouissais du privilège conforme à l'intérêt public de pouvoir protéger la vie privée des répondants à ma recherche. Le critère de common law appliqué dans ce cas est celui qu'on appelle le critère Wigmore. Ce critère s'applique au cas par cas. D'après les opinions juridiques rendues récemment par deux professeurs de droit de l'Université de la Colombie-Britannique, Michael Jackson et Marilyn McCrimmon, le critère Wigmore est peut-être la meilleure solution pour les chercheurs qui souhaitent contester le pouvoir d'un tribunal de les obliger à révéler des renseignements confidentiels obtenus dans le cadre d'une recherche.
Pour défendre la vie privée de mes répondants devant le coroner, j'ai fait valoir que l'intégrité d'une recherche exigeait que les chercheurs ne soient pas perçus comme des outils du système de droit pénal. Malheureusement, l'administration de l'université Simon Fraser, ou je réalisais ma recherche, ne partageait pas les mêmes préoccupations que moi en matière de liberté des chercheurs et elle a refusé d'appuyer mes arguments devant le coroner. Cela a eu pour effet de décourager les chercheurs qui enquêtent sur des comportements illégaux. En fait, l'école de criminologie de l'université a pris la peine d'informer tous les étudiants de deuxième et troisième cycle qu'ils ne pouvaient compter sur l'appui de l'administration de l'université en cas de complications dans leurs recherches sur des comportements délicats. Comme vous le pensez bien, cela a modifié la nature et la portée des recherches effectuées par les étudiants dans cette université, et peut-être ailleurs aussi. Il a fallu attendre quatre ans et un jour après la décision du coroner pour que le président de l'Université Simon Fraser présente des excuses et déclare que l'université avait eu tort en refusant de défendre la liberté de la recherche universitaire.
Néanmoins, bien des gens s'inquiètent encore de ce que l'université n'a pas l'intention de faciliter la recherche dans des sujets très délicats comme l'euthanasie, la prostitution ou la consommation de drogues illégales. Je crois savoir que dans l'état actuel des choses, les étudiants de deuxième et troisième cycle et les membres du corps enseignant n'ont pas l'autorisation de faire des recherches selon le protocole qui s'appliquait à la mienne. Plus particulièrement, l'université ne permet plus aux chercheurs de garantir à leurs répondants qu'ils seront protégés par le secret professionnel. Cette situation est tragique, car elle nuit à la recherche empirique dans des domaines essentiels de politique sociale. Elle nuit à la recherche que vous avez réclamée, aux recherches sur l'euthanasie et l'aide au suicide.
Les représentants du PNRDS vous ont dit précédemment qu'un financement avait été consenti à la recherche sur les soins en fin de vie effectuée sous forme de rapports de synthèse. C'est un type de recherche qui ne présente pas de risque. Il semble que la nouvelle orientation soit de faire ce genre de recherches aseptisées et sans danger. Toutefois, je soumets que même si les recherches évaluatives de ce genre peuvent être très utiles, car elles permettent d'examiner ce que nous savons déjà, elles ne peuvent nous fournir autant d'informations que la recherche empirique directe.
Mais il n'y a pas qu'au Canada que des obstacles institutionnels rendent difficiles la recherche sur l'aide à la mort. Après que le rapport «De la vie et de la mort» a recommandé une augmentation de la recherche dans ce domaine, j'ai entrepris des études de doctorat à l'Université d'Exeter, en Angleterre. J'y ai réalisé plus de 100 entrevues dans quatre pays: l'Angleterre, les Pays-Bas, les États-Unis et le Canada. Je faisais encore une fois des recherches sur les questions liées à la fin de la vie, plus particulièrement à l'euthanasie et à l'aide au suicide. Vers la fin de ma recherche sur le terrain, on a découvert que le président du Comité d'éthique du département avait en secret modifié les conditions initiales d'approbation éthique et la déclaration d'appui de l'université quant au caractère confidentiel de la recherche. Il a insisté sur le fait que l'approbation éthique de la recherche n'avait pas été modifiée ou annulée. C'était toutefois complètement faux. Ces mesures avaient pour effet de miner le consentement éclairé de tous les participants à ma recherche, et les conditions dans lesquelles je croyais réaliser ma recherche n'avaient jamais vraiment existé.
L'Université d'Exeter a tenu une enquête qui a constaté que l'approbation éthique de ma recherche de doctorat avait été mal effectuée et révélait un problème grave d'incompétence et de manque de jugement au sein du département. L'enquête a révélé que la supervision de la recherche était inadéquate et insatisfaisante. Je me sens bien à l'aise d'utiliser ces termes puisque c'est ce qu'on dit dans le rapport de l'université elle-même. Mais jusqu'à présent, l'Université d'Exeter n'a toujours pas accepté de préciser quelle était l'approbation éthique réelle de cette recherche, malgré les directives claires que lui a données son propre comité d'enquête. Une telle inertie institutionnelle a des conséquences graves pour la recherche et le moral des chercheurs.
C'est donc avec regret que je vous signale que même si ma recherche correspondait exactement aux recommandations des chapitres VII et VIII de votre rapport, je n'ai toujours pas trouvé le moyen de la continuer. Mon message, c'est qu'à l'heure actuelle, les établissements d'enseignement supérieur n'offrent pas un milieu suffisamment fertile pour mettre en oeuvre les recommandations du comité du Sénat en matière de recherche sur l'aide au suicide et l'euthanasie.
Permettez-moi de proposer quelques solutions à ce problème. Tout d'abord, il faut prévoir un financement indépendant des recherches correspondant aux recommandations des chapitres VII et VIII de votre rapport. Ce financement devrait être offert à des chercheurs qualifiés qui ne travaillent pas nécessairement dans des établissements. Deuxièmement, il faut offrir aux participants et aux chercheurs une protection quelconque de façon à faciliter la collecte de données et la conservation sans danger de ces données.
Comme je le disais en 1994, et je le répète, le ministre de la Justice pourrait peut-être prendre des dispositions pour que ces renseignements soient considérés comme confidentiels. Ces dispositions pourraient être semblables à celles qui protègent déjà les chercheurs de Statistique Canada. Comme autre mesure de protection, on pourrait instaurer un régime de «certificats de protection de la vie privée», comme il en existe aux États-Unis, par l'entremise du ministère de la Justice. Ou bien, on pourrait distribuer des «certificats de confidentialité». Ces documents sont distribués par le Department of Health and Human Services des États-Unis. Le Sénat devrait envisager la possibilité de mettre en place de tels régimes de protection à l'intention des chercheurs canadiens.
Enfin, permettez-moi de parler brièvement de la recommandation unanime du rapport «De la vie et de la mort» visant à ce que l'euthanasie et l'aide au suicide continuent d'être des actes criminels. Comme je l'ai déjà dit, je ne suis pas ici pour débattre du caractère moral de ces actes. Je tiens toutefois à informer le comité de certains nouveaux développements au sein du mouvement clandestin d'aide au suicide.
C'est un mouvement que j'ai baptisé «contre-culture de la mort», car ses membres estiment qu'ils offrent des «services d'aide à la mort», de la même façon que les sages-femmes ou les médecins aident aux naissances. Cette contre-culture de la mort est organisée et très au point. Le Dr Young vous a dit que Jack Kevorkian avait élargi le cadre de ses activités. Il en va de même de ce mouvement. Ses membres ont lancé ce qu'ils appellent l'initiative «technologie nouvelle». Le but de cette initiative est de mettre au point des moyens non pharmaceutiques de provoquer une mort rapide et sans douleur. Il semble que cet objectif ait été atteint, car le mouvement a produit toute une gamme de moyens qui peuvent provoquer la mort en quelques minutes. Il s'agit de dispositifs relativement faciles à construire et qui ne nécessitent ni les substances ni les précurseurs dont on vous a dit précédemment qu'ils relevaient du Programme des produits thérapeutiques du Canada.
Enfin, la plupart des éléments nécessaires à ces appareils peuvent être achetés dans des grands magasins de détail. Puisque ces appareils de nouvelle technologie ne nécessitent ni injections ni doses mortelles de médicaments, il n'est pas possible de retrouver une «arme du crime». D'après les nombreux essais organisés par ce mouvement clandestin, lorsque ces appareils sont utilisés, la cause réelle du décès passe toujours inaperçue.
Je vous signale que l'objectif clandestin de mettre au point des méthodes non pharmaceutiques d'aide à la mort cause des problèmes graves aux professionnels de la santé, aux législateurs et à ceux qui élaborent les politiques. Ces appareils de nouvelle technologie suscitent bon nombre des mêmes problèmes que la pilule du lendemain, car ils créent un écart entre les patients et leurs soignants, quand il faut discuter des décisions à prendre en matière de fin de vie.
Il est à peu près impossible de mettre fin à ce mouvement clandestin et il semble qu'il constitue une industrie en pleine croissance. Je n'ai pas de solutions à vous proposer à ce sujet. Il s'agit d'une réaction entrepreneuriale à ce qu'on considère être les obstacles à l'aide médicale légale au suicide. C'est le résultat d'une interdiction. Il s'agit d'une caractéristique qui a déjà été constatée à maintes reprises dans le cas d'autres comportements interdits. Si je le mentionne, c'est qu'il faut tenir compte des conséquences du choix de l'interdiction de l'aide au suicide et de l'euthanasie volontaire plutôt que d'autres options comme la réglementation et le contrôle social.
Le sénateur Beaudoin: Ma question s'adresse au Dr Young. Vous avez dit qu'il faudrait au moins préciser certains articles du Code criminel?
Dr Young: Oui, monsieur.
Le sénateur Beaudoin: Je crois savoir que vous parliez de deux domaines en particulier, plus précisément du retrait du traitement et de son refus. C'est bien dans ces domaines-là qu'il faudrait apporter ces précisions, ou dans d'autres?
Dr Young: Il faudrait créer un article distinct du Code criminel dans lequel on définirait le délit portant le nom d'euthanasie et les sanctions qui en découlent.
Le problème des tribunaux, lorsqu'ils examinent un cas qui va à l'encontre du Code criminel actuel, c'est que l'avocat de la Couronne et les policiers doivent longuement débattre des accusations qui devraient être portées. Doit-on porter des accusations de meurtre au second degré ou d'homicide? Dans la plupart des cas, en Ontario, on a fini par porter des accusations «d'administration d'une substance nocive», qui est loin de correspondre à l'esprit de cette disposition.
Parallèlement, les tribunaux ont essayé de déterminer quelle serait une sanction raisonnable dans ces cas. Si l'acte criminel était clairement inclus dans le Code criminel, y compris la gamme des sanctions qui peuvent être imposées, le problème serait beaucoup moins grand et le débat en serait éclairé. La définition des délits peut être modifiée et je ne veux pas discuter de ce que devrait être cette définition. Je dis simplement qu'il faudrait le préciser.
Lorsqu'on veut contrôler une activité, il est important entre autres d'établir les limites et les moyens de les respecter. C'est le problème qui se pose, à l'heure actuelle.
Le sénateur Beaudoin: Lorsque le rapport précédent a été publié, le nom de Sue Rodriguez faisait souvent la manchette. À cette époque, la décision rendue traitait un peu la question de l'aide au suicide et indirectement peut-être, de l'euthanasie.
Le rapport précédent était unanime dans au moins trois ou quatre domaines: les soins palliatifs, le débranchement des appareils, le refus de traitement, et quelques autres. Le but de notre comité est de revoir les sujets sur lesquels les sénateurs s'étaient entendus de façon unanime.
Le président d'un groupe de médecins canadiens a déclaré qu'il ne faut rien changer aux lois. Il vient de Montréal.
La présidente: Les représentants du Collège royal des médecins et chirurgiens ont dit qu'il n'était pas nécessaire d'adopter une nouvelle loi, même si l'Association médicale canadienne était d'avis contraire.
Le sénateur Beaudoin: Ils ont dit qu'il n'est pas nécessaire de modifier le Code criminel. J'ai été étonné de cette observation, mais c'est une proposition intéressante.
Vous avez dit que vous êtes en faveur de modifications au Code criminel. J'en conclus qu'il faut préciser les dispositions du Code à l'intention des soignants, médecins, infirmiers-infirmières, et cetera. Les soignants doivent savoir ce qu'ils ont le droit de faire et ce qui est illégal.
À l'heure actuelle, nous ne traitons pas de l'euthanasie et de l'aide au suicide en soi, mais plutôt de tous les autres aspects du premier rapport. Même dans ces domaines, je suis enclin à croire qu'il ne faut pas seulement se fonder sur la jurisprudence, que ce soit celle du Québec, de l'Ontario ou d'autres provinces. Ce qu'il nous faut, c'est un Code criminel plus précis dans ces domaines.
Le Code criminel est souvent modifié. C'est un aspect difficile du droit, mais il est néanmoins très important. Il faudrait peut-être améliorer les dispositions du Code criminel au sujet du débranchement des instruments et du refus de traitement.
Je ne vois pas de gros problèmes dans le domaine des soins palliatifs puisque cela ne touche pas le droit pénal. De quelle façon pensez-vous que nous devrions modifier le Code criminel, aux fins de ce comité?
Dr Young: Le domaine dont je parlais relève de votre mandat. Le juge Sopinka a déclaré dans sa décision qu'il était évident qu'à un certain moment quelqu'un commet un acte criminel. Le problème est d'interpréter à quel moment cela arrive. Tout ce que nous pouvons faire pour clarifier les choses permettrait aux gens de comprendre que ce concept peut être utile également pour les soins palliatifs.
Les changements que je propose visent à clarifier des choses. Je ne demande pas qu'on change certains articles, je demande simplement que ce soit plus clair. Je pense qu'une définition distincte de l'euthanasie donnée dans le Code criminel ainsi qu'une série de peines pourraient faire beaucoup dans ce sens.
Je savais qu'il y avait un débat entre les groupes de médecins mais ils ne traitent pas de la question chaque jour sur plan pratique comme moi. Il serait très utile que la chose soit mieux définie et je crois que cela servirait aussi les intérêts actuels du comité.
Le sénateur Beaudoin: Il y a deux écoles de pensée à ce sujet. Il y en a qui disent: «Laissez les médecins décider. Laissez les tribunaux intervenir en cas de problème.» D'autres disent: «Ce problème peut être réglé en améliorant le droit pénal.» Je suis plus attiré par la seconde option.
Tout laisser aux tribunaux, même si nous avons un bon système judiciaire, n'est pas possible. Nous -- sénateurs et députés -- sommes tenus d'adopter de bonnes lois. C'est mon point de vue. J'ai l'impression que nous devrions peut-être dans notre rapport faire certaines propositions dans ce sens et ne pas laisser la question entièrement entre les mains des médecins, des infirmiers et infirmières et des tribunaux, comme cela se fait dans certains pays. Dans notre pays, nous devrions préférer la deuxième école de pensée.
En votre qualité de médecin légiste, vous avez quotidiennement affaire à la mort. Votre expérience est très importante pour nous. Si vous dites qu'il faut davantage de lignes directrices, davantage d'informations et de meilleures lois, je vous entends. Je crois que c'est en effet la solution.
Dr Young: Cela me plaît toujours que quelqu'un soit d'accord avec moi. Comme je travaille quotidiennement dans le domaine de la justice, j'en suis arrivé à la conclusion il y a longtemps que moins on laisse de place à l'interprétation, mieux c'est. Sinon, c'est compliqué et ce n'est pas la meilleure façon de régler un problème.
Le sénateur Beaudoin: Je n'irai peut-être pas jusque-là parce que j'ai énormément d'admiration pour notre système judiciaire.
Dr Young: Moi aussi, mais cela cause aussi des tas de problèmes.
Le sénateur Beaudoin: Les décisions de la Cour suprême ces cinq dernières années ont rappelé au Parlement qu'il devait faire son travail et qu'elle était prête à faire le sien. Elle fait un travail fantastique. Les pouvoirs législatif et judiciaire doivent l'un et l'autre faire leur travail. C'est tout ce que je veux dire.
Dr Young: Je disais que même si l'on rendait les choses plus claires, les tribunaux devraient à l'occasion intervenir. Le problème, à l'heure actuelle, est que ce n'est pas suffisamment clair. On pourrait éviter beaucoup de cas et de problèmes en clarifiant les choses. On n'éliminera jamais le rôle des tribunaux. Toutefois, il est beaucoup plus facile pour les tribunaux d'agir lorsque les choses sont claires: il s'agit alors simplement de savoir si un comportement représente ou non un abus. Laisser trop à l'interprétation des intervenants aboutit à certaines incohérences pour les médecins et les infirmiers et infirmières. Différentes pratiques peuvent être adoptées dans le pays parce que différentes personnes interprètent différemment la même loi. Je ne pense pas que cela soit sain, en particulier lorsque ceux qui interprètent la loi n'ont pas forcément reçu une formation juridique.
La présidente: Docteur Young, diriez-vous qu'en Ontario, il est presque impossible de condamner pour l'euthanasie et l'aide au suicide?
Dr Young: Nous avons en effet constaté que c'est extrêmement difficile. Il n'y a pas d'infraction appelée «euthanasie», alors on essaie de faire l'impossible. On a eu des condamnations pour l'administration de substance délétère mais c'était vraiment mettre la pièce à côté du trou. Deux de ces cas sont allés de meurtre au premier degré à homicide involontaire, voies de fait et administration de substance délétère sans même passer par meurtre au second degré. C'était difficile et gênant mais, en même temps, la province estimait que ces actes avaient dépassé la norme à tel point qu'ils devaient être confiés aux tribunaux. C'est tout ce que nous pouvions faire.
Le sénateur Corbin: Docteur Friesen, vous avez fait allusion au sous-financement de la recherche en matière de soins palliatifs. Je suppose que vous parliez du financement public. Quelles sources de financement privées existe-t-il actuellement? Savez-vous si des compagnies pharmaceutiques, ou d'autres organismes de ce genre, font des recherches sérieuses à propos des soins palliatifs?
Dr Friesen: Le financement de la recherche au Canada repose sur quatre grands piliers: le gouvernement fédéral, les gouvernements provinciaux, le secteur bénévole et le secteur privé ou l'industrie. L'industrie pharmaceutique est le plus gros investisseur aujourd'hui, un milliard de dollars environ par an. Dans ce portefeuille, il y a beaucoup d'exemples de recherche qui touche les questions des soins en fin de vie. Un des principaux exemples est AstraZeneca, qui s'est donné un mandat peut-être pas à l'échelle internationale, mais pas loin, pour la découverte de mécanismes et de molécules de contrôle de la douleur, à Montréal. Pourquoi Montréal? Parce qu'il y a certains chercheurs très novateurs à Montréal qui ont fait des découvertes importantes sur des molécules que l'on pourrait utiliser pour tout un éventail de modes de gestion de la douleur.
Je répondrai donc à votre question qu'il y a en effet d'importants investissements du secteur privé. D'après les derniers renseignements que j'ai, quelque 120 personnes sont engagées dans cet effort à Montréal. Ce n'est qu'un exemple. Il y en a d'autres semblables -- peut-être pas toutefois à exactement la même échelle.
Il y a aussi beaucoup d'essais cliniques sur de nouveaux agents et produits thérapeutiques qui sont financés par le secteur privé. Il y a, évidemment, certains investissements plus modestes qui sont effectués par des fondations locales et des groupes à but non lucratif. Les plus remarquables sont ceux que la Société canadienne du cancer et la National Cancer Institute ont sollicités.
Le sénateur Corbin: Pour ce qui est de la participation privée à ces types de recherche, les résultats sont-ils habituellement mis à la disposition de la profession en général ou est-ce limité, confidentiel, du fait des droits de propriété, de la mise au point de certains médicaments, et cetera? Où en est-on à ce sujet?
Dr Friesen: Toutes les connaissances émanant des investissements en recherche que font les gouvernements fédéral et provinciaux et les organismes à but non lucratif sont publiques. Je suppose que les connaissances qui émanent des recherches financées par le secteur privé aboutissent de façon générale aussi dans le domaine public plus rapidement que par le passé. Surtout s'il y a partenariat avec le gouvernement fédéral comme dans le cas du Conseil de recherches médicales. Tous ces sujets de recherche sont publiés. Les listes sont disponibles.
Ce n'est pas tellement une question de domaine public ou privé, mais plutôt de dissémination et d'utilisation de ces nouvelles connaissances. Il y en a de plus en plus, cela change de plus en plus vite, si bien que même un médecin qui essaie de se tenir à jour a du mal à absorber tous les nouveaux renseignements qui pourraient être utiles.
Une nouvelle tendance est que des patients ou clients qui sont mieux renseignés arrivent armés d'informations glanées sur Internet. Cela permet un dialogue mieux éclairé entre le patient ou le client et le praticien. Le client déclare: «Docteur, j'ai lu toutes ces informations. Pourquoi n'utilisons-nous pas plutôt ce médicament que celui-ci?» C'est un nouvel aspect intéressant de la pratique médicale, c'est à mon avis probablement assez sain.
Le sénateur Corbin: Docteur Young, pour poursuivre l'échange que vous aviez avec le sénateur Beaudoin sur la clarification de certaines choses dans le Code criminel, je suppose que vous ne défendiez pas le meurtre pour raison de compassion?
Dr Young: Non. Je ne dis pas qu'il faudrait nécessairement changer quoi que ce soit dans la définition. Je dis que quelle que soit la définition que l'on utilise -- et à supposer que nous nous en tenions à la définition actuelle --, il devrait être indiqué clairement dans la loi, il devrait y avoir une infraction précise dans le Code criminel disant que: «Si l'on va plus loin, c'est l'euthanasie et voici les peines prévues pour cela».
Le sénateur Corbin: Docteur Young, j'aimerais avoir vos réactions aux observations de M. Ogden sur les services clandestins, organisés, d'aide à la mort. Cela vous pose-t-il un problème?
Dr Young: Cela pose un gros problème. Je sais qu'il y eu des rapports à ce sujet. En Ontario, nous n'avons pu exposer directement ce genre de choses. Je ne serais pas étonné qu'il ait raison, que les choses évoluent dans ce sens et pour les raisons que j'ai indiquées. Tout d'abord, nous ne sommes pas souvent appelés à domicile et, quand nous le sommes, nous devons en général nous contenter des informations qui nous sont données. Si l'on peut prouver que quelqu'un était en phase terminale et que ceux qui sont présents semblent se comporter normalement, il est difficile de faire quoi que ce soit. Dans la plupart des cas, si l'on a des doutes, c'est parce que quelqu'un dit ou rapporte quelque chose qui enclenche une enquête, ou, dans le cas des hôpitaux, parce qu'il y a un élément inattendu dans un décès.
Le sénateur Roche: Je reviens encore une fois à l'une de mes principales préoccupations. Il semble presque impossible de faire une distinction nette entre les soins palliatifs, que nous favorisons, et la tendance vers l'euthanasie. Le témoignage que nous avons eu ce matin est tout à fait remarquable à cet égard. Je conclus des observations du Dr Young que dans le cadre général des soins palliatifs, et souvent à domicile, il y a certains cas assez douteux. J'en resterai là pour le moment et inviterai le Dr Young à ajouter quelque chose s'il le souhaite.
M. Ogden nous a présenté un témoignage que je qualifierais presque de «coup de théâtre». Alors que je pensais que je suivais ce domaine d'assez près, je ne savais pas qu'il y avait un mouvement clandestin d'aide à la mort qu'il appelle la «contre-culture de la mort». Il dit que c'est un mouvement organisé et clandestin qu'il est pratiquement impossible d'arrêter et qui semble se développer.
Je suggérerais que nous prenions ce témoignage très au sérieux, si c'est crédible -- je ne veux pas dire que le témoignage de M. Ogden ne soit pas crédible -- ou que nous le rejetions. En tout cas, il ne semble pas qu'il y ait suffisamment de preuves empiriques que cette nouvelle industrie se développe. Je reste devant le même dilemme que tout à l'heure: comment peut-on discuter de soins palliatifs et de la nécessité de les renforcer à tous points de vue sans tenir compte du témoignage du Dr Young -- sur la limite qu'il faut que les gens comprennent qu'ils ne peuvent franchir?
Dr Young: Il y a un certain nombre d'organisations publiques qui s'efforcent de veiller à ce que les gens puissent mourir dans la dignité. Je ne les nommerai pas. Il y a aussi des groupes comme la Hemlock Society, mais je ne sais vraiment pas si ces groupes représentent ce dont parlait M. Ogden. Je ne sais pas jusqu'où vont leurs activités parce qu'il est très difficile de faire enquête à leur sujet. Le livre publié par la Hemlock Society, qui indique comment provoquer la mort par des moyens chimiques, a créé de gros problèmes pour les médecins légistes et les médecins examinateurs en Amérique du Nord. Dans bien des cas, c'est devenu un outil pour des gens qui n'étaient pas en phase terminale mais qui étaient déprimés ou voulaient se suicider. Si de tels mécanismes existent -- et je ne le sais pas --, pourraient-ils et seraient-ils utilisés à mauvais escient? Je le crois. Ce livre a été utilisé et pas toujours à bon escient. Le mouvement clandestin qui est à l'origine de ce livre s'est développé. Pour le reste, je devrais laisser M. Ogden répondre. Je me trouve dans la position peu agréable de me demander si cela existe effectivement et de ne pouvoir le prouver.
Le sénateur Roche: Avant que nous ne passions à M. Ogden, docteur Young, les soins palliatifs moralement acceptables et légalement autorisés incluent, entre autres, l'interruption d'un traité et l'administration de morphine à fortes doses. Êtes-vous professionnellement d'avis que ces deux instruments sont employés délibérément pour hâter la mort dans certains des cas auxquels vous avez fait allusion.
Dr Young: Je ne sais pas si j'inclurais l'interruption, mais en fait cela pourrait accélérer la mort. Le fait est qu'une personne a le droit de refuser un traitement. Je serais porté à dire que cela est acceptable. Des médicaments sont-ils utilisés pour accélérer la mort? À mon avis cela se produit à l'occasion.
Le sénateur Roche: Ainsi, dans le cadre de l'étude par notre comité de l'amélioration des soins palliatifs, il nous faudrait signaler que cette surutilisation des médicaments n'est pas acceptable?
Dr Young: C'est important. Il faut dire clairement jusqu'où on peut aller. Si l'on fait la promotion de bons soins palliatifs, il y a moins de chance que les gens dépassent volontairement les limites. C'est pourquoi je suis tant en faveur des propositions du Dr MacDonald. Assorties des précisions nécessaires dans la loi, elles aideront à faire en sorte que les gens respectent ces limites importantes.
Le sénateur Roche: Plusieurs témoins ont fait ce commentaire, et cela nous a été fort utile.
Monsieur Ogden, j'aimerais revenir à votre dernière phrase: Si je mentionne ce mouvement clandestin, «c'est qu'il faut tenir compte des conséquences du choix de l'interdiction de l'aide au suicide et de l'euthanasie volontaire plutôt que d'autres options comme la réglementation et le contrôle social.»
Je dois avouer que je ne sais vraiment pas ce à quoi vous voulez en venir.
M. Ogden: Lorsque j'ai parlé des conséquences du choix de l'interdiction, je voulais dire que cela force automatiquement les gens à chercher d'autres solutions qu'ils ne peuvent trouver dans le système juridique.
Par exemple, si un particulier ne peut pas avoir accès de façon légale à l'aide à la mort, et est convaincu que l'euthanasie est la seule solution, il trouvera les moyens. Dans le cas qui nous occupe, cela veut dire qu'on aura recours aux mécanismes dont j'ai parlé. Je pense par exemple à celui qu'on appelle le «dérespirateur», qui recycle en fait l'air respiré par une personne jusqu'à ce qu'il y ait mort par asphyxie. D'autres dispositifs permettent la respiration de gaz inertes, comme l'hélium et l'azote. Ceux qui respirent ces gaz, qui existent en fait dans notre atmosphère, meurent dans quelques minutes. D'après certains rapports, ils meurent en cinq ou six minutes.
Ce que j'essaie de dire c'est que lorsque nous interdisons certains comportements, et que certains citoyens veulent toujours faire ces choses interdites, ils trouveront d'autres façons de le faire. L'interdiction de l'alcool a mené les gens à construire leurs propres distilleries. L'interdiction de la prostitution veut simplement dire que les gens trouvent d'autres façons de se livrer à ce genre d'activités illégales. L'interdiction de l'aide légale au suicide veut simplement dire que certains particuliers trouveront des façons d'avoir accès à ce genre de service.
Par contre, l'avantage des règlements et des autres formes de contrôle social, lorsque l'on est réceptif à la légalisation ou la quasi-légalisation de certains comportements, c'est que cela nous permet d'assurer une certaine forme de surveillance sociétale, professionnelle et gouvernementale.
Je sais que l'idée d'importer l'expérience hollandaise au Canada ne sourit guère à votre comité, mais la réglementation de l'euthanasie dans ce pays a eu pour effet de rendre cette activité un comportement très contrôlé par la société. Au cours des 20 dernières années, l'accès à l'euthanasie et à l'aide au suicide est devenu de plus en plus réglementé en Hollande. Il existe en fait actuellement beaucoup plus de contrôle social sur ce genre de comportements qu'auparavant.
Le sénateur Roche: Êtes-vous un défenseur de l'expérience hollandaise?
M. Ogden: Je dirais simplement que cette expérience présente des avantages, mais je ne sais pas s'il serait possible de l'exporter au Canada. Je crois que nous devons régler nos problèmes ici.
Le sénateur Roche: D'après votre témoignage j'en conclus que quelqu'un -- soit nous ou le système juridique -- doit faire quelque chose pour régler le problème que présente ce mouvement clandestin. Vos commentaires me laissent un peu perplexe; c'est peut-être simplement que je n'arrive pas à comprendre.
Je ne sais pas à quoi m'en tenir dans le cas de ce témoignage, madame la présidente. Je ne sais pas si je dois prendre cela au sérieux, la présence d'un tel mouvement clandestin, et essayer d'obtenir plus de renseignements, demander au témoin de nous en dire un peu plus long, ou simplement ne pas en tenir compte.
La présidente: Pour être honnête, il ne serait pas du tout utile dans le cadre de notre étude de nous pencher plus à fond sur cette question. Cependant, il faut se rappeler que nous avons formulé une recommandation proposant que des recherches soient effectuées au Canada afin de découvrir pourquoi les gens veulent avoir accès à l'euthanasie et à l'aide au suicide. C'était là une des recommandations que nous avons adoptées à l'unanimité.
Ce qui est pertinent dans ce que M. Ogden nous a dit aujourd'hui, c'est qu'en fait cette recherche n'a pas été effectuée. Enfin, si j'ai bien compris ce qu'a dit M. Ogden, non seulement cette recherche n'a pas été effectuée, mais de plus, du moins dans le cas de M. Ogden, on a posé des obstacles à cette recherche. Est-ce que vous voulez nous dire aujourd'hui?
M. Ogden: Oui.
Le sénateur Roche: S'il y a un mouvement clandestin -- une industrie en pleine croissance selon la description de M. Ogden -- qui fait la promotion de la mort, ne croyez-vous pas que le public et le Parlement devraient être mis au fait de la situation? Nous devrions en connaître tous les aspects avant de préparer un rapport qui portera sur la question.
La présidente: Le problème c'est que si nous faisions cela, nous passerions à des recommandations non unanimes du comité. Si vous lisez attentivement notre premier rapport, vous noterez que nous savions alors que l'euthanasie et l'aide au suicide, pour diverses raisons et par divers moyens, étaient des choses qui existaient au Canada.
Le sénateur Roche: Cependant, notre témoin a parlé d'une industrie en pleine croissance.
La présidente: Qu'il s'agisse d'une industrie en pleine croissance ou pas, que le problème soit plus marqué qu'en 1995 ou pas, nous ne le savons pas puisque nous avons décidé délibérément de ne pas étudier l'euthanasie et l'aide au suicide.
Je crois qu'il est juste de dire que nous avons entendu d'autres témoignages, en plus de celui de M. Ogden, qui indiquaient qu'il y avait des gens qui pratiquaient l'euthanasie. Ils obtenaient de l'aide pour l'euthanasie, déjà en 1995. Je ne crois pas qu'il est dans l'intérêt du comité d'étudier plus à fond, pour l'instant, cet aspect.
J'aimerais poser une question à M. Mishara, qui n'a pas encore participé à la discussion.
J'ai lu avec beaucoup d'intérêt votre article dans Omega, tout particulièrement en ce qui a trait à la recherche détaillée que vous avez faite afin d'établir le lien, comme l'a fait M. Harvey Chochinov, entre la mort et la dépression. Cependant, il reste une question fondamentale: Peut-on imposer un traitement pour la dépression à des patients? Vous ne pouvez pas imposer d'autres types de traitement aux patients.
M. Mishara: Ce n'est pas là à mon avis que se situe le vrai problème. Il s'agit plutôt de reconnaître que c'est peut-être un cas de dépression. Voilà la difficulté que présentent les solutions techniques comme une mesure législative, qui interdit certains comportements et en autorise d'autres.
Par exemple, actuellement les gens ont clairement le droit de refuser ou d'arrêter un traitement. C'est une solution technique, mais nous savons que beaucoup de gens qui décident de mettre fin à un traitement souffrent de dépression clinique. Personne n'a dit: «Peut-être ce patient souffre-t-il de dépression clinique. Peut-être devrions-nous lui offrir un traitement ou une aide ou du counselling.» La seule solution légale qui s'offre à nous est une solution technique, c'est-à-dire: «C'est un droit, je veux arrêter le traitement.» La question n'est plus de se demander ce qui est autorisé ou interdit, légal ou illégal, mais plutôt de reconnaître l'obligation d'une société de comprendre les dynamiques complexes qui caractérisent les situations de vie et de mort ainsi que l'obligation d'assurer les services nécessaires.
Évidemment, on ne peut pas faire grand-chose si quelqu'un dit: «Non, je ne veux pas prendre d'antidépressif. Je ne veux parler à personne de ma situation. Je veux simplement qu'on débranche.» On a clairement le droit de refuser un traitement. Ça c'est incontournable.
Cependant, dans la recherche et en proposant des solutions, il est plus facile de décider que nous dépenserons notre argent pour des analgésiques. D'importantes recherches se déroulent actuellement, mais elles portent plutôt sur le contrôle de la douleur, alors que les autres aspects, les dimensions psychologiques, sont oubliés. M. MacDonald a proposé certains critères pour de bons soins palliatifs qui ne se limitent pas au contrôle de la douleur. Cela est pertinent quand on parle de questions comme le mouvement clandestin pour l'aide à la mort. Si les gens, peu importe la raison, cherchent à mourir prématurément, ils trouveront un moyen d'atteindre leur objectif. Ceux qui participent au meurtre par compassion pour un être cher ne se disent pas lorsqu'ils posent le geste: «Cela est illégal. J'irai peut-être en prison.» Ils se disent: «Quelqu'un que j'aime souffre, je dois agir.»
Le problème, c'est que les solutions techniques ne sont pas nécessairement adéquates. Ce processus d'éducation et de sensibilisation, de communication des renseignements, est beaucoup plus difficile à garantir. Personnellement, je crois que cela est beaucoup plus important que simplement s'assurer que quelque chose qui est actuellement légal devient illégal ou de proposer des solutions très techniques.
La présidente: Le cinquième élément clé du document présenté par M. MacDonald porte sur l'évaluation et la gestion de divers problèmes; je crois que l'ordre dans lequel les choses sont présentées est très important. On y parle de problèmes psychologiques, sociaux, spirituels et religieux. Jugez-vous que l'évaluation et le traitement de la dépression fait partie de soins de qualité à la fin de la vie, si c'est ce que désire le patient, ou peut-être sa famille?
M. Mishara: Oui. Tout semble indiquer que ce genre de service n'est pas souvent disponible. Actuellement, lorsqu'il est disponible au Canada, c'est pour une certaine élite qui souffre de cancer, qui a déjà refusé d'autres interventions médicales, et qui vit dans une grande ville où de bons soins palliatifs sont disponibles.
Le sénateur Beaudoin: Monsieur Mishara, à la fin de votre exposé, vous dites «Les travaux de recherche révèlent que les membres de la famille ne respectent pas, souvent sciemment, les désirs exprimés par le patient. Certaines révèlent que les membres de la famille ont tendance à se fier exclusivement aux recommandations présentées par les médecins...» Vous concluez ainsi que «les médecins et les autres fournisseurs de soins se sentent souvent mal à l'aise et n'ont pas de lignes directrices claires quant à la façon de réagir face aux demandes des membres de la famille...»
Nous avons besoin de lignes directrices, mais la situation peut varier d'une province à l'autre. Certaines provinces ont déjà des lois qui stipulent que les médecins doivent agir. Par exemple, nous améliorons de plus en plus toute la question entourant les testaments de vie, le fait de coucher sur papier le mandat et la procuration. Ces documents sont des documents juridiques et exécutoires et doivent donc être respectés par les médecins et les fournisseurs de soins.
Pouvez-vous faire des suggestions à l'égard de lignes directrices? Personnellement, je pense que c'est peut-être en partie une question juridique. Peut-être avez-vous une autre idée.
M. Mishara: Dans certains cas il existe un document signé mais souvent ces documents n'existent pas parce que les gens ne s'attendent pas à ce que leur situation empire, ne s'attendent pas à tomber dans le coma ou à ne pas être en mesure de prendre eux-mêmes les décisions qui les touchent.
Des études ont été effectuées dans d'autres pays, et je n'ai aucune raison de croire que les résultats au Canada seraient différents. Par exemple, en Israël, une longue enquête a été effectuée afin de déterminer qui prenait les décisions. Très souvent, lorsqu'une personne est incapable de prendre des décisions, on consulte sa famille. «Que faisons-nous? Débranchons-nous cet appareil?» C'est une situation très difficile. Ces études révèlent que les membres de la famille prendront souvent la décision qui correspond le mieux avec ce qu'ils jugent être à l'avantage du patient, peu importe ce que ce patient avait dit plus tôt. Quelqu'un aurait peut-être dit: «Je veux qu'on débranche. Je ne veux pas continuer à vivre.» Mais un être cher n'aura pas le coeur de le faire.
Ces études révèlent que lorsqu'on demande aux membres de la famille comment ils en sont venus à une décision, ils répondent souvent qu'ils avaient demandé au médecin.
Encore une fois, nous revenons à ce qu'a dit M. MacDonald. Très peu de formation est offerte dans les facultés de médecine pour enseigner aux futurs médecins comment répondre quand un membre de la famille demande au médecin quoi faire. Cela fait rarement partie de la formation médicale officielle d'un médecin, et même quand ces cours existent, il n'existe pas de lignes directrices qui indiquent dans quelles circonstances on doit offrir certains types de conseils. Les médecins se sentent souvent très mal à l'aise.
Enfin, c'est ce qu'ont dit certains médecins qui ont été consultés lors d'un sondage effectué en Ontario pour connaître leurs réactions face aux demandes d'euthanasie par des particuliers ou des membres de famille. Ils veulent savoir comment répondre quand quelqu'un demande: «Que dois-je faire?». Il doit y avoir une forme de consensus officiel qui serait inclus dans la formation du médecin.
J'ai également abordé la question du consentement éclairé. Tous les travaux de recherche effectués indiquent que ce que les gens disent qu'ils voudraient à l'avenir n'est pas nécessairement lié à ce qu'ils veulent vraiment, lorsqu'ils sont conscients et capables d'exprimer leurs désirs. Cela pose un problème déontologique et pratique parce qu'il y a vraiment une différence marquée. C'est très facile lorsque vous êtes en bonne santé et que vous ne mourrez pas de dire: «Si jamais je suis branché et que c'est l'appareil qui me permet de vivre, je veux qu'on me débranche.» Cependant, lorsque dans les faits vous êtes branché à cet appareil et que la mort vous attend, vous n'avez pas nécessairement la même opinion. Les directives préalables posent donc certains problèmes moraux, juridiques et techniques.
Très souvent les solutions techniques ne sont pas adéquates. Nous pouvons adopter une loi stipulant que les gens doivent coucher par écrit leurs désirs et que les autres sont tenus de les respecter, tout indiquer clairement, ou nous pouvons adopter des règlements régissant les prescriptions en plus grande quantité d'analgésiques, mais ce que nous voulons faire, c'est rendre les soins humains, et c'est quelque chose qu'on ne peut pas légiférer. Les politiques et les pratiques doivent être élaborées puis mises en oeuvre.
Le sénateur Beaudoin: Si quelqu'un stipule dans son testament qu'il ne veut pas être réanimé dans certaines circonstances, et si la famille demande à ce médecin de ne pas tenir compte du testament, le médecin prendrait des risques importants parce qu'un testament c'est un testament.
M. Mishara: Un testament est un testament mais, en pratique, le médecin peut demander à la famille s'il y a testament et les membres de la famille peuvent répondre ce qu'ils veulent. Le testament n'est pas automatiquement transféré au médecin.
Le sénateur Beaudoin: Dans certaines provinces, le testament est enregistré et nous, les juristes, essayons d'améliorer le système. Évidemment, on dit quelque chose dans le testament mais il faut le lire.
M. Mishara: Lorsqu'il y a des directives claires, le médecin doit les respecter. Cependant, dans nombre de cas, il n'y a pas de testament et pas de directive; à ce moment-là tout ce qu'on sait c'est ce qui a été dit lorsque la famille avait abordé la question.
Les études que j'ai mentionnées font état du fait que dans certains cas les membres de la famille ont avoué qu'ils ne respectaient pas nécessairement les désirs de leur être cher et que même s'ils savaient ce que le patient aurait voulu ils ont pris une autre décision après avoir obtenu les conseils du médecin. Je ne sais pas quel pourcentage des Canadiens ont préparé un testament de vie. De plus, les gens changent d'idée, alors ce qu'ils pensaient qu'ils auraient voulu il y a dix ans lorsqu'ils ont préparé leurs testaments biologiques a peut être changé depuis.
Le sénateur Beaudoin: Cela évolue.
Le sénateur Corbin: Ma question s'adresse à M. Young, et peut-être M. Mishara voudra-t-il y répondre aussi, cas comme il est si sérieux, M. Mishara va bien peser ses mots. Il parle de résultats de sondage et de recherche.
Monsieur Young, vous avez dit que d'entrée de jeu les sondages ne sont pas fiables. Vous avez même précisé ce que vous entendiez par là mais j'ai oublié ce que vous avez dit.
Dr Young: C'est exact.
Le sénateur Corbin: Un des objectifs de notre comité est d'assurer que nous trouverons des définitions précises qui ne susciteront pas de controverse et que tout le monde pourra comprendre, qu'il s'agisse de juristes, de médecins ou de Monsieur Tout-le-Monde. Pourquoi semblez-vous n'accorder aucune confiance aux sondages?
Dr Young: Je crois que je devrais apporter une précision. Je ne nie pas ce que j'ai dit, et j'ai dit quand même quelque chose d'assez catégorique. Le type de sondage dont je parlais est celui où on demande: «appuyez-vous l'euthanasie?»
Le sénateur Corbin: Justement.
Dr Young: La question est vague et peut susciter toutes sortes de réponses parce que les gens voient les choses sous un angle différent.
Le sénateur Beaudoin: C'est vrai.
Dr Young: La majorité des gens répondrait oui si l'on parlait de quelqu'un qui souffre énormément, sans pour autant déterminer si la maladie est incurable ou pas. Si vous demandez: «appuyez-vous le recours à l'euthanasie pour les parents qui souffrent d'Alzeimer», il y a moins de gens qui répondraient oui. Cependant, la question dans le sondage n'est pas posée de cette façon-là et on ne fait pas la distinction. À mon avis, ceux qui répondent aux sondages disent simplement s'ils pensent que la personne qui souffre a le droit d'avoir recours à l'euthanasie. Cependant, cela pourrait inclure ceux qui souffrent d'Alzeimer, les déficients mentaux et ceux qui ont de graves problèmes médicaux, comme ceux qui souffrent d'une maladie incurable, même si le sida n'est pas incurable qu'il l'était. Il y a environ dix ans, des gens ont essayé de se suicider à Toronto et un médecin a été trouvé coupable en raison du rôle qu'il avait joué dans cette affaire. Il a donné des somnifères à deux patients le jour où ils ont appris qu'ils étaient séropositifs. Ces patients seraient inclus dans la réponse à la question «Appuyez-vous le recours à l'euthanasie?»
Le problème c'est qu'à mon avis la question n'est pas suffisamment précise. Je n'ai pas encore vue de sondage effectué auprès des Canadiens sur l'euthanasie qui comporte suffisamment de détails pour me convaincre que la bonne réponse a été donnée aux questions. C'est ce qui me préoccupe. J'espère que j'ai bien expliqué ma position.
Le sénateur Corbin: Peut-être que le chercheur aurait des commentaires à faire.
M. Mishara: Je suis tout à fait d'accord avec M. Young. Il y a deux types d'information qui peuvent ressortir de ces sondages. D'une part, les attitudes et les croyances, d'autre part les comportements et les pratiques. On peut demander d'une part: «Avez-vous fait quelque chose pour avancer le décès de votre mère?», ou, on interroge des médecins,: «Comment avez-vous eu de patients qui ont demandé que vous fassiez quelque chose pour mettre plus rapidement fin à leur vie? Combien de fois avez-vous fait quelque chose dans ce sens?» Ces données nous donnent une bonne indication de la fréquence de telles pratiques dans le pays.
Toutefois, pour le genre de choses dont parlait M. Young, telles que les attitudes: «Êtes-vous pour ceci et cela», vous constaterez que les gens comprennent ces mots différemment. Même si vous donnez les définitions et que vous obtenez des indications fiables de ce que croient les gens, cela ne se retrouve pas souvent dans leurs comportements. Un exemple est que la majorité des Canadiens croient que les gens qui souffrent d'affections dégénératives chroniques devraient avoir accès à l'euthanasie et voudraient dans telles circonstances pouvoir mettre fin à leur propre vie. En fait, les gens disent: «S'il m'arrivait d'avoir une affection dégénérative chronique, je préférerais mourir que de continuer à vivre». Toutefois, les études faites à ce sujet ont toujours démontré que les gens qui souffrent de tout un éventail d'affections dégénératives chroniques ne sont pas plus suicidaires ni désireux de mourir rapidement que le reste de la population. On a même constaté qu'ils le sont moins.
Ces attitudes doivent être interprétées avec beaucoup de prudence. Il y a cependant des sondages sur les comportements et les pratiques qui nous donnent des renseignements très précieux.
Le sénateur Corbin: Estimez-vous que les médias traitent ces sondages avec les précautions nécessaires dans la façon dont ils les rapportent à la population?
Dr Young: Au risque de choquer les médias, je dirais que les reportages sont souvent fautifs et que l'on veut nous faire croire que les Canadiens sont pour ceci ou contre cela. C'est pourquoi je veux toujours me montrer très prudent. Je suis d'accord avec le professeur pour l'autre type de questions. J'estime que ces sondages sont beaucoup plus fiables. Mais, en effet, ils sont mal interprétés.
La présidente: Merci beaucoup de votre exposé.
Je vais demander à tout le monde à l'exception des sénateurs et du personnel essentiel de quitter maintenant la salle. J'aimerais que nous siégions à huis clos quelques minutes.
Le comité poursuit ses travaux à huis clos.