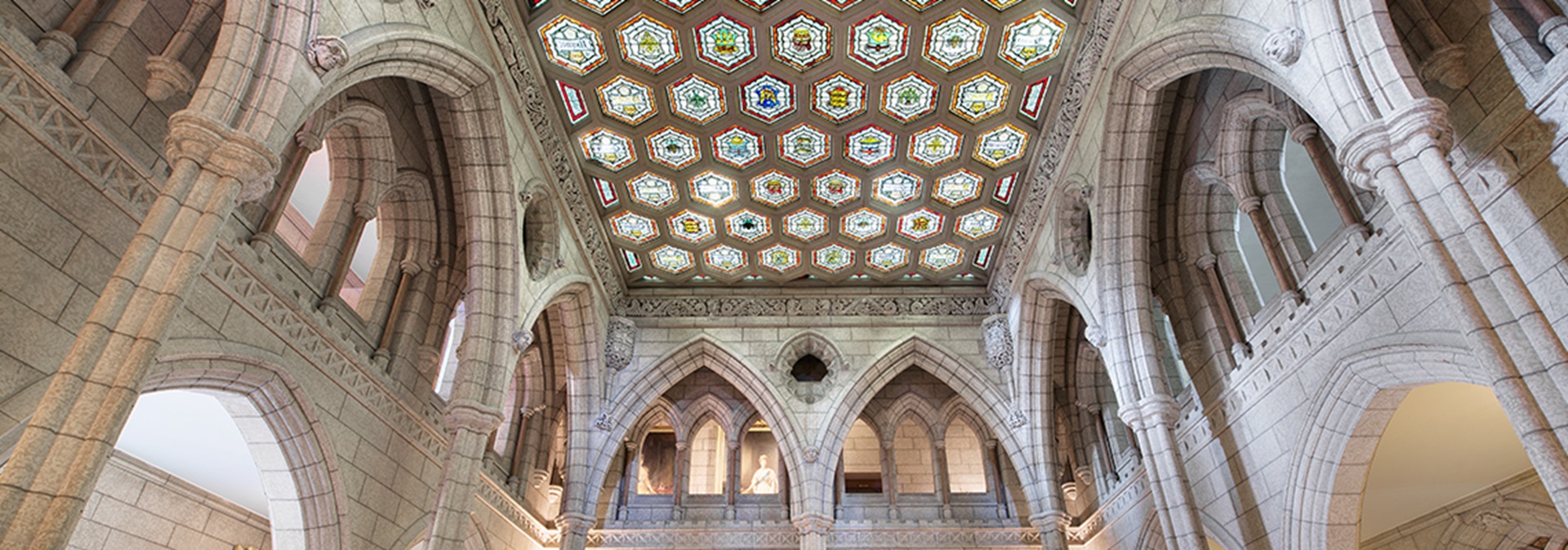Délibérations du sous-comité de
mise à jour de «De la vie et de la mort»
Fascicule 6 - Témoignages
OTTAWA, le lundi 20 mars 2000
Le sous-comité de mise à jour de «De la vie et de la mort» du comité sénatorial permanent des affaires sociales, des sciences et de la technologie, se réunit aujourd'hui à 14 heures pour l'étude des faits nouveaux survenus depuis le dépôt, en juin 1995, du rapport final du comité sénatorial spécial sur l'euthanasie et l'aide au suicide intitulé «De la vie et de la mort.»
Le sénateur Sharon Carstairs (présidente) occupe le fauteuil.
[Traduction]
La présidente: C'est aujourd'hui le sixième jour d'audience dans le cadre de notre mandat visant à mettre à jour les recommandations unanimes du rapport de 1995 du Comité sénatorial spécial sur l'euthanasie et l'aide au suicide intitulé «De la vie et de la mort.» Je rappelle aux honorables sénateurs et surtout aux témoins que notre comité ne vise pas à relancer le débat sur l'aide au suicide et l'euthanasie. Son étude porte exclusivement sur les questions au sujet desquelles le comité initial a formulé des recommandations unanimes. Je vous demanderais de ne pas l'oublier au cours de nos discussions.
Nous entendrons aujourd'hui trois groupes de témoins. Le premier groupe se compose de fonctionnaires du ministère de la Santé. Il y a Carole Bouchard, gestionnaire, Bureau des substances contrôlées, Programme des produits thérapeutiques, et le Dr Brian Gillespie, conseiller médical spécial, Bureau de l'évaluation des produits pharmaceutiques.
Mme Carole Bouchard, gestionnaire, Bureau des substances contrôlées, Programme des produits thérapeutiques, Santé Canada: Madame la présidente et mesdames et messieurs les membres du comité, j'aimerais tout d'abord vous remercier d'avoir invité le personnel du Programme des produits thérapeutiques à vous parler aujourd'hui. Je me rends compte que vous voulez nous poser des questions, mais avant que mon collègue, le Dr Brian Gillespie, et moi-même y répondions, j'aimerais vous dire un mot sur le processus d'examen des médicaments prévu dans la Loi sur les aliments et drogues et son règlement et sur le régime mis en place en vertu de la loi réglementant certaines drogues et autres substances et son règlement, pour assurer l'imputabilité de ceux qui manutentionnent des substances qui risquent de faire l'objet d'abus. Nous parlerons brièvement de la législation internationale et expliquerons comment les malades peuvent obtenir ces substances pour se soigner.
Le Programme des produits thérapeutiques de Santé Canada est l'organisme national qui réglemente, évalue et contrôle l'innocuité, l'efficacité et la qualité de tous les produits thérapeutiques vendus aux Canadiens. Par produits thérapeutiques, on entend les médicaments, les matériels médicaux, le sang, les tissus, les organes, les désinfectants et les produits assainissants. Par médicaments, on comprend tant ceux vendus sur ordonnance que ceux en vente libre et les produits biologiques en font partie.
Pour vendre un médicament au Canada, le fabricant doit démontrer qu'il est sûr, efficace et de qualité et fournir cette information au Programme des produits thérapeutiques sous la forme d'un dossier de présentation. Ce dossier peut comprendre des résultats de laboratoire, d'études sur l'animal et d'essais cliniques. Par exemple, dans le cas d'une nouvelle substance active, c'est-à-dire une substance qui n'a pas encore été vendue au Canada en tant que substance médicamenteuse, le fabricant doit réaliser une série d'épreuves scientifiques qui doivent être soigneusement consignées dans des registres et présentées au PPT pour examen. La première phase, la phase préclinique, qui comprend des travaux en laboratoire et des études sur l'animal, vise à déterminer l'innocuité et l'efficacité de la substance avant qu'elle ne soit administrée à des humains. La majeure partie des médicaments potentiels ne réussit jamais à dépasser cette phase.
La phase suivante comprend l'administration de la substance à des humains dans le cadre d'essais cliniques. Ces essais doivent être approuvés par un comité d'éthique et tous les participants aux essais sont informés de la nature et des buts de l'étude, des risques et bénéfices potentiels et de leur droit de se retirer de l'étude en tout temps. Une fois qu'il a été démontré que la substance était sans danger et efficace, le fabricant peut passer au stade final, c'est-à-dire demander l'autorisation de mise en marché au Canada.
Le fabricant doit également fournir des renseignements détaillés sur la méthode de fabrication de la substance et sur les contrôles qu'il utilisera pour s'assurer que la qualité du produit est maintenue.
Afin de renseigner les utilisateurs sur l'usage approprié de la substance, le fabricant doit également soumettre une monographie thérapeutique exposant en détail les symptômes et les effets secondaires associés à l'utilisation de la substance, ainsi que les doses et le mode d'administration recommandés. Ce document est soigneusement examiné par des scientifiques et des médecins du PPT.
Le processus d'examen des médicaments comporte un ensemble méthodique d'étapes appliquées par les scientifiques et les médecins travaillant dans les divers bureaux du PPT en vue d'évaluer tous les médicaments avant qu'on autorise leur mise sur le marché. Le PPT fait souvent appel à un vaste réseau de spécialistes scientifiques d'autres organismes de réglementation, du milieu universitaire et de firmes du secteur privé pour obtenir de l'aide dans l'examen des médicaments. L'objectif du processus d'examen est de permettre aux Canadiens et aux Canadiennes d'avoir accès aux plus récents produits de la technologie pharmaceutique, tout en respectant les normes les plus strictes et en veillant à ce que les médecins et les patients aient le plus d'informations possible sur l'innocuité et la qualité du produit.
Si, à la fin de l'examen, la substance est approuvée, le PPT émet un avis de conformité pour indiquer que la substance est officiellement approuvée au Canada, et délivre un numéro d'identification (le DIN), qui permet au fabricant de vendre la substance au Canada.
Aucun médicament n'est approuvé sans que le PPT soit parfaitement convaincu que les avantages de son utilisation surpassent ses risques et que le plus d'informations possible soient communiquées aux Canadiens pour leur indiquer comment réduire au minimum les risques que présente le produit.
Les examens effectués par le PPT sont assujettis à des objectifs de rendement compétitifs sur le plan international. Bien que la durée de l'examen dépende du produit à l'étude, en règle générale, la durée d'examen d'une substance unique est en moyenne de deux ans à partir du moment où le fabricant soumet son dossier de présentation jusqu'au moment où le PPT donne son approbation et délivre un avis de conformité. Tout au long du processus d'examen, la sécurité et le bien-être de la population canadienne demeurent le centre de nos préoccupations.
Le PPT s'est engagé à rendre le processus d'examen le plus efficient possible. Pour ce faire, il a lancé plusieurs initiatives visant à rationaliser le processus, notamment la capacité de recevoir et de traiter des dossiers de présentation sous forme électronique; l'application de normes techniques reconnues à l'échelon international; la poursuite des négociations avec les États-Unis, le Japon, l'Union européenne, la Suisse et l'Australie sur des accords de reconnaissance mutuelle qui aideront à accélérer l'examen des médicaments au Canada lorsque le dossier de présentation est étudié par l'un de ces autres pays; le partage de l'examen des dossiers de présentation avec d'autres pays.
Le PPT s'est doté d'un processus de traitement prioritaire qui permet d'accélérer l'examen des substances prometteuses destinées à soigner des maladies très débilitantes ou qui menacent le pronostic vital, comme la maladie de Parkinson et le sida, pour lesquels il existe présentement sur le marché peu de traitements efficaces.
Une fois qu'un nouveau médicament est sur le marché, les contrôles se poursuivent. Le fabricant doit communiquer toute nouvelle information qu'il obtient concernant les effets secondaires fâcheux, y compris les informations indiquant que le médicament ne produit pas l'effet souhaité. En outre, le PPT surveille les réactions indésirables, enquête sur les plaintes et les problèmes signalés, maintient un système de pharmacovigilance et fait en sorte que des correctifs soient apportés au besoin.
Les preuves qui doivent être fournies et l'examen qui est effectué à l'égard des substances destinées à combattre la douleur ou à produire un effet sédatif diffèrent très peu du processus décrit ci-dessus. Le PPT surveille les normes de preuve et les méthodes de démonstration de l'innocuité et de l'efficacité utilisées par les autres grands organismes de réglementation et celles mises de l'avant par les experts et les corporations professionnelles dans leurs domaines d'expertise respectifs. Ces normes sont incorporées aux examens effectués par le PPT. Un point important à se rappeler est le fait que les médicaments utilisés pour produire des effets analgésiques et sédatifs servent à traiter un large éventail d'états cliniques, allant de la douleur aiguë de courte durée (c'est-à-dire, la douleur post-traumatique ou post-chirurgicale), au contrôle de la douleur chronique chez les patients en phase terminale.
La décision concernant le ou les médicaments à utiliser et pour quel état pathologique relève de l'exercice de la médecine. La réglementation de l'exercice de la médecine est du ressort des provinces, qui exercent cette responsabilité par l'entremise de leurs collèges de médecins et de chirurgiens.
J'aimerais maintenant passer aux obligations internationales du Canada.
Le régime de réglementation du Canada pour les drogues contrôlées découle principalement de l'orientation fournie dans les trois conventions de l'ONU sur les drogues qui ont été ratifiées par le Canada. Ce régime canadien a été élaboré afin de maintenir les drogues dans un système légitime d'approvisionnement en médicaments de façon à répondre aux besoins médicaux et scientifiques légitimes des Canadiens et à veiller à la responsabilité des personnes qui manipulent ces drogues. Le régime utilisé au Canada est donc semblable à celui en place dans d'autres pays.
Toutefois, les régimes de certains pays ne répondent pas aux exigences des conventions et certains pays n'ont pas encore ratifié toutes les trois conventions internationales sur les drogues. L'Organisation des Nations Unies, par l'intermédiaire de l'Organe international de contrôle des stupéfiants, tente de convaincre tous les pays de ratifier les conventions et de se conformer à ses exigences puisque les problèmes liés aux drogues ne sont pas confinés à un pays, à une région du globe ou à un groupe de personnes.
L'Organisation des Nations Unies est d'avis que tous les pays ont un rôle à jouer dans la réduction, à l'extérieur des systèmes médicaux et scientifiques légitimes, de la disponibilité des drogues qui peuvent faire l'objet d'abus ou d'usage détourné. Pour atteindre cet objectif, tous les pays doivent donc satisfaire à des normes minimales en matière de contrôle et de responsabilité. Les trois conventions internationales contrôlent la fabrication, l'importation, l'exportation et la distribution des drogues, comme celles servant à atténuer la douleur, de façon à ce qu'elles soient disponibles pour répondre aux besoins médicaux et scientifiques légitimes.
Les trois conventions de l'ONU dressent la liste de la plupart des drogues servant à atténuer la douleur. Puisqu'il a ratifié ces conventions, le Canada doit se conformer à toutes les exigences qui y figurent. Santé Canada répond à ces exigences par l'application de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances et du règlement pertinent. Les drogues comme la morphine, la codéine et l'héroïne sont assujetties aux dispositions de la Convention unique sur les stupéfiants de l'Organisation des Nations Unies, ratifiée en 1961, et figurent à l'annexe 1 de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances du Canada et dans le Règlement sur les stupéfiants.
Visés par la Convention sur les substances psychotropes, adoptée en 1971, les benzodiazépines et les barbituriques figurent dans les annexes III et IV de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances. Les précurseurs qu'utilisent les laboratoires clandestins pour produire un grand nombre des drogues pouvant faire l'objet d'abus ou d'usage détourné sont visés par la Convention des Nations Unies contre le trafic illicite des stupéfiants et des substances psychotropes adoptée en 1988. Ces précurseurs figurent dans les annexes V et VI de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances. Le règlement canadien sur les précurseurs devrait être rédigé sous peu.
Ces conventions limitent l'utilisation des drogues inscrites aux annexes à des fins médicales et scientifiques. Bien que certaines drogues soient désignées comme n'ayant aucune application médicale, par exemple le LSD, d'autres peuvent être prescrites par un praticien autorisé pour traiter un trouble médical. L'importation et l'exportation de toutes les drogues inscrites aux annexes font l'objet d'un contrôle. De plus, les fabricants, les distributeurs, les importateurs et les exportateurs de ces drogues doivent détenir un permis.
Avant que des drogues soient ajoutées aux annexes des conventions internationales, l'Organisation mondiale de la santé fournit les conseils médicaux et scientifiques sur la pertinence d'un tel ajout. Bien qu'ils n'aient pas force exécutoire pour les pays votant pour ajouter ou enlever une drogue assujettie à un contrôle international ou pour en modifier le contrôle, ces conseils sont fournis à tous les pays et pris sérieusement en considération par les pays qui votent.
La Convention unique sur les stupéfiants demande que certaines drogues, par exemple la morphine, fassent l'objet d'un mécanisme d'«estimation». Par conséquent, chaque année, le PPT fournit à l'Organe international de contrôle des stupéfiants des estimations de la consommation et des stocks de ces drogues pour le Canada. On peut alors importer une quantité suffisante de chacune de ces drogues en fonction de ces estimations. Si ces estimations s'avèrent insuffisantes pour répondre à nos besoins médicaux et scientifiques légitimes, elles doivent être revues. Si une telle revue n'était pas effectuée, il y aurait une pénurie de la drogue visée au Canada puisque les autres pays doivent arrêter d'approvisionner le Canada lorsque nos quantités estimées ont été atteintes.
Quand la Loi réglementant certaines drogues et autres substances est entrée en vigueur en mai 1997, la Loi sur les stupéfiants ainsi que la Partie III et la Partie IV de la Loi sur les aliments et drogues ont été abrogées. La Loi réglementant certaines drogues et autres substances prévoit certains règlements, dont celui sur les stupéfiants, celui sur les drogues contrôlées et celui sur les drogues d'usage restreint, de même qu'une série proposée de règlements sur les médicaments à cible définie. Cette dernière série de règlements comprendra des médicaments comme les benzodiazépines. Les règlements prévus sont des règlements pour la commercialisation du chanvre, la désignation des analystes et l'exécution policière.
À l'heure actuelle, il n'y a aucune production de matières premières pour les drogues contrôlées au Canada. Le Canada importe tous ses besoins à cet égard. Après avoir reçu un permis d'importation du Programme des produits thérapeutiques, une société de produits pharmaceutiques autorisée importera les matières premières pour les médicaments ou, dans certains cas, le produit fini. Si elle a reçu un avis de conformité de Santé Canada, elle peut vendre le produit fini à des distributeurs autorisés, des pharmaciens, des hôpitaux, des médecins, des vétérinaires et des dentistes.
Santé Canada a pour mandat de veiller à ce que ces drogues contrôlées à l'échelle internationale soient restreintes à l'approvisionnement médical et scientifique légitime autorisé en vertu de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances et ses règlements. Ces règlements permettent aux inspecteurs autorisés en vertu de la loi d'effectuer des vérifications auprès des distributeurs autorisés, des pharmacies, des hôpitaux, des médecins, des dentistes et des vétérinaires. Ces vérifications sont entreprises afin de s'assurer que les intéressés rendent compte des médicaments et de déceler les détournements et d'enquêter sur ceux-ci. Le PPT n'a pas pour mandat de réglementer la profession de la pharmacie, de la médecine, de l'art dentaire ou de la médecine vétérinaire. Il s'agit là d'une responsabilité provinciale. Cependant, le PPT communique avec les organismes de réglementation professionnelles des provinces lorsqu'un professionnel de la santé est en cause dans le détournement, et avec le service de police lorsqu'il y a eu une activité criminelle.
Comme nous l'avons signalé, au Canada, il y a trois façons habituelles dont le médecin et le patient peuvent avoir accès à des substances pour lesquelles des allégations de valeur médicinale ont été faites en vertu de la Loi sur les aliments et drogues et son règlement, à savoir premièrement l'approbation d'une commercialisation générale, deuxièmement les essais cliniques et, troisièmement, le Programme d'accès spécial ou PAS; ces processus sont tous gérés par le Programme des produits thérapeutiques de Santé Canada. Dans ces trois cas, il se peut que les substances qui sont réglementées en vertu de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances aient à satisfaire des exigences additionnelles comme des exigences en matière d'importation et de distribution.
Une fois l'avis de conformité délivré à la société de produits pharmaceutiques pour un produit donné, la société peut ensuite l'offrir sur le marché canadien. Les produits renfermant un stupéfiant ou une drogue contrôlée peuvent être prescrits par des médecins, des vétérinaires et des dentistes autorisés par un organisme de réglementation provincial. Normalement le patient ferait remplir l'ordonnance à une pharmacie locale. Dans un hôpital, le médecin prescrit un médicament et c'est habituellement la pharmacie de l'hôpital qui le fournit aux malades hospitalisés et aux malades en consultation externe.
Parfois, un médecin constatera en lisant la documentation scientifique qu'un certain médicament est offert dans un autre pays et, en s'inspirant de l'information fournie, estimera qu'un patient pourrait probablement en profiter s'il avait accès au médicament, et ce, en raison de l'échec ou du caractère inapproprié des thérapies conventionnelles. Puisqu'aucun AC n'a été délivré, les pharmacies ne l'auront pas en stock, et, lorsque le médicament est inscrit à l'Annexe de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, ni le médecin, ni le patient ne pourra légalement l'importer. Le médecin peut toutefois communiquer avec le Programme d'accès spécial du Programme des produits thérapeutiques. En pareilles circonstances, le PAS et le Bureau des substances contrôlées du PPT interviendront. Le personnel passera en revue la demande et le Bureau des substances contrôlées sera tenu de prendre des dispositions relativement à des éléments comme l'importation.
En guise de conclusion, le PPT a le mandat bien précis de veiller à ce que les produits thérapeutiques au Canada soient sûrs, efficaces et de haute qualité. Qui plus est, il gère un régime visant à s'assurer que les médicaments contrôlés à l'échelle internationale sont disponibles à des fins médicales et scientifiques légitimes, tout en réduisant au minimum le risque de détournement de ces médicaments vers le marché illicite.
Nous tenons une fois de plus à vous remercier de nous avoir donné l'occasion de nous présenter devant votre comité. Le Dr Brian Gillespie et moi serons heureux de répondre à vos questions.
La présidente: Merci. Avant de céder la parole aux autres sénateurs, j'aimerais vous poser une ou deux questions de nature générale.
J'ai cru comprendre que votre ministère avait lancé deux grandes études. Je ne sais pas comment vous les identifieriez dans le cadre de votre système, mais je sais que l'une d'entre elles porte sur l'usage de l'héroïne en milieu hospitalier, et l'autre sur l'usage de la marijuana, en milieu hospitalier et à l'extérieur, si j'ai bien compris, du milieu hospitalier. Pourriez-vous nous en dire un peu plus long sur ces deux études.
Mme Bouchard: Si vous le permettez, j'aimerais parler d'abord des études sur la marijuana. Comme vous le savez, un plan de recherche a été déposé par notre ministre de la Santé en juin dernier; ce plan inclut divers éléments et stratégies dans le domaine de la recherche sur l'usage de la marijuana pour des fins médicinales. Les trois éléments de ce plan sont: un projet de recherche avec un groupe de Toronto, le Community Research Initiatives, et le Réseau canadien d'essais sur le VIH. Ces deux groupes coordonneront un projet de recherche sur le sida, ou sur les patients atteints du VIH, afin d'étudier l'efficacité, à des fins médicinales, de la marijuana pour le traitement des nausées et de la perte d'appétit. Le projet n'a pas encore été lancé; les patients n'ont pas encore été recrutés. Cependant, ces deux organisations finalisent actuellement leur protocole de recherche qui, comme je l'ai mentionné dans mon exposé, nécessitera une approbation réglementaire et une approbation déontologique du Réseau canadien d'essais sur le VIH. Nous croyons que les patients commenceront à participer à des essais cliniques en l'an 2000; on progresse donc.
L'autre élément du plan de recherche est mis en oeuvre par le Conseil de recherches médicales. Un appel a été lancé à tous les chercheurs du pays pour les inviter à soumettre des propositions visant des activités ou des projets de recherche à l'égard de l'usage de la marijuana. La date limite pour la présentation de projets au Conseil de recherches médicales était le 1er mars, et nous avons appris que certains chercheurs avaient soumis une proposition de projets de recherche. Le Conseil de recherches médicales procède toujours à l'examen de ces demandes. On les étudie d'un point de vue scientifique. Nous prévoyons que grâce à cette activité du Conseil de recherches médicales, un projet intéressant de recherche sur l'usage de la marijuana pour des fins médicinales devrait être lancé en l'an 2000.
Il s'agit là des deux principaux éléments du plan de recherche sur l'usage de la marijuana pour des fins médicinales. Vous avez probablement également appris qu'en vertu de l'article 56 de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, certaines exemptions ont été accordées afin d'autoriser des patients à utiliser la marijuana à des fins médicinales. Ces exemptions ont été accordées à la suite de demandes présentées par des patients dont les médecins appuyaient l'usage de cette substance dans des circonstances particulières. Il s'agit là des trois aspects du plan de recherche qui se déroule actuellement.
Pour ce qui est de l'héroïne, le PPT nous a appris que certains chercheurs seraient intéressés à lancer des essais cliniques pour l'usage de cette substance à des fins médicinales. À ma connaissance, aucun projet n'a encore été lancé dans ce domaine, parce que nous aurions été mis au courant de la distribution d'héroïne; encore une fois, on discute actuellement au pays de ce genre de recherche.
La présidente: Les renseignements que j'avais obtenus ne sont donc pas exacts, parce qu'on m'avait dit que certains essais cliniques se déroulaient actuellement dans certains hôpitaux à l'égard de l'usage de l'héroïne par opposition à la morphine, ou de l'héroïne avec d'autres drogues.
Mme Bouchard: Vous parlez peut-être de l'usage de l'héroïne pour le traitement de la douleur. L'héroïne est disponible au Canada. Elle a été de nouveau introduite sur le marché canadien en 1985, et les médecins peuvent actuellement prescrire cette substance. Les règlements précisent que cette substance peut être utilisée pour le traitement de la douleur, mais elle doit être prescrite dans le contexte hospitalier, pour les patients hospitalisés ou pour les patients en clinique externe.
Vous avez tout à fait raison pour ce qui est de la disponibilité de l'héroïne au Canada pour le soulagement de la douleur. Je faisais allusion à d'autres chercheurs ou cliniciens au Canada qui souhaitent mener des études sur l'utilisation qui est faite de l'héroïne à des fins autres que celle du soulagement de la douleur.
La présidente: Ma question portait expressément sur le soulagement de la douleur.
Docteur Gillespie, l'une des questions sur laquelle le comité s'est penché et sur laquelle s'est aussi penché le comité précédent, c'est celle du dosage des opiacés. Nous nous sommes demandé si à un certain point on ne tue pas le patient en lui injectant de la morphine ou de l'héroïne. Les médecins qui pratiquent la médecine palliative nous ont dit que ce n'était pas le cas. Le corps s'adapte apparemment à la dose de médicaments qu'on lui administre et il est peu probable que le recours à ces médicaments entraîne la mort du patient. Quel est votre avis là-dessus? Savez-vous si des essais ont été menés dans ce domaine?
Le docteur Brian Gillespie, conseiller médical principal, Bureau de l'évaluation des produits pharmaceutiques, Santé Canada: Je ne connais pas d'essais qui ont été menés sur l'utilisation de ces drogues. Nous étudions dans quelle mesure la morphine permet d'atténuer la douleur. Son utilisation comporte certains risques. Les patients souffrant de maladies cardio-vasculaires ou de maladies respiratoires graves sont plus à risque. Les études que j'ai lues semblent indiquer que l'organisme tolère assez rapidement ces drogues et qu'elles présentent moins de risque pour la patient que ce qu'on croyait autrefois. Je ne peux cependant que me reporter aux études que j'ai lues.
La présidente: Je vous remercie.
[Français]
Le sénateur Beaudoin: Le Canada exerce un contrôle sur l'importation et l'exportation des drogues. Je suppose qu'il y a très peu de variantes quant à ce contrôle d'un pays à l'autre. En quoi consistent ces différences si elles existent entre notre pays et les autres qui nous entourent, les États-Unis ou la France, par exemple? Sont-elles dues au fait que nous ayons une législation ou un code pénal différents, entre autres? Dans quelles mesures nos lois ou nos codes peuvent-ils influencer l'importation ou l'exportation des drogues au Canada, toujours dans le contexte des soins palliatifs que nous étudions?
Mme Bouchard: Le Canada a accédé aux conventions internationales des Nations unies, comme la majorité des autres pays. Tous ces pays, même les plus éloignés tel que l'Australie, suivent les mêmes règles parce que les conventions s'appliquent toutes de la même façon en matière d'importation et d'exportation des drogues. L'Organe de contrôle international pour les stupéfiants est l'organisme chargé de déterminer ces règles.
Pour les produits souvent utilisés dans le traitement de la douleur, telle la morphine ou d'autres substances puissantes, ces pays doivent aussi respecter le même régime, lequel détermine les quantités de consommation annuelle respectives pour chacun des pays régis par ces conventions. Il revient à chaque pays d'établir ses besoins pour une période d'un an, afin de s'assurer qu'il ait suffisament de produits importés nécessaires aux besoins de sa population.
Il est certain que lorsque nous touchons à d'autres secteurs autres que l'importation et l'exportation, cela concerne nos lois nationales qui, d'un pays à l'autre, peuvent varier sur certains points, mais pas vraiment en ce qui a trait aux conventions internationales.
Le sénateur Beaudoin: Y a-t-il des variantes importantes d'un pays à l'autre quant au soulagement de la douleur?
Mme Bouchard: Votre question vise-t-elle la prescription, la distribution ou les autorisations?
Le sénateur Beaudoin: Sur le plan de la disponibilité, est-ce plus facile chez nous qu'ailleurs ou équivalent? Fait-on appel aux mêmes remèdes pour soulager la douleur?
Mme Bouchard: Sans avoir fait d'analyses approfondies, je dirais que c'est comparable. Les pays importent, de fournisseurs attitrés dans le monde, les produits de base nécessaires à la fabrication de produits pour le traitement de la douleur. L'opium, ingrédient de base à la fabrication de la plupart de ces produits, provient de pays qui détiennent l'exclusivité de sa production.
Chaque pays doit bien évaluer ses besoins afin de s'assurer de répondre aux exigences de sa population.
Le sénateur Beaudoin: Y a-t-il un contrôle international?
Mme Bouchard: Oui. Si un pays s'aperçoit qu'il n'a pas fait une évaluation adéquate de ses besoins, il est important de corriger rapidement cette évaluation pour ne pas empêcher l'importation. Au Canada, on n'a pas eu d'expériences de manque d'approvisionnement. Les besoins ont été adéquatement définis.
Le sénateur Corbin: À la page 2 de votre présentation, au premier paragraphe, vous parlez d'administration de la substance à des humains dans le cadre d'essais cliniques. Vous dites que ces essais doivent être approuvés par un comité d'éthique et que tous les participants aux essais sont informés de la nature et des buts de l'étude, des risques et des bénéfices potentiels et de leur droit de se retirer de l'étude en tout temps. Pourquoi retrouvons-nous cette clause donnant le droit de se retirer de l'étude en tout temps? Y a-t-il des problèmes sur ce plan? Y a-t-il eu des cas où des personnes se sont retirées de ces essais cliniques et pour quelles raisons?
[Traduction]
Dr Gillespie: J'ignore s'il est déjà arrivé que des patients décident de ne plus participer à des essais cliniques.
Comme pour tout traitement médical, un patient peut refuser à tout moment qu'on lui administre des médicaments. Peut-être ces personnes ont-elles eu une réaction au médicament ou n'ont plus voulu participer aux essais cliniques pour d'autres raisons. Les essais cliniques portent habituellement sur des médicaments expérimentaux et les patients disposent de très peu d'information sur l'efficacité et l'innocuité de ces médicaments. Ils peuvent décider pour cette raison de cesser de participer aux essais.
[Français]
Le sénateur Corbin: Quand vous parlez de participants, vous faites référence essentiellement aux patients, n'est-ce-pas? Ce ne sont pas des membres de comités d'éthique ou d'autres membres d'un quelconque corps professionnel? Par participant, voulez-vous dire uniquement les patients qui sont les sujets de l'essai clinique? Le texte n'est pas très clair, en fait.
[Traduction]
Dr Gillespie: C'est au patient ou aux participants de décider s'ils souhaitent cesser de participer à des essais cliniques. Les comités déontologiques sont des comités ou des conseils qui sont mis sur pied par les hôpitaux et les autres établissements de santé pour revoir le protocole sur lequel repose l'essai afin de veiller à ce que les droits des patients soient protégés et que toutes les mesures de sécurité connues soient prises. Ils exercent souvent une certaine surveillance sur l'essai et communiquent aux patients l'information pertinente au sujet des risques inhabituels que présente l'essai ou des nouveaux risques qui ont été cernés et ils peuvent aussi parfois mettre fin à l'essai si les risques cernés sont trop grands.
[Français]
Le sénateur Corbin: Est-ce que le code d'éthique est le même partout au Canada ou y a-t-il un code spécifique auquel doivent se conformer ces essais cliniques? Est-ce un code défini par le ministère ou un code professionnel général?
[Traduction]
Dr Gillespie: Je ne suis pas un spécialiste de cette question, mais il existe certes au Canada des codes d'éthique portant sur la pratique de la médecine. Il existe aussi des codes internationaux comme la Convention d'Helsinki qui visent à protéger les droits des patients.
Le ministère de la Santé n'a pas adopté de codes en particulier. Nous examinons cependant les essais cliniques avant de les approuver pour voir si la sécurité des patients est assurée et s'ils ont été adéquatement informés des risques et des avantages que présente le médicament qui leur sera administré.
[Français]
Le sénateur Corbin: Madame Bouchard, au chapitre de la fabrication, à la page 6 de votre mémoire, vous avez dit qu'il n'y avait aucune production de matières premières pour les drogues contrôlées au Canada. Comment cela se fait-il et qu'entendez-vous par matières premières?
Mme Bouchard: L'opium, ingrédient de base à la fabrication de la morphine, par exemple, est produit exclusivement par certains pays. Par conséquent, les pays importeront ce produit de base de ces pays fabricants pour confectionner leurs propres remèdes. Le Canada et d'autres pays comme la France se procurent leurs produits de base à l'extérieur de leur pays.
Le sénateur Corbin: Cela ne veut pas nécessairement dire que le Canada est déficient sur le plan de la production des produits de base?
Mme Bouchard: Voulez-vous dire que nous manquons de produits de base?
Le sénateur Corbin: C'est-à-dire que nous pourrions en fabriquer au lieu d'en importer.
[Traduction]
La présidente: L'une de nos recommandations sur l'atténuation de la douleur et la sédation portait sur la question de la sédation totale. On nous a donné deux exemples de sédation totale. Le Dr Keon a fait allusion à la sédation totale du patient qui vient de subir une intervention cardiaque très compliquée dans le but de faire en sorte que le patient soit complètement immobile pendant un certain temps. On nous a aussi dit qu'on a parfois recours à la sédation totale pour les mourants quand c'est la seule façon d'atténuer leur douleur. Le patient se retrouve alors dans un état comateux.
L'une des recommandations formulées proposait que le gouvernement fédéral, en collaboration avec les provinces et les territoires, entreprenne une étude pour déterminer la fréquence à laquelle la sédation complète est pratiquée au Canada et les conditions dans lesquelles elle s'effectue. Savez-vous si des études de ce genre ont été entreprises?
Mme Bouchard: Non.
La présidente: Je tiens à vous remercier d'être venue ici aujourd'hui. Vous nous avez été des plus utiles en nous fournissant l'information dont nous avons besoin.
Chers collègues, notre prochain témoin cet après-midi est M. Hugh Scher, président du Comité des droits de la personne du Conseil des Canadiens avec déficiences.
Nous vous souhaitons la bienvenue, monsieur Scher. Je vous demanderais de prendre place à la table et de nous présenter votre exposé.
M. Hugh Scher, président, Comité des droits de la personne, Conseil des Canadiens avec déficiences: Madame la présidente, je suis très heureux d'être ici aujourd'hui au nom du Conseil des Canadiens avec déficiences. Je préside le Comité des droits de la personne depuis les cinq dernières années.
Le Conseil est un regroupement d'organisations de personnes handicapées. Il compte des membres de groupes d'un peu partout au pays. Il s'agit d'une organisation qui représente des personnes ayant différents types de déficiences, y compris des troubles du développement et des déficiences physiques et mentales. Le Conseil parmi ses membres un certain nombre d'organisations provinciales et territoriales ainsi que des organisations nationales représentant des personnes ayant une déficience en particulier. Nous représentons environ 250 000 personnes handicapées de tout le pays.
En tant que président du Comité des droits de la personne, je vous apporte mon expérience tant à titre d'avocat constitutionnel que de personne qui s'occupe de ces questions depuis 10 ans. Le premier sujet dont j'aimerais vous parler, c'est le contexte entourant la déficience dans lequel moi-même et d'autres personnes handicapées vivons aujourd'hui. L'argument que j'essaie de faire valoir c'est que sans comprendre pleinement ce contexte, il est difficile d'avoir une discussion pleine et franche des questions dont vous voulez parler, qui sont très importantes. Bien que les personnes avec déficiences aient réalisé de nombreux progrès au niveau des rapports sociaux, il n'en reste pas moins qu'elles continuent dans une grande mesure à être exclues de la société canadienne, comme en témoigne notre taux de chômage de 60 à 70 p. 100.
Dans une grande mesure, cette exclusion de la vie sociale ordinaire a marginalisé les personnes avec déficiences au sein de la société canadienne. Par conséquent, cela a entraîné une perception négative de ces personnes qui découle d'une tradition d'exclusion et de marginalisation, sans compter l'époque où les personnes avec déficiences étaient placées en établissement et où le placement en établissement était la norme de la politique sociale dans ce pays.
Ce contexte a eu de terribles répercussions sur la vie des personnes avec déficiences, surtout en ce qui concerne l'accès aux soins de santé dans ce pays et en ce qui concerne les décisions prises concernant le traitement et le non-traitement des personnes avec déficiences. Je vais vous en citer quelques exemples.
Terry est un jeune Albertain de 18 ans qui a le syndrome de Down et qui avait besoin d'une transplantation de poumon. Comme il avait le syndrome de Down, le conseil d'administration de l'hôpital à l'époque a appliqué une politique voulant que, en raison de son handicap, il n'était pas disposé à lui accorder une transplantation de poumon. En raison des vives préoccupations exprimées par Terry, sa famille et d'autres personnes, l'hôpital a fini par changer sa politique et lui a accordé la procédure médicale dont il avait besoin. En Alberta, la réaction dans les émissions de la ligne ouverte et dans l'ensemble de la province en général était la suivante: «Pourquoi gaspillons-nous l'argent du contribuable et les ressources de la santé à ce genre de choses?» On considérait qu'il ne valait pas la peine d'utiliser les rares ressources de notre système de santé pour permettre à une personne ayant le syndrome de Down d'avoir accès aux choses essentielles de la vie.
Je représente un client en Ontario qui a la sclérose en plaques. Il a 35 ans, il est cloué au lit et il ne peut pas parler. Il communique uniquement en clignant des yeux. Il a besoin d'un service d'oxygène 24 heures par jour. Selon une politique du gouvernement ontarien, le maximum qu'il paiera pour le service d'oxygène est 540 $ par mois. Les besoins en oxygène de mon client s'élèvent à 2 500 $ par mois. Malgré le fait qu'il vit dans la collectivité et que son épouse est celle qui s'occupe principalement de lui, et malgré sa volonté clairement exprimée de vivre, le gouvernement et la société qui lui assure le service d'oxygène sont en train de lui dire qu'il doit maintenant payer pour ce service et que s'il ne le peut pas, il devrait peut-être aller à l'hôpital. Cela coûtera non seulement aux contribuables des milliers de dollars de plus, mais risque fort probablement de tuer mon client.
Voilà le contexte dans lequel vivent de nombreuses personnes avec déficiences aujourd'hui lorsqu'elles tâchent d'avoir accès aux services de santé qui sont nécessaires à la vie. Très souvent, lorsqu'elles demandent ces services, on les repousse ou on met en doute la valeur de leur vie.
C'est la raison pour laquelle, lorsque des personnes avec déficiences vont se faire enlever les amygdales, l'une des premières questions qu'on leur pose c'est si elles veulent qu'on inscrive une ordonnance de non-réanimation sur leur dossier. D'après ce que je crois comprendre, ce n'est pas une pratique courante pour la plupart des patients qui vont se faire enlever les amygdales.
Malgré certains des progrès que nous avons réalisés, et malgré certaines décisions de la Cour suprême du Canada, de nombreuses personnes avec déficiences n'ont toujours pas accès au soutien nécessaire à la vie et à la fourniture de soins appropriés. Dans l'affaire Eldrige, qui a poursuivi le ministère de la Santé du gouvernement de la Colombie-Britannique, la Cour suprême a déclaré que les personnes avec déficiences ont droit à l'accès aux services de soins de santé avec l'aide d'interprétation gestuelle, par exemple. Il s'agissait d'une femme sourde qui allait avoir un bébé. La Cour suprême du Canada a déclaré que cela fait partie intégrante de la prestation de services de soins de santé en Colombie-Britannique.
C'est donc le contexte dans lequel se déroulent les discussions d'aujourd'hui. C'est un contexte d'acceptation ou d'indifférence de la part du public, très souvent face à de mauvais traitements graves réservés aux personnes avec déficiences ou à la suppression de la vie de personnes avec déficiences. Je parlerai de l'affaire Latimer dans un instant.
Notre droit criminel vise à protéger la société, et à la protéger aussi contre le meurtre. Notre droit criminel et notre processus de détermination de la peine au criminel visent à assurer la stabilité, la certitude, la sécurité publique et à faire en sorte que tous les Canadiens jouissent d'un traitement égal et d'une protection égale de la loi. Les sanctions, la dissuasion, tant générale que particulière, le châtiment, l'exemplarité de la peine et la réadaptation sont autant d'aspects de notre système pénal de détermination de la peine, et je ne les aborderai pas de façon approfondie, mais il s'agit des principes pertinents appliqués normalement.
En ce qui concerne le crime de meurtre dans ce pays, nous avons une tradition de peines minimales obligatoires. Cette tradition découle d'une tradition encore plus reculée voulant que le meurtre dans ce pays entraînait la peine de mort. Par conséquent, si vous tuez quelqu'un, on vous enlèvera la vie. À une certaine époque de notre histoire, notre Parlement a consenti à un compromis en éliminant la peine de mort comme moyen de rendre la justice et en la remplaçant par un processus considéré plus civilisé, à savoir les peines minimales obligatoires. Dans le cas de meurtre au premier degré, la peine obligatoire était l'emprisonnement à vie sans possibilité de libération conditionnelle pendant 25 ans; dans le cas de meurtre au deuxième degré, la peine obligatoire était l'emprisonnement à vie sans possibilité de libération conditionnelle pendant 10 ans. C'est le système qui existe toujours aujourd'hui.
Notre organisation a fait certaines recherches sur les méthodes de mise en accusation et les peines infligées dans ce pays. Permettez-moi de parler de façon générale des deux principes fondamentaux appliqués pour déterminer si la preuve est suffisante pour établir la probabilité d'une condamnation si tous les faits de l'affaire sont établis et que l'affaire est portée devant les tribunaux. Le deuxième facteur qui est examiné consiste à déterminer s'il est dans l'intérêt public d'intenter des poursuites dans le cas d'une infraction, et c'est sur cet aspect que j'aimerais m'attarder un peu plus car j'estime qu'il soulève des questions pertinentes dans le cadre de vos délibérations aujourd'hui et par la suite.
Voici certains des facteurs d'intérêt public appliqués partout au pays: le caractère grave de l'allégation; la probabilité qu'une condamnation entraînera une peine importante; le tort considérable causé à la victime du crime; et l'utilisation ou la menace d'utilisation d'une arme. Le caractère «vulnérable» de la victime est un facteur qui est examiné pour déterminer l'intérêt public dans le cadre de poursuites intentées relativement à un crime dans ce pays. Parfois on examine si l'accusé avait un casier judiciaire et aussi si l'accusé était en situation de confiance ou d'autorité vis-à-vis de sa victime. Parmi les autres facteurs dont on tient compte, citons le degré de culpabilité de l'accusé comparativement aux autres qui ont peut-être commis le crime avec lui; la preuve qu'il y a eu préméditation; et le fait que l'infraction a été motivée par la race, la couleur, la religion, le sexe, l'âge, l'orientation sexuelle, les convictions politiques ou la déficience de la victime.
Notre administration publique a reconnu que la déficience est en soi un facteur dont on doit tenir compte pour déterminer s'il est dans l'intérêt public d'intenter des poursuites au criminel dans ce pays. Cependant, de nombreuses provinces ont expressément indiqué que les procureurs ne devraient pas tenir compte d'un certain nombre de facteurs et le leur ont même interdit. Il s'agit entre autres de la race, de la religion, de l'orientation sexuelle et des convictions politiques de l'accusé. Très souvent dans de nombreuses provinces, la Couronne ne doit pas tenir compte de ses propres opinions concernant l'accusé ou la victime; d'où la notion selon laquelle la justice est aveugle.
Il est important d'examiner les conséquences qu'entraîne le fait de distinguer les meurtres motivés par la compassion d'autres meurtres. Il est particulièrement important d'examiner les risques d'appliquer des peines en fonction de la situation ou des circonstances d'une victime, surtout lorsque notre opinion de cette victime peut être influencée par une mauvaise perception et une mauvaise compréhension de la qualité de vie de la victime, attitudes d'ailleurs répandues dans le contexte que je vous ai décrit aujourd'hui en ce qui concerne les personnes avec déficiences et la façon dont on évalue la qualité de vie de ces mêmes personnes au Canada.
Votre comité a recommandé que l'on établisse une troisième catégorie de meurtre en ce qui concerne les meurtres motivés par la compassion ou la pitié. Ma réaction, et la réaction de mon organisation, c'est qu'il est extrêmement dangereux de commencer à faire une distinction entre ces types de crimes, parce que nous sommes sûrs de nous laisser influencer par le contexte dans lequel nous vivons et par les préjugés que nous avons. À notre avis, il est inévitable que ces préjugés et ces perceptions négatives influenceront nos décisions d'une manière telle qu'elle risque de mettre en danger les personnes avec déficiences et d'autres Canadiens vulnérables.
Si votre comité envisage de modifier ou d'adapter les peines minimales obligatoires dans ce pays, moi-même ainsi que notre organisation vous déconseillons très fortement de créer une catégorie distincte de meurtre qui équivaudrait, en fait, à une catégorie de meurtre de personnes vulnérables.
Lorsque nous examinons les cas de meurtres motivés par la compassion, dans pratiquement chaque cas, les victimes sont des personnes vulnérables -- des personnes malades, âgées, handicapées. Si nous envisageons d'établir une nouvelle catégorie de meurtre, qui équivaut ni plus ni moins au meurtre de personnes vulnérables, alors je pense que nous devons en examiner très soigneusement les répercussions, particulièrement pour les personnes avec déficiences, pour les raisons que j'ai énoncées, mais aussi pour chacun d'entre nous, car chacun d'entre nous peut devenir handicapé à tout moment. Nous vieillissons tous et nous finirons tous par faire l'objet des types de préjugés et de perceptions dont j'ai discuté ici aujourd'hui. Notre Conseil recommande que les dispositions relatives au meurtre en vigueur aujourd'hui restent telles quelles, parce que nous les considérons comme notre dernier recours pour protéger les personnes avec déficiences des mauvais traitements graves et de la violence.
Je trouve curieux qu'il y a deux ans je suis venu témoigner devant un comité sénatorial, et devant le comité parlementaire de la justice, à propos d'une nouvelle infraction qui était ajoutée au Code criminel et qui faisait du contact sexuel avec des personnes avec déficiences un crime particulier. Je me rappelle que notre organisation ainsi que le comité étaient préoccupés par le nombre disproportionné de personnes avec déficiences qui étaient victimes de ce type de crime. Et nous avions reconnu que la déficience est un facteur aggravant dont il faut tenir compte lorsque l'on accuse et on condamne une personne reconnue coupable de ce genre de crime.
Lorsque nous parlons de meurtre, pourquoi ne considérons-nous pas aussi la déficience comme un facteur aggravant? Dans la présente discussion, nous sommes en train d'envisager la déficience comme un facteur atténuant pour justifier les gestes d'un meurtrier, et je crains que cela ait pour résultat, délibéré ou autrement, de créer une troisième catégorie de meurtre de personnes vulnérables.
Si le comité envisage de modifier les peines minimales obligatoires, je recommanderais qu'il ne crée pas une catégorie distincte de meurtre qui équivaudrait au meurtre de personnes vulnérables, mais qu'il applique la loi également à tous les Canadiens et qu'il élimine les peines minimales obligatoires. Ainsi, on appliquerait à l'ensemble des meurtriers les principes appropriés de détermination de la peine sans distinction fondée sur la nature de leurs crimes, ni surtout à mon avis, les circonstances de leurs victimes.
Ce n'est pas ce que je recommande. Notre conseil demeure convaincu que les dispositions relatives au meurtre constituent une garantie pour protéger les personnes avec déficiences contre les sévices graves et la mort. Si le comité envisage cette solution, qu'il le fasse de façon à ce que cela s'applique également à tous les Canadiens et pas seulement aux personnes avec déficiences et aux autres personnes vulnérables, ce qui créerait une catégorie de meurtre justifiant les actes des meurtriers qui tuent des personnes avec déficiences en éliminant l'important effet punitif et dissuasif des dispositions du Code criminel concernant la détermination de la peine.
Ne refusez pas la même application de la loi aux personnes avec déficiences. Cela risquerait de violer gravement la garantie d'égalité que nous confère l'article 15 de la Charte des droits et des libertés.
Nos inquiétudes à cet égard viennent en grande partie d'une affaire que tout le monde connaît bien ici, le meurtre de Tracy Latimer. Notre conseil est intervenu dans cette affaire devant la Cour d'appel de la Saskatchewan et la Cour suprême du Canada. Nos membres estiment que ce cas montre bien ce qui se passe lorsqu'on cherche à minimiser l'acte d'un meurtrier qui a décidé, de façon préméditée et délibérée, d'amener sa fille dans son camion et de l'asphyxier, de mentir à la police et de faire en sorte que sa femme trouve sa petite fille morte dans son lit à la maison en laissant croire qu'elle était morte pendant son sommeil.
Si la loi n'est pas appliquée, toutes les personnes avec déficiences sont mises en danger dans ce qui n'est pas seulement un débat purement hypothétique ou théorique.
Il y a quelques années, nous avons fait valoir que nous nous engagerions sur une pente glissante si Robert Latimer était libéré. Sans vouloir influencer la Cour suprême, le fait est que son jugement et la réaction du public vis-à-vis de Robert Latimer ont déjà entraîné une série d'actes qui se sont traduits par le meurtre d'enfants un peu partout au Canada, que ce soit celui d'Antoine Blais, au Québec, un enfant autiste que sa mère a noyé dans sa baignoire à l'âge de 12 ans, de Katie Lynn Baker, que sa mère a laissé mourir de faim à l'âge de quatre ans, en Colombie-Britannique, de Ryan Wilkinson, qui, comme Tracy, a été asphyxié par sa mère lors d'un meurtre suivi d'un suicide à Hamilton, en Ontario ou les nombreux autres cas que nous connaissons ou ne connaissons pas encore ou ceux qui n'ont pas encore été assassinés, mais qui le seront, si notre société et notre Parlement ne prennent pas des mesures pour protéger les plus vulnérables d'entre nous et leur accorder la même protection de la loi, y compris du droit pénal.
Le sénateur Beaudoin: En fait, monsieur Scher, je me souviens que, lorsque nous avons discuté de l'affaire Latimer en comité, nous avions suggéré de créer une troisième catégorie de meurtre, mais comme c'était près de la fin de nos travaux, je ne pense pas que cela ait débouché sur quoi que ce soit de concret.
Il s'agit certainement d'une question complexe. Je suis d'accord avec vous. D'un autre côté, il faut tenir compte du fait que c'est quand même un meurtre; nous sommes tous d'accord sur ce point. De toute évidence, c'est un meurtre. Il reste à voir si c'est un meurtre différent des autres meurtres, disons de ceux que commet la mafia.
Dois-je comprendre que, selon vous, nous ne devrions pas envisager cette possibilité? Je vous pose la question parce que tous les meurtres ne sont pas nécessairement semblables. Un meurtre commis par un membre de la mafia et un meurtre commis par un homme comme Latimer n'entrent pas du tout dans la même catégorie. Ce sont toutefois des meurtres dans les deux cas.
Ma première réaction est de dire que nous devons réfléchir à cette question. Si je me souviens bien, vous êtes le premier témoin qui aborde précisément ce problème. Voilà pourquoi je vous pose la question. Cela m'inquiète dans une certaine mesure, mais je suis certain que mes collègues partagent mon inquiétude. Nous voulons être certains que cette étude en vaut la peine et que nous devrions l'entreprendre. Si vous dites qu'un examen plus approfondi est nécessaire, je peux le comprendre. Dites-vous que nous ne devrions pas envisager cette possibilité?
M. Scher: Je suis d'accord avec vous pour dire que tous les meurtres ne sont pas semblables et que les meurtres sont de nature différente en raison des circonstances dans lesquelles ils sont commis.
Je crois que le meurtre de Tracy Latimer doit être considéré comme tout autre meurtre. C'était une enfant très handicapée, en effet, mais qui selon le journal tenu par sa propre mère, fréquentait l'école la semaine précédant son meurtre et devait se faire opérer pour une luxation de la hanche la semaine précédant le meurtre. Selon son médecin, cette intervention chirurgicale aurait nettement réduit sa douleur. Tracy avait un père qui était allergique aux technologies médicales, aux seringues et qui avait des phobies, selon un psychiatre. Cette homme s'est arrogé le rôle de juge, jury et bourreau vis-à-vis de sa fille. Il n'a jamais témoigné pour dire si c'était pour des motifs qu'il croyait humanitaires ou non. Il n'a jamais été soumis à un contre-interrogatoire.
Vous me demandez si, étant donné que la nature des meurtres diffère, cela justifie la création d'une troisième catégorie de meurtre? Ma réponse est non. Cela reviendrait à dire que tous les meurtres ne sont pas similaires, mais qu'à l'exception de ce genre de meurtre, tous les meurtres seront traités en fonction des exigences obligatoires de la loi. Lorsque la victime est une personne vulnérable ou souffrant d'une déficience ou encore une personne à la fin de sa vie, son meurtre sera traité différemment et les tribunaux auront toute latitude en ce qui concerne la détermination de la peine.
Ne créez pas une troisième catégorie pour les «meurtres de personnes vulnérables». Si vous pensez toutefois qu'une sentence obligatoire pose un problème du point de vue constitutionnel et moral, c'est une question que vous pourriez examiner. Je ne veux pas dire que ce soit une bonne chose. Je ne le crois pas. Il serait toutefois préférable que vous vous penchiez sur vos préoccupations quant à la nature différente des crimes que d'établir une catégorie de meurtre entière distincte qui reviendrait à accepter de facto l'euthanasie et à refuser les mêmes avantages et la même protection de la loi à un groupe de gens.
Oui, les meurtres sont différents. Le meurtre est toujours une mauvaise chose. Je sais que vous le reconnaissez. Il s'agit de voir comment vous allez le reconnaître et comment le punir. Ne créez pas de catégorie distincte qui va cibler et aussi exclure et marginaliser davantage les personnes handicapées. Ce n'est pas nécessaire. Un juge pourrait se servir des mêmes pouvoirs discrétionnaires pour condamner Paul Bernardo que pour condamner Robert Latimer.
Le sénateur Beaudoin: Je suis d'accord avec vous quant au fait qu'un meurtre est un meurtre. En tant que juriste, je suis contre tous les meurtres, bien entendu. Je dois toutefois reconnaître que l'intention criminelle peut différer d'un cas à l'autre. Comme nous le disons en français:
[Français]
"Personne ne doit se faire justice elle-même."
[Traduction]
Je ne sais pas comment vous le dites en anglais, mais il s'agit d'un meurtre. Nous savons qu'un meurtre peut différer d'un autre. Il peut s'agir d'un meurtre avec préméditation ou d'un meurtre au deuxième degré. Je voudrais étudier la question plus en détail.
Il faut faire quelque chose au sujet de la peine qui est imposée. De toute évidence, Latimer n'est pas dans la même catégorie que Bernardo. Que faut-il faire dans un cas comme celui-là? La cause est devant la Cour suprême. Je suis sûr que nous allons l'étudier de façon plus détaillée.
Vous avez dit qu'il ne faut pas faire cela, mais faire autre chose. Nous allons essayer de déterminer ce que cette autre chose pourrait être.
M. Scher: Faire ce que vous proposez en créant une catégorie de meurtre au troisième degré ferait plus de tort que nécessaire. Je dis cela parce que vous vous trouveriez ainsi à mettre à risque une part importante de la population, et cela n'est pas nécessaire. Vous pouvez accomplir la même chose sans cibler cet élément de la population et le mettre à risque, si c'est ce que vous décidez de faire. La logique qui vous amènerait à isoler ce groupe de personnes parmi les victimes n'est pas celle qui convient et elle est même très dangereuse.
La présidente: Dans votre exposé, monsieur Scher, vous avez évoqué expressément l'affaire Blais. Comme vous le savez, cette dame-là n'a jamais été accusée de quoi que ce soit, ce qui cause justement le dilemme auquel nous nous sommes heurtés dans nos délibérations initiales. Je dois vous dire que nous avons constaté que l'expérience au niveau de la poursuite varie énormément dans les différentes régions du pays. Ainsi, le Dr Dellaroca a été accusé de meurtre et a été condamné pour avoir administré une substance nocive, alors qu'il avait clairement administré à son patient une substance qui l'a tué. À mon avis, on aurait dû l'accuser de meurtre. La poursuite a toutefois décidé, pour je ne sais trop quelle raison, ou bien qu'il aurait été impossible d'obtenir une condamnation, ce qui expliquerait qu'elle ait baissé à plusieurs reprises la gravité du chef d'accusation, ou bien que l'infraction ne méritait pas une condamnation pour meurtre. Nous savons que c'était là le cas dans l'affaire Meyers, en Nouvelle-Écosse, où la poursuite a porté une accusation, non pas de meurtre, mais d'homicide involontaire. Les inculpés s'en sont sortis complètement indemnes. Je crois qu'on leur a imposé une peine avec sursis; c'est là tout ce qu'ils ont reçu comme punition.
En toute justice envers les membres du comité, ce que nous voulions accomplir avec cette catégorie de meurtre au troisième degré, c'était qu'il y ait un plus grand nombre de personnes qui puissent être accusées de meurtre, plutôt que le contraire -- c'est-à-dire, que ces personnes ne fassent l'objet d'aucune accusation ou que l'accusation soit tellement minime que l'acte qu'elles auraient commis ne ferait l'objet d'aucune sanction véritable. Auriez-vous un commentaire à faire?
M. Scher: Je ne nie pas que c'était là l'intention du comité. Je ne crois pas avoir dit quoi que ce soit qui permette de penser le contraire. Ce que je dis, c'est que vous pouvez y arriver en supprimant les peines minimales obligatoires pour tous ceux qui sont reconnus coupables de meurtre, de façon qu'ils soient soumis à la même discrétion judiciaire, aux mêmes principes de détermination de la peine et à l'application égale de la loi.
Le sénateur Beaudoin: Avez-vous dit que nous pourrions régler le problème en éliminant les peines minimales?
M. Scher: Oui, si ce que vous cherchez à faire, c'est de rendre l'accusation de meurtre plus attrayante, afin que la poursuite se sente plus à l'aise d'user de son pouvoir discrétionnaire pour porter une accusation de meurtre dans les cas où une telle accusation serait justifiée mais où on hésiterait à y recourir à cause de l'existence d'une peine minimale. Si donc cette peine minimale était éliminée, la poursuite se sentirait plus à l'aise d'exercer sa discrétion pour porter une accusation de meurtre et chercher à obtenir une condamnation pour meurtre.
Le sénateur Beaudoin: Supposons qu'on élimine la peine minimale. Est-ce la discrétion qui viendrait la remplacer?
M. Scher: Oui.
Le sénateur Beaudoin: Dites-vous qu'il faudrait une discrétion sans aucune entrave?
M. Scher: C'est bien ce que vous proposez avec cette catégorie de meurtre au troisième degré.
Le sénateur Beaudoin: Non, ce n'est pas ce que nous proposons. Un meurtre, c'est un meurtre.
M. Scher: En ce qui a trait toutefois à la détermination de la peine, vous proposez que, dans le cas d'un meurtre au troisième degré, si j'ai bien compris, le juge de première instance aurait le pouvoir exclusif de déterminer la peine qui convient. Sa discrétion ne serait soumise à aucune limite. Autrement dit, si le juge trouvait que, dans les circonstances, une peine de deux ans moins un jour conviendrait, il serait libre d'imposer cette peine. S'il estimait que, dans les circonstances particulières, il conviendrait de condamner l'inculpé à une mise en liberté surveillée ou à un emprisonnement équivalant au temps qu'il aurait déjà passé en détention, il aurait cette discrétion. Si on éliminait les peines minimales obligatoires, les juges pourraient continuer à faire comme à l'heure actuelle et on aurait l'assurance que l'application de la loi serait la même pour tous.
Le sénateur Beaudoin: Nous devrions réfléchir à tout cela.
M. Scher: Je voudrais réagir à un de vos autres points, à savoir qu'un meurtre, c'est un meurtre. Je crois que nous serions tous d'accord pour dire, en principe, que le cancéreux qui est en phase terminale et qui va mourir dans les minutes, les heures et les jours qui suivent est très différent du jeune de 12 ans qui est atteint de paralysie cérébrale et dont l'espérance de vie peut aller d'un jour à 70 ou 80 ans et qui est bien vivant et à même d'exercer son rôle d'être humain. Encore là, il y a cette question des circonstances.
C'est ce que je vous entends dire quand vous dites que certains meurtres sont différents d'autres meurtres. Vous y avez fait allusion quand vous avez parlé de la mafia. Vous dites que les meurtriers ne sont pas tous les mêmes. Je comprends cela, et je peux l'accepter. Je veux toutefois éviter que nous fassions, volontairement ou involontairement, des différenciations entre les meurtriers en fonction des circonstances de leurs victimes.
À mon avis, c'est précisément ce qu'on ferait si on créait une troisième catégorie, celle du meurtre au troisième degré. On créerait ainsi une accusation de meurtre qui véhiculerait le message suivant: «Voici ce qui va se passer. Voici la disposition qui s'applique à ceux qui tuent des personnes défavorisées ou vulnérables, car ces personnes sont vraisemblablement animées par un sentiment de compassion.» Il faudra peut-être définir ce qu'on entend par «compassion» ou «pitié» afin de pouvoir prendre cette décision-là, mais cela revient au même. Cela revient ni plus ni moins à une acceptation dans les faits de l'euthanasie à l'égard de ces groupes-là.
Le sénateur Beaudoin: Non, puisque le meurtrier est puni.
M. Scher: Il pourrait l'être ou ne pas l'être. Tout dépend de ce que vous entendez par «être puni». Quand une personne qui a commis cet acte est condamnée à une peine qui est l'équivalent du temps qu'elle a déjà passé en détention ou qu'elle n'est condamnée à aucune peine, elle n'est finalement pas punie. On peut dire qu'elle est punie en théorie par le système judiciaire puisqu'on lui impose une peine -- peut-être la liberté surveillée, peut-être l'interdiction de quitter sa ferme pendant un an --, mais elle n'est pas vraiment punie. Je n'accepte pas votre prémisse selon laquelle ceux qui seront condamnés pour ce nouveau type de meurtre, le meurtre au troisième degré, seront punis. En voulant réduire la peine minimale obligatoire, on cherche essentiellement à éviter que ces gens-là soient punis ou à veiller à ce qu'ils soient punis moins sévèrement que ne le seraient d'autres meurtriers ayant commis un meurtre dans d'autres circonstances. À mon avis, la différenciation ici tient aux circonstances de la victime.
Le sénateur Corbin: Je ne cesse jamais d'être étonné par la façon dont l'opinion publique se forme, surtout celle qui s'exprime dans les soi-disant sondages d'opinion. Tout est affaire de perception. La perception qui se fonde sur l'information, la désinformation ou la mauvaise information mène à une certaine compréhension, plus ou moins grande selon le cas, puis à un jugement.
Je suis préoccupé par la façon dont l'affaire Latimer a été présentée par les médias, de manière générale. Je suis sûr que vous lisez les journaux, sans doute plus que moi. C'est une idée qui a sa pertinence ici puisque certains des témoins que nous avons entendus ont invoqué les sondages d'opinion à l'appui de leurs thèses ou de leurs objectifs ou de leurs recommandations.
Des commentaires?
M. Scher: Je vous dirai tout d'abord que c'est la réaction du public à l'affaire Latimer qui, dans une large mesure, est à l'origine de l'énorme inquiétude de notre communauté à l'égard d'actes comme celui-là. Le Conseil des Canadiens avec déficiences était partie intervenante devant la Cour suprême du Canada dans l'affaire Rodriguez, où nous avons soutenu qu'une personne ne devrait pas être empêchée physiquement de faire ce qu'elle pourrait faire si ce n'était de sa déficience. Nous avons aussi dit: «N'annulez pas la loi tant et aussi longtemps que des garanties n'auront pas été mises en place pour protéger les personnes ayant des déficiences et d'autres contre des abus flagrants.» Arrive sur ces entrefaites Robert Latimer qui prend sa fille, l'installe sur le siège de sa camionnette, la tue par asphyxie, attend de la voir mourir, mesurant le temps qu'il lui faut pour mourir, après avoir planifié son acte pendant 10 jours et avoir décidé de la méthode qu'il utiliserait et mentant ensuite à la police. Je n'entrerai pas dans les détails moins reluisants de son passé, mais il y a bien des faits qui n'ont pas été présentés, et les médias ont une part de responsabilité. Soyons honnêtes. Deux jurys composés de ses pairs ont entendu les éléments de preuve, ont entendu les preuves médicales concernant la douleur, la chirurgie et ce que nécessitait l'état de sa fille, mais ont néanmoins rendu un verdict de culpabilité pour meurtre. Cependant, vous avez raison, l'opinion publique considère que cet homme est un personnage noble et héroïque, et cela m'inquiète.
Le sénateur Corbin: Vous avez fait allusion à d'autres cas.
M. Scher: En effet.
Le sénateur Corbin: La soi-disant compassion entourant l'affaire Latimer a poussé d'autres gens à agir.
M. Scher: Nous avons reçu des appels à ce sujet.
Le sénateur Corbin: La presse serait-elle responsable de cet état de fait?
M. Scher: Je crois qu'elle l'est, en partie.
Le sénateur Corbin: Je parle, ici, des médias en général.
M. Scher: Franchement, je m'inquiète même de l'effet des travaux du présent comité, parce que je crois savoir que le rapport doit être rendu public le 5 juin. Si c'est bien le cas, ce rapport va précéder la présentation de l'affaire Latimer devant la Cour suprême du Canada, le 14 juin. Si l'on songe à porter des accusations de meurtre au troisième degré, ou à réduire la gravité de la sentence, et si votre rapport paraît une semaine avant que la cour suprême n'entende cette cause, je me demande quel effet le rapport va avoir. J'ai tout à fait confiance que les juges ne se laisseront pas influencer indûment par les travaux du comité ni par son rapport, parce qu'il s'agit de gens d'expérience, qui bénéficient de toute l'indépendance voulue. Cependant, je suis tout à fait sûr que ce que vous direz ou ce que vous choisirez de ne pas dire aura une forte incidence sur le public.
Par conséquent, au nom du Conseil des Canadiens avec déficiences, et en tant qu'intervenant devant la Cour suprême du Canada dans l'affaire Latimer, je vous prie instamment de retarder la publication de votre rapport, jusqu'après la tenue de l'audience devant la Cour suprême, précisément pour les raisons que vous avez mentionnées, soit l'effet des médias sur l'attitude du public, sur l'opinion publique, et son incidence potentielle sur la collectivité.
La présidente: Je crois que, dans une certaine mesure, vous vous méprenez sur le but que poursuit le comité. Nous ne sommes pas ici pour prendre position. Notre mandat consiste à étudier les mesures qui ont été prises à propos des initiatives sur lesquelles nous étions unanimes. Je ne crois pas que votre préoccupation soit véritablement valable.
On a choisi la date en question parce qu'il s'agit du cinquième anniversaire de la publication originale du document. Cependant, comme je l'ai dit, nous ne traitons que des recommandations unanimes. Nous n'allons pas faire de nouvelles recommandations; nous allons simplement donner notre opinion sur ce que le gouvernement a fait relativement à telle ou telle mesure.
M. Scher: Je le comprends bien, et je ne désire pas laisser entendre que le comité va tenter d'influencer le processus qui va se dérouler. Mais pour reprendre ce qu'a dit le sénateur Corbin, les résultats de vos travaux parviendront au public, qui en discutera. C'est la raison pour laquelle vous étudiez ces questions, justement. Inévitablement, vos travaux auront une incidence sur l'opinion publique. Tout aussi inévitablement, selon notre expérience, on va confondre les choses. Votre intention n'est peut-être que d'accorder une note à ce que les gouvernements ont fait ou n'ont pas fait, mais je ne crois pas que les médias vont présenter la chose ainsi. Ils l'utiliseront pour apporter de l'eau au moulin d'un côté ou de l'autre, selon leurs intentions ou la position qu'ils essaient de vendre.
Avec tout le respect que je vous dois, et que je dois au comité, madame le sénateur, je suis absolument certain que les fruits de vos travaux seront utilisés lors de ce débat, et je vous prie instamment de reporter la publication de votre rapport. Je comprends bien qu'il y a une question d'échéance en jeu, mais je suis fortement préoccupé par le fait que ce que vous direz aura une incidence sur la discussion publique et le débat entourant cette affaire.
Nos inquiétudes sont fondées en partie sur le fait qu'il a été presque impossible d'entreprendre un débat rationnel sur quelques-unes de ces questions en raison des réactions émotives qu'elles ont suscitées, qu'on songe aux réactions qu'on a constatées et aux gestes qui ont été posés autour du cas de Sue Rodriguez, de Robert Latimer, et du premier rapport du présent comité. Dans chacun de ces cas, on a fourni des arguments à des gens qui pourraient avoir des intentions cachées.
Le problème, voyez-vous, c'est que notre bureau a reçu des appels de parents disant que, si Robert Latimer était libéré, ils tueraient leurs enfants. En tant qu'avocat, en tant qu'officier de justice et membre du public, je suis profondément inquiet. Ce que la Cour suprême décidera, ce que le comité va faire, et ce que moi-même je ferai en tant que représentant du Conseil des Canadiens avec déficiences, tout cela fait partie de cette discussion.
Je vous demande tout simplement d'envisager sérieusement de reporter la publication de votre rapport pour qu'il ne soit pas mal compris et pour que les observations, sinon les recommandations qui y sont formulées ne fassent pas l'objet d'une discussion qu'il n'est pas souhaitable d'entamer, car cela ne sera pas utile pour le débat que vous cherchez à avoir.
Le sénateur Roche: Le 30 septembre 1994, si je ne m'abuse, le Conseil des Canadiens avec déficiences a témoigné devant le comité saisi de l'étude sur l'euthanasie et l'aide au suicide. Je ne siège pas à ce comité, mais je vais lire le compte rendu de cette audience et lire votre témoignage.
Quand vous avez témoigné alors, avez-vous dit au comité que vous vous opposiez à une troisième catégorie de meurtre?
M. Scher: Honnêtement, je ne m'en souviens pas. Cela dit, je ne crois pas, puisque ce concept n'a vu le jour que plus tard.
La présidente: Après avoir lu votre témoignage, je dois dire que vous ne l'avez pas fait.
M. Scher: Je me souviens du moment où Bernard Dickens, entre autres, a présenté ce concept pour la première fois. Je me suis longuement entretenu avec lui à ce sujet.
Le sénateur Roche: Quand le comité a recommandé à l'unanimité dans son rapport la création d'une troisième catégorie de meurtre, avez-vous réagi? Avez-vous signifié au gouvernement de l'époque votre point de vue sur cette recommandation unanime?
M. Scher: Je crois que nous l'avons fait, quoique je n'en sois pas certain. De toute façon, nous nous y sommes opposés à plusieurs reprises en public.
Le sénateur Roche: Vous pourriez peut-être faire une petite recherche dans vos propres dossiers, et si vous découvrez que vous avez effectivement communiqué avec le gouvernement concernant cette recommandation unanime faite en 1995, pourriez-vous en informer notre greffier de sorte qu'il puisse nous communiquer l'information?
M. Scher: Absolument. Je peux vous dire avec certitude que nous nous sommes prononcés publiquement contre cette recommandation. J'ai débattu de la question personnellement avec Bernard Dickens à l'émission The National sur le réseau anglais de la SRC, et dans d'autres médias également, et je me suis toujours opposé à cette recommandation, depuis sa formulation initiale. Je sais que nous avons également envoyé des lettres. Je fournirai au comité tout ce dont nous disposons.
Le sénateur Roche: Je vous remercie. Je crois comprendre que vous rejetez l'argument voulant que l'attrait d'une troisième catégorie de meurtre tient au fait que les procureurs auront à choisir parmi un éventail élargi de condamnations, dans la mesure où ils n'auront plus à chercher à obtenir des condamnations assorties d'une peine obligatoire d'emprisonnement à vie dans les cas de meurtre «par compassion». Vous rejetez cette hypothèse, si je ne m'abuse, en rejetant la troisième catégorie de meurtre.
J'ai remarqué que vous avez dit qu'une troisième catégorie serait l'équivalent de l'euthanasie. Pourriez-vous me donner une explication? Le meurtre a déjà été commis. L'hypothèse avancée est la suivante: si on pouvait avoir une troisième catégorie de meurtre assortie d'une peine inférieure, les possibilités d'obtenir une condamnation seraient meilleures étant donné la possibilité d'imposer une peine inférieure. Si j'ai bien compris votre propos, vous rejetez cet argument par respect pour l'intégrité de la vie; un meurtre est un meurtre.
M. Scher: Cela est peut-être vrai en partie, je le concède. Cela étant, quant à la troisième catégorie de meurtre qui serait une euthanasie de fait, je parlais en réalité de cas où l'on a obtenu une condamnation, mais où la peine était la probation ou le temps passé en détention préventive, ce qui revient à dire qu'il n'y a pas eu de punition pour le meurtre. Le meurtre a été consigné par écrit dans les livres, mais aucune mesure n'a été prise pour corriger le tort, dans la mesure où la seule peine qui a été imposée a été la probation ou la durée de la détention préventive.
Le sénateur Roche: L'adoption de la solution que vous privilégiez exigerait de modifier le Code criminel.
M. Scher: Non, la solution que je préconise est de laisser les choses telles qu'elles sont, comme je l'ai dit au début de mon intervention. J'ai dit que si on a vraiment l'intention de changer le Code criminel, l'une des façons les moins dangereuses de le faire, du point de vue du groupe que je représente, serait d'envisager d'éliminer les peines minimums obligatoires dans tous les cas, notamment si on crée une troisième catégorie de meurtre visant le groupe que je représente et d'autres victimes.
Le sénateur Roche: Pour rejeter, comme vous le suggérez, la troisième catégorie, il faudrait changer ce qui était une recommandation unanime. Je veux être sûr de bien vous comprendre: vous nous recommandez de revenir sur une recommandation qui avait fait l'unanimité en 1995, n'est-ce pas?
M. Scher: Oui et non. Si j'ai bien compris la recommandation, vous vouliez que dans ces cas-là la détermination de la peine soit faite de façon discrétionnaire. Or, il est possible d'y parvenir si on suit la méthode que j'ai décrite. En fait, il est possible d'avoir la latitude voulue si on supprime les peines minimales obligatoires. Nul besoin de créer une troisième catégorie de meurtre. Car, au contraire, si vous créez effectivement une troisième catégorie de meurtre, vous mettez en place, à mon avis, un système de justice à deux vitesses. Ceux qui tueront des gens qui ne sont ni vulnérables ni handicapés pourront être condamnés à une peine minimale obligatoire et emprisonnés à vie sans avoir droit à la libération conditionnelle pendant un temps bien déterminé, alors que ceux qui tueront des gens handicapés seront condamnés à une peine qui sera laissée à la discrétion du juge de première instance. C'est ce que j'appelle créer un système de justice à deux vitesses.
Je ne vous suggère pas de le faire, mais plutôt de maintenir le régime actuel, tout en vous demandant par quel autre moyen les procureurs pourront tenir compte, dans leur pratique de mise en accusation et de détermination de la peine, de certaines des préoccupations qui ont donné lieu à votre recommandation. Vous pouvez régler tout cela de façon très simple et de façon plus spécifique en supprimant la peine minimale obligatoire, si c'est ce que vous décidez de faire, ce qui pourrait répondre à vos préoccupations et correspondre à la recommandation du comité.
Le sénateur Roche: Il faudra que j'y pense plus longuement.
La présidente: C'est ce que nous devrons tous faire.
Monsieur Scher, merci beaucoup de votre exposé très inspirant, qui nous servira beaucoup dans notre réflexion.
Nous accueillons maintenant la Coalition Campagne vie.
Honorables sénateurs, sachez que l'on a averti tous les témoins que nos audiences ne serviraient pas à rouvrir les recommandations sur l'euthanasie et l'aide au suicide qui n'ont pas fait l'unanimité. Par conséquent, les témoins confineront donc tous leurs propos aux aspects du rapport qui ont fait l'unanimité.
Nous commençons par M. Peter Ryan.
M. Peter Ryan, président, Coalition Campagne vie du Nouveau-Brunswick: Mesdames et messieurs, merci de m'accueillir aujourd'hui. J'espère que vous avez tous reçu un exemplaire de ma déclaration.
La Coalition Campagne vie croit que les êtres humains ont tous le même droit à la vie. Le droit à la vie est un principe fondamental de justice qui doit être protégé dans nos lois et dans notre culture. Nous avons à coeur le sort des faibles et des vulnérables de notre société, qui dépendent des autres et qui ont donc peu ou prou voix au chapitre quand il s'agit de décider s'ils doivent vivre ou mourir, que l'on parle d'un enfant à naître, d'un nourrisson handicapé, d'une personne dans un état végétatif à la suite d'un accident, d'une personne âgée souffrant de la maladie d'Alzheimer ou de quelqu'un dont la maladie terminale a un effet débilitant.
Je m'intéresse de très près et depuis plusieurs années à la question de l'euthanasie et de la fin de la vie. En effet, en 1994, alors que je travaillais à l'archidiocèse catholique de Vancouver, j'ai aidé l'archevêque Adam Exner à préparer son témoignage au Comité sénatorial spécial sur l'euthanasie et l'aide au suicide. En 1996, j'ai terminé un mémoire sur la déontologie théologique à l'Université pontificale du Latran à Rome. Le sujet de mon mémoire? Le débat canadien entourant la légalisation de l'euthanasie. J'ai étudié ce qui s'était dit là-dessus de 1992 à 1995. Une bonne partie de mon étude portait sur les audiences du comité sénatorial et sur son rapport «De la vie et de la mort». Vous comprenez pourquoi je suis curieux de savoir comment vous allez mettre à jour votre rapport.
La Coalition Campagne vie s'inquiète de la recommandation portant sur le suicide par compassion. Je crois que d'autres membres de la table ronde s'intéresseront eux aussi à cette question. Si je suis ici aujourd'hui, c'est principalement pour vous parler du refus d'administrer un traitement de survie ou de l'interruption de son administration ainsi que du lien que l'on peut parfois faire dans certains cas entre cela et l'euthanasie non volontaire. Vous savez que le lien possible entre, d'une part, refuser d'administrer un traitement et, d'autre part, l'euthanasie est une question dont ne traite pas de façon expresse le rapport «De la vie et de la mort». Il s'agit donc d'une question inédite dont vous voudrez peut-être traiter dans votre mise à jour.
Quand vous examinerez toute la question de la suppression du traitement et vos recommandations unanimes à cet égard, au chapitre 5 du rapport, nous vous invitons à vous pencher sur le problème du sous-traitement aussi bien que celui du sur-traitement. Par «sous-traitement», je veux parler du cas où l'on refuse à un patient privé de ses facultés le bénéfice d'un traitement utile et non excessif en raison des préjugés de quelqu'un à propos du handicap, de l'âge ou de la maladie du patient. Durant les audiences du Comité sénatorial sur l'euthanasie, divers témoins ont souligné les problèmes de sous-traitement, notamment dans le cas des personnes handicapées.
Le rapport prévoit une réforme juridique des dispositions d'omission ou d'interruption du traitement. La réforme envisagée permettrait aux médecins et à d'autres personnes d'omettre plus facilement un traitement. Cela pourrait être une bonne chose à maints égards. Toutefois, le fait de faciliter cette omission ou cette interruption ne risquerait-il pas de poser de façon plus aiguë le problème du sous-traitement? Quoi qu'il en soit, je crois qu'il faut que le comité se penche de près sur le problème du sous-traitement, car c'est quelque chose qui touche aux droits fondamentaux de tous les citoyens à la vie et à des soins de santé.
Le phénomène du sous-traitement soulève une question morale et juridique tout à fait pertinente à mon avis. L'omission ou l'interruption d'un traitement qui maintient un patient en vie peut-elle dans certains cas constituer un homicide? Peut-il s'agir parfois d'euthanasie? Vous remarquerez que j'emploie le terme «parfois». Ce que je veux dire, c'est que je vous invite à vous pencher sur le cas de patients qui meurent après qu'on leur a retiré la possibilité d'être maintenus en vie à l'aide de traitements utiles et non excessifs sans leur consentement. Peut-on considérer dans ce cas qu'il y a eu homicide ou euthanasie?
Pour clarifier les choses, je ne vous demande pas de décréter que tous les cas où un patient décède après l'interruption ou l'omission d'un traitement constituent un homicide ou une forme d'euthanasie. Cette question ne se pose pas. Il y a des gens qui meurent tous les jours au Canada parce que des médecins ne leur ont pas administré des traitements qui n'étaient pas indispensables. Est-ce que ces médecins sont des meurtriers? Bien sûr que non. Nous ne parlons pas non plus des cas où des individus refusent des traitements qu'ils jugent inutiles ou trop lourds pour eux. Nous ne parlons pas non plus des cas où des parents ou d'autres personnes habilités décident d'interrompre ou d'omettre des traitements qui ne sont pas indispensables pour le patient dont ils sont responsables. Nous parlons ici de traitements utiles et non excessifs.
À propos de la question de savoir si l'omission ou la suppression d'un traitement de maintien en vie peut parfois constituer un homicide, il faut bien savoir que la loi n'est pas muette à ce sujet. La plupart des experts juridiques reconnaissent que la réponse du Code criminel à cette question est oui. Elle est présente en substance dans les articles 215 à 217 du code. On peut discuter de la portée exacte de ces dispositions, mais le principe fondamental, l'idée que l'omission de traitement peut constituer un homicide, semble clair.
J'ai trouvé étrange que le rapport «De la vie et de la mort» n'ait ni posé ni résolu la question de savoir si la suppression ou l'omission d'un traitement avait un caractère d'homicide. Toutefois, en lisant entre les lignes, on a l'impression que le rapport tendrait à répondre par la négative à cette question. Je me demande comment les membres de ce comité l'interprètent. Quoi qu'il en soit, je pense qu'il serait bon que le comité précise sa position sur la question. Si, d'après le Code criminel, ces omissions peuvent constituer un homicide, et si le comité estime qu'il faut réformer les dispositions juridiques concernant la suppression ou l'omission de traitement, je pense qu'il faudrait sérieusement étudier la question avant de pouvoir mettre en place une réforme sérieuse.
Peut-être le comité voudra-t-il dire clairement qu'à son avis la suppression ou l'omission d'un traitement ne constitue pas un homicide. Il pourrait le dire en se fondant sur l'idée que lorsqu'un patient décède après qu'un traitement a été omis, son décès n'est que naturel. Il n'y a donc pas d'intention de donner la mort comme c'est le cas quand on parle d'homicide. Ce serait une position simple et claire à adopter, mais résisterait-elle à un examen approfondi? Je ne le crois pas.
Si nous entrions, vous ou moi, dans un hôpital et si nous commencions à débrancher des appareils, à débrancher des respirateurs, des tuyaux de perfusion ou d'alimentation, si nous enlevions les médicaments et les technologies qui maintiennent en vie des patients, croyez-vous que nous pourrions le faire en toute impunité? Si des patients mouraient à cause de cela, pourrions-nous être accusés d'avoir entraîné leur mort en vertu des lois actuelles? Je pense qu'il est clair que nous pourrions être condamnés, et que la plupart des Canadiens seraient tout à fait d'accord avec les dispositions actuelles du droit. La question est de savoir si le comité souhaite modifier ces dispositions. Si vous considérez que l'omission ou l'interruption du traitement ne constitue pas un homicide, vous devez logiquement proposer qu'on modifie la loi de façon à ce qu'il devienne impossible d'accuser d'homicide quelqu'un qui n'aura pas accordé un traitement médical à une autre personne.
Quand on parle du sous-traitement ou du non-traitement, la difficulté vient en partie du fait qu'on n'a pas suffisamment de cas pertinents et familiers. Dans les documents qui traitent de la question, on se réfère souvent au cas d'un enfant trisomique atteint d'une obstruction intestinale qui risquait d'entraîner la mort. Que se passerait-il si les parents refusaient l'opération et que l'enfant mourait? En l'occurrence, il s'agissait d'un traitement médical assez banal et utile pour le patient, d'un traitement qui n'était pas excessif, et pourtant on ne l'a pas fait. Pourquoi? De toute évidence parce que les parents estimaient qu'il valait mieux laissé l'enfant mourir pour lui épargner une vie de souffrance. La question est la suivante: ces parents étaient-ils responsables de la mort de leur enfant, ou ont-ils simplement laisser la nature suivre son cours? Je dirais a priori qu'ils étaient responsables; toutefois, ils ont agi par compassion, de sorte que ce décès à mon avis devrait être considéré comme une forme d'euthanasie non volontaire, et non comme un homicide.
Quand la professeure Downie, de l'université Dalhousie, a comparu devant votre comité, elle a parlé du cas de Skeena B., à propos duquel le tribunal avait affirmé que, si les parents refusaient un traitement qui était dans l'intérêt de leur enfant mineur, l'État pouvait passer outre à ce refus. Toutefois, si vous dites qu'en omettant un traitement les parents laissent simplement la nature suivre son cours, vous ne laissez pas beaucoup de possibilité d'intervention à l'État, n'est-ce pas?
Nous ne connaissons pas beaucoup de cas de Canadiens morts des suites de l'omission de traitement, mais en Grande-Bretagne il y a eu de nombreux cas de ce genre, notamment liés à l'alimentation ou à l'hydratation. Les affaires les plus récentes relatées dans la presse parlent de nombreuses personnes âgées privées d'alimentation et déshydratées par des personnes responsables de leurs soins qui avaient des préjugés à leur égard et les considéraient comme des vieillards.
Je crois qu'Alex Schadenberg vous en parlera plus tard, et je ne vais donc pas m'étendre sur ces affaires, mais je constate que l'inquiétude du public à l'égard de cette question du sous-traitement ou de l'omission du traitement a alimenté l'appui au projet de loi sur le traitement médical (prévention de l'euthanasie). Ce projet de loi a maintenant reçu la deuxième lecture, et le comité a fait rapport à la Chambre.
Ce projet de loi stipule ceci:
Il est illégal pour une personne responsable du soin d'un patient d'omettre ou d'interrompre un traitement médical ou un dispositif de soutien pour ce patient si le seul but de cet acte est de hâter ou d'entraîner de quelque façon le décès du patient.
Je me demande ce que penserait votre comité de légiférer sur ce point. Cela permettrait peut-être de clarifier les dispositions du droit concernant l'omission ou l'interruption du traitement, n'est-ce pas?
L'idée que la mort peut être entraînée par l'omission d'un traitement et que l'euthanasie peut aussi être entraînée par une omission aussi bien que par un acte n'a rien de nouveau ou d'ésotérique. Comme je l'ai dit, le Code criminel l'appuie. Elle a aussi reçu l'appui de nombreux témoins qui ont comparu au Comité sénatorial sur l'euthanasie, notamment d'éminents érudits tels que Edward Keyserlingk et Margaret Somerville. Cela fait aussi partie de l'enseignement officiel de l'Église catholique, qui définit l'euthanasie comme un acte ou une omission visant à atténuer des souffrances.
Même si on considère que l'absence de traitement peut parfois constituer un homicide, une question importante demeure, celle de savoir quand il y a homicide, et quand ce n'est pas le cas. Cela peut être une question difficile, mais ce n'est pas parce que certains principes sont difficiles à appliquer qu'il faut ignorer l'importance de ces principes. À mon avis, le comité devrait continuer à approfondir l'insuffisance de traitement et l'absence de traitement. J'aimerais que le comité précise qu'un acte d'omission peut constituer une forme d'euthanasie non volontaire. J'aimerais que le comité cherche à déterminer dans quelle circonstances l'absence de traitement peut parfois constituer un homicide. Dans tous les cas, je souhaite que vos délibérations soient couronnées de succès.
La présidente: Merci, monsieur Ryan. Nous allons maintenant entendre M. Schadenberg.
M. Alex Schadenberg, directeur exécutif, Euthanasia Prevention Coalition of Ontario: Honorables sénateurs, le 23 février 1994, un comité spécial du Sénat était formé pour examiner, afin d'en faire rapport, les questions juridiques, sociales et éthiques liées à l'euthanasie et au suicide assisté. Le comité a siégé 14 mois pendant lesquels il a entendu plus de 150 témoins et reçu des centaines de lettres et de mémoires. À l'issue de ce vaste examen des questions en cause, le comité a publié son rapport, intitulé «De la vie et de la mort».
La Euthanasia Prevention Coalition of Ontario reconnaît combien la mise au point de ce rapport a constitué une tâche formidable. De plus, elle espère que bon nombre des recommandations qu'il renferme seront mises en oeuvre. Toutefois, certaines recommandations lui paraissent fautive et elle ne peut en percevoir la logique.
Trois des recommandations auxquelles nous nous opposons concernent la question qu'on nous a demandé de commenter aujourd'hui, soit celle de l'«homicide par compassion». Notre coalition définit de la façon suivante l'«homicide par compassion»: meurtre volontaire, par action ou omission, dans le but de mettre fin aux souffrances de la personne concernée. Le comité sénatorial spécial a recommandé à l'unanimité de modifier le Code criminel afin de permettre l'imposition d'une peine moins sévère dans le cas où intervient l'élément essentiel de compassion ou de pitié.
Il recommandait au Parlement d'envisager les options suivantes. Une option était de créer une troisième catégorie de meurtre qui entraînerait une peine moins sévère que la peine obligatoire d'emprisonnement à perpétuité; ou encore, on pourrait créer une infraction distincte d'homicide par compassion qui entraînerait une peine moins sévère. Les éléments essentiels de compassion ou de pitié doivent être clairement et strictement définis afin de limiter les cas admissibles à une peine moins sévère. Le comité n'a pas proposé de définition susceptible d'être assez étroite et que le Parlement pourrait juger acceptable. Il n'y aurait donc pas de définition; c'est le Parlement qui déterminerait la peine appropriée.
Une majorité des membres du comité a également recommandé que l'euthanasie volontaire demeure une infraction criminelle. Mais on devrait modifier le Code criminel afin de permettre l'imposition d'une peine moins sévère, semblable à celle prévue pour les cas d'euthanasie non volontaire où intervient l'élément essentiel de compassion ou de pitié. La partie de cette recommandation prévoyant que l'euthanasie volontaire demeure une infraction criminelle nous réjouit, mais nous nous opposons à l'imposition d'une peine moins sévère pour les cas où intervient l'élément essentiel de compassion ou de pitié. Cette recommandation n'est pas à l'étude aujourd'hui, sans doute parce qu'elle n'était pas unanime, mais je tiens à en parler parce que l'idée de permettre l'imposition d'une peine moins sévère a probablement fait l'unanimité, étant donné que la majorité a recommandé que, si l'euthanasie volontaire demeure une infraction criminelle, on modifie le Code criminel afin de permettre l'imposition d'une peine moins sévère, semblable à celle prévue pour l'euthanasie non volontaire.
Une troisième recommandation que notre coalition associe à l'homicide par compassion figure au chapitre 5. Elle a été adoptée à l'unanimité et concerne l'hydratation et l'alimentation artificielles considérées par le comité comme des formes de traitement. Ainsi, dans certaines circonstances, il est acceptable de ne pas administrer l'hydratation et l'alimentation artificielles ou de les interrompre, comme c'est le cas également de la respiration artificielle, des transfusions sanguines ou de la réanimation cardiorespiratoire. La raison pour laquelle nous associons cette recommandation à l'homicide par compassion, c'est que des personnes dépourvues de sens moral, membres de la famille, amis ou fournisseurs de soins, pourraient s'en prévaloir pour affamer jusqu'à ce que mort s'ensuive une personne frappée d'incapacité, en particulier si cette personne s'acharne à vivre contre la volonté des autres ou qu'elle coûte trop cher aux autres, compte tenu de leurs moyens financiers, émotifs, psychologiques ou sociaux. Nous y reviendrons.
Nous nous opposons à toute modification du Code criminel qui permettrait d'imposer une peine moins sévère pour homicide par compassion. À notre avis, cette notion conduirait essentiellement à une situation où les êtres humains ne sont pas tous égaux en vertu de la loi et ne jouissent pas tous de la même protection. Nous croyons aussi que toute législation en matière d'homicide par compassion serait conçue à l'intention des cas difficiles comme celui de l'affaire Latimer. Tout en reconnaissant les difficultés que pose, en l'occurrence, la condamnation du meurtrier, nous estimons que les cas difficiles sont garants de lois fautives. En modifiant le Code criminel de manière à traiter ces cas difficiles, nous ferions place aussi à toute une gamme de nouveaux problèmes bien pires que le dilemme actuel.
Pour illustrer les problèmes auxquels donnerait lieu l'inscription au Code criminel d'une exception pour homicide par compassion, attardons-nous à deux modifications possibles du Code criminel qui auraient pour effet d'inscrire dans la loi l'homicide par compassion. La première option serait l'insertion au Code criminel d'une exemption pour homicide par compassion, défini en termes généraux, qui s'appliquerait à tout homicide dont l'auteur pourrait prétendre, preuve raisonnable à l'appui, qu'il a agi par compassion. Cela entraînerait la création d'une troisième catégorie de meurtre, l'homicide par compassion, abolissant la peine minimale seulement pour un homicide motivé par la compassion ou par la pitié. Cette approche entraînerait deux sortes de problèmes.
En premier lieu, la motivation n'est pas observable. La motivation d'un acte ne peut s'établir de la même façon que les faits entourant cet acte. En droit canadien, deux principes accentuent cette vérité: la culpabilité doit être prouvée au-delà de tout doute raisonnable, et on ne peut obliger un accusé à témoigner à son propre procès. Par conséquent, dès que la défense prétendrait que son client a agi par compassion, la poursuite serait tenue de prouver au-delà de tout doute raisonnable que le motif n'était pas la compassion, et cela, sans avoir la possibilité d'interroger l'accusé devant le tribunal. Nous verrions ainsi surgir un nombre exagéré d'affaires censées relever de l'homicide par compassion. Des parents ou des amis ayant tué un être cher qui était âgé, handicapé ou incapable, mais riche, pourraient prétendre avoir agi par compassion. Il serait alors très difficile de prouver qu'ils ont plutôt agi par cupidité.
En second lieu, la compassion peut être définie en termes très généraux. Qu'est-ce que la compassion? Dans quelles situations peut-on envisager qu'elle puisse servir de motif à un homicide? Sur Internet, à l'adresse www.dictionary.com, nous avons trouvé les trois définitions suivantes de la compassion:
Premièrement, conscience profonde de la souffrance d'un autre, accompagné du désir de la soulager.
Voir «pitié» pour synonyme.
Deuxièmement, littéralement, souffrir avec un autre, sentiment de tristesse provoqué par la détresse ou les malheurs de quelqu'un d'autre; pitié; commisération.
Dans un troisième cas, la compassion était définie comme suit:
Profonde conscience des malheurs d'un autre et sympathie à son égard; aptitude à comprendre la souffrance de quelqu'un et désir de faire quelque chose à cet égard.
On donnait encore la pitié comme synonyme.
Puisque la compassion est normalement liée à la souffrance d'une autre personne, quelle sorte de souffrance serait censée mériter une peine moins sévère lorsqu'un meurtre l'aurait soulagée? Comment les tribunaux pourraient-ils limiter cette souffrance au domaine physique alors que la souffrance mentale, émotive, spirituelle et psychologique est tout aussi dévastatrice? Que penser des personnes déprimées? Leurs souffrances mentales ne sont-elles pas équivalentes aux souffrances physiques d'un autre? Nous nous intéressons aux déprimés parce que leurs appels au secours peuvent être confondus avec une demande de mourir.
Après des années d'établissement de précédents par les tribunaux, la mise en application de l'homicide par compassion pourrait déboucher sur une foule de situations. La pauvre mère qui aurait noyé son nouveau-né par compassion, devant ses perspectives d'une qualité de vie misérable, serait-elle admissible à l'exemption de la peine minimale au titre de la compassion? Que dire de l'adolescente qui aurait déposé son nouveau-né dans une poubelle parce qu'elle n'en voulait tout simplement pas? Les deux pourraient-elles s'attendre à être traitées selon les dispositions en matière d'homicide par compassion? Y aurait-il recours abusif à ces dispositions de la part d'accusés particulièrement habiles à susciter les émotions dans une cour de justice ou seulement de la part de meurtriers ayant les moyens de se payer les meilleurs avocats? Les inégalités que la société fait subir aux pauvres et aux marginaux en seraient-elles encore exacerbées?
On imagine bien les abus auxquels pourrait donner lieu une définition législative vague de l'homicide par compassion, mais reconnaissons aussi la difficulté de la poursuite si elle devait prouver que la défense invoque à mauvais escient le motif de la compassion en faveur d'un assassin qui veut échapper à la peine minimale. Il est vrai que le comité sénatorial spécial sur l'euthanasie et l'aide au suicide a inscrit parmi ses recommandations que les éléments essentiels de compassion ou de pitié doivent être clairement et strictement définis afin de limiter les cas admissibles à une peine moins sévère, conscient qu'il était du danger que représentait une définition trop vague de la compassion.
Nous avons examiné cette première option d'abord pour pouvoir la comparer à la seconde, celle que propose le comité sénatorial. Il s'agit ici de l'insertion au Code criminel d'une exemption relative à l'homicide par compassion, défini strictement, qui s'appliquerait uniquement aux homicides pour lesquels la preuve a été faite au-delà de tout doute raisonnable que la victime souffrait et que l'acte a été motivé par la compassion. Cette approche entraînerait deux graves problèmes.
En premier lieu, cette approche présenterait les mêmes difficultés qu'une définition en termes plus vagues de l'homicide par compassion pour la poursuite obligée de réfuter la thèse du motif de compassion. L'incapacité d'observer ou de prouver le motif serait toujours là. Le problème lié à la définition de la compassion serait toujours là. Et l'établissement de précédents judiciaires ayant pour effet d'élargir l'interprétation de l'homicide par compassion serait également toujours là. En fait, les arguments attribuables à une définition législative trop vague s'appliquent également ici, sauf qu'on aura limité les cas à un groupe de victimes particulier.
En second lieu, on suppose que dans le cas du meurtre d'une personne souffrant d'une incapacité grave, un tribunal pourrait admettre l'invocation du motif de compassion, et il appartiendrait à la poursuite de faire la preuve du contraire. Par conséquent, le meurtre d'une personne handicapée ou vulnérable, qu'il s'agisse d'une personne frappée d'un handicap physique, d'une incapacité mentale, de troubles émotifs ou psychologiques, de difficultés dues au vieillissement, sera traité différemment du meurtre d'une personne en santé même s'il s'agit d'actes identiques. La chose est particulièrement troublante quand on sait combien le taux d'agression à l'égard des personnes handicapées ou vulnérables est élevé et que, en général, les personnes vulnérables ne jouissent pas d'une dignité égale au sein de la société.
Nous estimons que les personnes handicapées et vulnérables ont besoin non pas d'être moins protégées par la société, mais de l'être encore mieux. Nous sommes également d'avis que les dispositions législatives, même strictement définies, en matière d'homicide par compassion seraient contestées du point de vue constitutionnel et invalidées par la Cour suprême du Canada, laquelle jugerait qu'elles accordent aux citoyens ayant une déficience moins de protection qu'à l'ensemble des citoyens. L'article 15 de la Charte canadienne des droits et libertés se lit ainsi:
La loi ne fait acception de personne et s'applique également à tous, et tous ont droit à la même protection et au même bénéfice de la loi, indépendamment de toute discrimination, notamment des discriminations fondées sur la race, l'origine nationale ou ethnique, la couleur, la religion, le sexe, l'âge ou les déficiences mentales ou physiques.
Dans le rapport «De la vie et de la mort», la principale raison invoquée pour l'imposition d'une peine moins sévère en cas d'homicide par compassion semble pouvoir se résumer ainsi: puisqu'il est difficile dans les cas d'euthanasie d'obtenir une condamnation pour meurtre au premier ou au second degré parce que les poursuivants et les jurys estiment la peine minimale trop sévère, il faudrait par conséquent imposer une peine moins sévère dans les cas où il existe un élément de compassion ou de pitié. Les propos qui illustrent le mieux ce raisonnement sont ceux du professeur Bernard Dickens, de la Faculté de droit de l'Université de Toronto. Citons-les:
Le problème que soulève dans ce cas la disposition relative au meurtre, c'est qu'en vertu du Code criminel la peine minimale pour le meurtre est l'emprisonnement à perpétuité. Le meurtre au premier degré se distingue du meurtre au second degré non pas par la peine imposée, mais pour ce qui est de l'admissibilité à la libération conditionnelle; les personnes déclarées coupables de meurtre au premier degré ne peuvent, sauf exception, être admissibles à la libération conditionnelle avant d'avoir purgé 25 ans de prison. Les personnes déclarées coupables de meurtre au deuxième degré, la seule autre possibilité, ne sont pas admissibles à la libération avant 10 ans. Il arrive que les poursuivants trouvent que ces peines sont trop sévères, et le jury semble souvent réticent à imposer des peines qu'il considère comme excessives.
Nous reconnaissons la possibilité d'invoquer cet argument pour défendre la vie de personnes vulnérables, en faisant valoir que quiconque tue une personne handicapée, même par compassion, sera punie même si la peine imposée est moins sévère. Toutefois, en pratique, quiconque tue une autre personne, même par compassion, n'a pas tendance à vouloir se faire attraper. Par conséquent, lorsqu'elles seront attrapées, ces personnes voudront tout normalement invoquer les dispositions en matière d'homicide par compassion afin d'obtenir la peine la moins sévère possible pour leur crime.
Nous nous inquiétons aussi de l'argument selon lequel il est difficile d'obtenir une condamnation parce que la peine est trop sévère. Puisque les poursuivants et les jurys ne semblent pas avoir de difficulté à imposer la peine minimale pour le meurtre d'une personne en santé, l'argument laisse entendre aux personnes qui souffrent d'une incapacité que leur vie est moins précieuse pour la société. Nous estimons que, parce que les personnes handicapées, les vieillards, les malades chroniques, les personnes déprimées et toute personne vulnérable dépendent souvent d'une relation de confiance avec ceux qui les soignent, ils ont probablement besoin non pas d'être moins protégés par les tribunaux mais de l'être davantage.
Pour le démontrer, nous sommes allés encore une fois chercher sur l'Internet, à l'adresse www.dictionary.com, les deux définitions suivantes du terme «vulnérable». La première définition donnait: qui peut être blessé; qui peut être facilement atteint; sensible à la censure ou à la critique; qui peut être agressé; et qui peut succomber, comme à la persuasion ou à la tentation. La deuxième définition donnait: qui peut être facilement atteint; sensible à la critique, à la persuasion ou à la tentation; qui peut être blessé; et susceptible de subir des blessures physiques ou émotives.
C'est donc dire que les personnes vulnérables sont particulièrement susceptibles d'être blessées, exploitées, abusées, voire assassinées, même par compassion. Il serait naturel pour les membres du comité de conclure que dans une société juste il convient d'accorder aux personnes vulnérables une protection spéciale en raison de leurs besoins particuliers. S'il existe un domaine qui révèle un manque de protection à l'égard des personnes vulnérables, il appartient alors aux législateurs de veiller à mieux les protéger de tout abus. Puisque leur vulnérabilité les rend incapables de bien se défendre, le gouvernement se doit de leur offrir une protection spéciale. L'idée d'imposer une peine moins sévère à ceux qui auront tué une personne handicapée ou vulnérable va à l'encontre de ce que devrait proposer une société juste, parce que cela consiste à moins bien protéger ceux qui ont le plus besoin de protection.
Nous avons fait allusion tout à l'heure à la recommandation qui consiste à réduire la peine de quelqu'un qui aurait pris part à une euthanasie volontaire. Notre inquiétude relative à l'homicide par compassion englobe aussi cette recommandation qui déboucherait sur une situation telle que les personnes handicapées, les vieillards, les malades chroniques, les personnes déprimées ou vulnérables de quelque façon que ce soit s'en trouveraient moins bien protégées. Quiconque serait pris en flagrant délit de commettre l'euthanasie prétendrait aussitôt avoir agi par compassion. Comment le prouver? S'arrogeant le pouvoir de vie ou de mort, des soignants dépourvus de tout sens moral pourraient décider que le moment est venu pour telle ou telle personne de mourir et, donc, de l'assassiner. Si l'homicide par compassion était inscrit dans la loi, il serait alors très difficile de prouver au-delà de tout doute raisonnable que la personne décédée n'a pas réclamé la mort ou n'était pas déprimée et n'a pas lancé d'appel au secours.
Nous pensons que même l'imposition d'une peine moins sévère pour l'euthanasie volontaire aurait pour effet d'offrir une moins bonne protection législative aux personnes handicapées ou vulnérables. Nous verrions alors augmenter le nombre de morts dites par compassion parmi les personnes handicapées ou vulnérables, les vieillards, les malades chroniques, et cetera.
Nous avons également associé tout à l'heure à l'homicide par compassion la recommandation selon laquelle le comité considère que l'hydratation et l'alimentation artificielles sont des traitements; par conséquent, il est aussi acceptable, dans certaines circonstances, de ne pas les administrer ou de les interrompre que de ne pas administrer ou d'interrompre la respiration artificielle, les transfusions sanguines ou la réanimation cardiorespiratoire. La raison pour laquelle nous associons cette recommandation à l'homicide par compassion, c'est que des personnes dépourvues de sens moral, membres de la famille, amis ou fournisseurs de soins, pourraient s'en prévaloir pour affamer jusqu'à ce que mort s'ensuive une personne frappée d'incapacité, en particulier si cette personne s'acharne à vivre contre la volonté des autres ou coûte trop cher aux autres, compte tenu de leurs moyens financiers, émotifs, psychologiques ou sociaux.
Il existe de nombreux exemples modernes de «soignants» qui, sans aucun sens moral, ont causé la mort d'un grand nombre de malades frappés d'incapacité. Depuis la parution en juin 1999 des nouvelles lignes directrices de la British Medical Association touchant l'interruption ou la suppression de l'alimentation artificielle, plus de 60 allégations touchant des malades privés de boire et de manger dans l'intention de causer leur mort ont été signalées aux autorités et font l'objet d'une enquête. La hausse soudaine des cas d'abus en si peu de temps, en Grande-Bretagne, a amené la Chambre des lords à condamner, le 15 décembre 1999, la suppression de l'alimentation et de l'hydratation des malades et entraîné le dépôt, à la Chambre des communes, d'un projet de loi portant sur les soins médicaux (prévention de l'euthanasie), parrainé par Mme Ann Winterton.
Aussi intéressante que puisse paraître cette affirmation, la réalité nous montre que l'interruption de l'alimentation artificielle peut mener à la mort volontaire de patients dans l'incapacité de décider. Par exemple, le 2 décembre 1999, les enfants de Florence LaDouceur ont intenté une poursuite contre le centre d'accueil Villa Maria de Windsor, en Ontario, pour avoir tenté de priver d'alimentation et d'hydratation leur mère, Florence, âgée de 93 ans. Mme LaDouceur n'avait pas de maladie terminale, elle était en mesure de boire et de manger avec l'aide normale de quelqu'un d'autre, et sa fille, Thelma, ayant le titre de procureur aux soins de la personne, n'avait pas été consultée avant que la décision ne soit prise de cesser d'alimenter et d'hydrater sa mère. Mme LaDouceur a vécu au centre Villa Maria du 26 octobre 1998 au 14 mars 1999. Sa famille l'a retirée du centre d'accueil pour la confier à l'hôpital Hôtel-Dieu/Grace, où elle a été alimentée, réhydratée et soignée pour une pneumonie. Elle était à l'article de la mort à son arrivée à l'hôpital. Le 22 mars, elle a obtenu son congé pour aller vivre chez sa fille, Thelma, où elle a pu se rétablir presque complètement. La famille a entamé cette poursuite afin de créer un précédent destiné à montrer qu'on ne peut impunément causer du tort à quelqu'un ou le tuer en l'empêchant de s'alimenter ou de s'hydrater, et pour obtenir réparation pour le tort causé à Mme LaDouceur. Cette dernière est décédée le 14 janvier 2000, mais la poursuite suit son cours pour honorer sa mémoire et protéger la vie d'autres personnes vulnérables qui dépendent des soins reçus en institution.
Il importe, à notre avis, de considérer l'hydratation et l'alimentation artificielles en milieu médical non pas comme un traitement, mais comme des soins ordinaires. En effet, la common law reconnaît à juste titre à un malade le droit de refuser un traitement ou d'exiger sa suspension ou son interruption, surtout lorsqu'il s'avère inutile ou trop pénible. Le fait de définir l'alimentation artificielle comme un traitement ouvrirait la voie à sa suppression dans le cas de malades frappés d'incapacité qui tardent à mourir. Les cas d'abus pourront se multiplier, et des êtres vulnérables, seront tués sans leur consentement. Une des façons les plus horribles de mourir, c'est de mourir affamé et déshydraté.
Si l'alimentation artificielle est définie comme un traitement, son application est alors fondée sur le besoin ou la nécessité. Le mourant qui a peu besoin d'alimentation artificielle ne serait alimenté qu'au minimum. Celui qui n'a pas besoin d'alimentation artificielle parce que la fin approche verra son traitement interrompu. Étant donné que ce ne sont pas tous les parents, amis et fournisseurs de soins médicaux qui ont un sens moral élevé, nous sommes en faveur d'accroître la protection des personnes vulnérables et non de la réduire.
Si l'alimentation et l'hydratation artificielles en milieu médical sont définies en tant que traitement, le moyen privilégié de se débarrasser de malades frappés d'une incapacité permanente sera, pour un centre d'accueil ou un établissement de soins médicaux aux prises avec des difficultés financières, de supprimer leur alimentation artificielle. Le martyre du malade ainsi affamé sera atténué par des analgésiques, et sa mort sera portée au compte de causes naturelles. On aura ainsi condamné à mort un être vulnérable au lieu de le soigner jusqu'à la fin dans la dignité. L'homicide par compassion aura fait son entrée officieuse dans les usages canadiens, portant ainsi atteinte à nos lois et à nos valeurs. La seule différence entre le fait d'empêcher volontairement quelqu'un de s'alimenter et de s'hydrater et le fait de le tuer avec une solution de chlorure de potassium, c'est que le chlorure de potassium assure au moins une fin rapide.
La Euthanasia Prevention Coalition of Ontario estime que toute modification de la loi en vue de permettre une exemption de la peine minimale pour homicide par compassion aurait pour effet d'éroder encore davantage la protection des personnes vulnérables au sein de la société et de hausser encore le nombre de meurtres perpétrés sur des personnes vulnérables, notamment celles qui ont un handicap physique ou mental, les vieillards, les malades chroniques et les personnes déprimées. Cela favoriserait aussi les abus commis à l'égard du système judiciaire du fait que les avocats de la défense s'efforceraient d'invoquer dans la mesure du possible l'homicide par compassion de manière à obtenir pour leur client une peine moins sévère, ou d'obliger encore davantage la poursuite à établir le fardeau de la preuve. Il en résulterait une justice à deux niveaux où ceux qui tuent une personne vulnérable seraient traités avec plus d'indulgence que ceux qui tuent des personnes en santé. Cela se traduirait aussi par de coûteuses contestations judiciaires auprès de la Cour suprême du Canada en vertu des dispositions de l'article 15 de la Charte canadienne des droits et libertés.
Selon nous, le gouvernement du Canada ne doit pas créer de nouvelle catégorie de meurtre au titre de l'homicide par compassion, mais plutôt introduire la règle de peines plus sévères pour le meurtre de personnes vulnérables, notamment celles qui ont un handicap physique ou mental, les vieillards, les malades chroniques et les personnes déprimées. Il y aurait ici un précédent d'établi, selon lequel les personnes vulnérables ont des besoins particuliers et qu'il leur faut par conséquent une protection particulière. Ceux qui, parmi les membres de la famille, les amis et les fournisseurs de soins médicaux, sont dépourvus de sens moral comprendraient aussi qu'il importe de protéger et de renforcer la relation de confiance, et non d'y porter atteinte.
Nous sommes également d'avis qu'il faut soutenir et promouvoir les soins palliatifs et les soins donnés aux personnes vulnérables, au Canada, où ces soins sont parmi les meilleurs du monde. N'est-il pas préférable de renforcer encore l'environnement humanitaire qui préside aux soins palliatifs et aux soins offerts aux personnes vulnérables plutôt que de réduire les peines imposées aux meurtriers de personnes vulnérables? Si quelqu'un tue son enfant handicapé parce qu'il ne peut pas, en tant que parent, lui procurer les soins nécessaires, ne sommes-nous pas aussi associés au meurtre de cet enfant?
Nous croyons que la dignité ne réside pas dans l'autonomie personnelle devant la mort, mais plutôt dans l'amour et la sollicitude que nous éprouvons pour les autres. Il est vrai que la compassion consiste à partager la souffrance d'une autre personne, mais la façon de faire quelque chose pour cette personne, de reconnaître sa dignité, c'est de lui procurer les soins dont elle a besoin. La véritable compassion nous amène à partager la souffrance de l'autre, et non à tuer la personne dont nous ne pouvons plus supporter la souffrance. La véritable preuve de sa dignité n'est pas dans la manière de se réaliser soi-même, mais dans celle avec laquelle on répond aux besoins des autres et crée une société respectueuse de la vie de chacun, notamment des personnes handicapées, des mourants, de ceux qui souffrent, des personnes déprimées et de toutes celles qui, d'une façon ou d'une autre, sont vulnérables.
Mme Jacki Jeffs, directrice exécutive, Alliance pour la vie, Ontario: Madame la présidente, je transmets les remerciements de notre conseil d'administration et de nos 40 000 adhérents en Ontario. Je suis également le porte-parole du Manitoba, de Terre-Neuve et du Labrador et de l'Île-du-Prince-Édouard. Malheureusement, notre conseiller juridique n'a pas pu se libérer pour nous accompagner. Normalement, nous travaillons en équipe. Il parle avec sa tête et moi avec le coeur. Aujourd'hui, je dois faire les deux.
Tout d'abord, je voudrais parler directement de l'homicide par compassion.
Le professeur Dick Sobsey a dit ceci:
Le fait de ne pas accorder la protection de la loi à tous également est la pire forme de discrimination [...]. En infligeant une peine moindre, on placera des milliers de gens handicapés devant un risque accru de mort et de violence.
Nous ne sommes pas en faveur de l'idée d'apporter des modifications au Code criminel pour prévoir une peine moindre dans les cas d'euthanasie qui comportent un élément essentiel de compassion ou de pitié, et ce, pour les raisons suivantes. Premièrement, cela serait contraire à l'obligation du Parlement, qui, aux termes de l'article 15 de la Charte des droits et libertés, doit accorder la protection égale de la loi aux personnes atteintes de déficiences mentales ou physiques; deuxièmement, le Parlement, ce faisant, abdiquerait sa responsabilité de protéger la vie humaine; troisièmement, cela inciterait les dispensateurs de soins et les membres de la famille dont dépendent les personnes vulnérables à envisager l'impensable: tuer celui ou celle qu'ils aiment ou leur patient; et, quatrièmement, les paramètres de la compassion ne sauraient être définis suffisamment pour prévenir l'abus généralisé.
Le paragraphe 15(1) de la Charte se lit ainsi:
La loi ne fait acception de personne et s'applique également à tous, et tous ont droit à la même protection et au même bénéfice de la loi, indépendamment de toute discrimination, notamment des discriminations fondées sur la race, l'origine nationale ou ethnique, la couleur, la religion, le sexe, l'âge ou les déficiences mentales ou physiques.
Nous estimons que la proposition d'imposer une peine moindre pour homicide par compassion vise directement les personnes handicapées. Nous ne voyons pas d'autres catégories de gens qui puissent logiquement faire l'objet d'une compassion incitant quelqu'un à conclure qu'il vaudrait mieux qu'ils soient morts. Nous sommes pleinement d'accord avec le professeur Sobsey, qui estime que cette proposition, si elle était concrétisée, représenterait la pire espèce de discrimination. On s'inquiète beaucoup de nos jours du risque que le système de santé canadien devienne un système à deux vitesses. Cette proposition créerait un système de justice à deux vitesses, l'un pour les gens aptes physiquement et mentalement et l'autre pour les déficients.
Thomas Jefferson écrivait:
La protection de la vie humaine, et non sa destruction, est la raison d'être de tout bon gouvernement.
Plus récemment, feu le juge John Sopinka, s'exprimant au nom de la majorité des juges de la Cour suprême du Canada, dans l'arrêt Rodriguez, a dit ceci:
L'interdiction générale établit de longue date, et qui répond à l'objectif du gouvernement de protéger la personne vulnérable, est fondée sur l'intérêt de l'État à la protection de la vie et traduit la politique de l'État suivant laquelle on ne devrait pas dévaloriser la valeur de la vie humaine en permettant d'ôter la vie.
Par conséquent, à notre avis, la préposition relative à l'homicide par compassion constituerait une abdication de cette responsabilité de l'État.
La proposition exprime également une vision très naïve de la nature humaine et méconnaît le rôle important que la loi peut jouer dans la mesure où elle influence les gens à faire instinctivement leur devoir en temps de crise morale, ainsi que le besoin qu'a la société d'avoir des valeurs morales absolues. Nous sommes d'accord avec M. Sobsey lorsqu'il dit qu'une peine moindre pour l'homicide de compassion aurait probablement pour effet d'affaiblir cette saine inhibition que procure à la société la prohibition absolue du suicide assisté, et de mettre en péril des milliers de personnes vulnérables. Voulons-nous vraiment que les Canadiens se soumettent à un processus décisionnel quelconque en sept étapes qu'ils auront appris dans un cours de science morale à l'école secondaire pour déterminer s'ils sont justifiés ou non de mettre un terme à la vie de grand-maman ou du petit Jeanot? Ou notre société ne se porterait-elle pas mieux si la plupart d'entre nous refusaient tout simplement de même envisager l'impensable?
Dans son oeuvre The War against the Family, William Gairdner explique fort éloquemment que toutes les sociétés bien organisées de l'histoire ont reconnu la nécessité d'avoir des systèmes automatique d'intervention morale. Il écrit:
Les grands systèmes moraux du monde [...] fonctionnent bien précisément parce qu'ils comportent des normes absolues [...] la sagesse commune à de tels systèmes [...] tient au fait que l'unanimité est imparfaite par nature, et que les vastes ressources de l'intelligence humaine sont beaucoup trop occupées par les péripéties du voyage de la vie pour se soucier d'interrogation morale à tous les tournants; voilà pourquoi un compas moral est nécessaire. C'est parce que nous sommes souvent tellement aveuglés moralement par les exigences de la vie quotidienne, et par nos propres émotions, que nous nous en remettons avec soulagement à ces sages valeurs morales absolues [...] Après tout, aucun grand système moral de l'histoire n'a jamais eu l'individu comme fondement premier.
Le problème évident que pose une peine réduite pour homicide par compassion tient au fait qu'on invite des gens, qui sont plongés dans une crise morale où la vie et la mort sont en jeu, à tenir compte de leur opinion subjective pour ce qui est de savoir si leur être cher ou le patient vit une vie digne d'être vécue. Reconnaître que c'est là courir au désastre, c'est seulement admettre la réalité que l'être humain dispose de capacités sans limite pour se mentir et justifier son propre comportement immoral, particulièrement lorsqu'il y trouve son compte.
Dans le jugement bien connu Stephen Dawson, qui a été rendu en 1983, le juge McKenzie a exprimé cette inquiétude mieux que personne. Il écrivait:
Je ne peux pas admettre l'idée [des parents] que Stephen serait mieux mort [...] ce serait considéré que la vie d'un enfant ayant un handicap a non seulement moins de valeur que la vie d'un enfant normal, mais qu'elle ait de si peu de valeur qu'il ne vaut pas la peine de la préserver. Je tremble à l'idée des conséquences qui s'en suivraient si la vie des personnes ayant un handicap tenait à de telles considérations.
Nous tremblons nous aussi à cette idée. Nous comprenons bien que la loi telle qu'elle est n'est pas une panacée. L'affaire Dawson, l'affaire Robert Latimer et celle plus récente de Lisa Thompson, qui a été punie d'une petite tape sur les mains par les tribunaux pour avoir tenté de tuer son enfant handicapé, prouvent que la loi à elle seule ne peut inciter à faire ce qu'on doit dans les moments de stress émotif et moral. Mais nous croyons que la loi, telle qu'elle est, reste un instrument utile pour retenir la vague de relativisme moral de notre culture.
Enfin, nous estimons que les paramètres proposés pour une peine moindre en cas d'homicide par compassion ne pourraient, quels qu'ils soient, prévenir un abus généralisé. En 1994, la Chambre des lords britannique, dans le «Report of the Select Committee on Medical Ethics», a conclu ce qui suit:
Nous avons considéré la proposition que, si l'homicide délibéré devait rester un délit criminel, l'homicide en vue de soulager la souffrance (c'est-à-dire l'homicide délibéré relevant d'un motif compatissant) ne devrait pas être considéré comme un meurtre, mais qu'il faudrait créer une nouvelle infraction désignée comme «homicide par compassion». À l'heure actuelle, le délit de meurtre englobe des actes d'homicide délibérés dont le caractère varie énormément et dont la plupart des gens diraient qu'ils varient «en degré de culpabilité morale». La question importante est donc de savoir si la loi peut ou doit faire une distinction entre ces actes. Nous estimons qu'elle ne le doit pas. Faire une distinction entre le meurtre et l'«homicide par compassion» reviendrait à franchir la limite où est interdit tout homicide volontaire, et nous pensons qu'il est essentiel de maintenir cette limite. Nous ne croyons pas non plus qu'il soit possible de définir correctement l'«homicide par compassion», puisqu'il faudrait déterminer précisément en quoi consiste un motif de compassion. C'est pour ces motifs que nous ne recommandons pas la création d'une nouvelle infraction.
Nous entérinons ces remarques de la Chambre des lords britannique. Comme dans le cas des propositions visant à légaliser le suicide médical assisté, nous estimons qu'il est illusoire de penser qu'on puisse bâtir des garde-fous suffisants dans un système de ce genre. Comme l'a dit quelqu'un un jour: «Aucune société dans l'histoire des hommes n'a jamais réussi à déterminer la limite entre tuer et tuer «un peu.»
Si vous me le permettez, j'aimerais faire appel à votre bon coeur pour les cinq dernières minutes de mon exposé. À l'annexe A, il est question d'un collègue et très bon ami à moi, Mark Pickup. Dans la société d'aujourd'hui, comme ceux qui ont un handicap d'un type ou d'un autre, Mark serait défini par ce qu'il ne peut pas faire. Cependant, je voudrais vous présenter un homme marié, un homme qui a été diagnostiqué en 1984 comme souffrant de sclérose en plaques, un homme qui milite activement contre l'euthanasie. Il a la vie à coeur. S'il était ici aujourd'hui, Mark vous dirait qu'il est ici seulement parce que sa femme le valorisait alors que lui ne se valorisait pas. Il vous expliquerait que les gens ont besoin de temps pour avoir de la peine, pleurer et dire des choses excessives sans être obligés de souhaiter la mort, et qu'après une période d'ajustement la plupart d'entre eux redécouvrent la joie de vivre. Il vous dirait, comme il l'a dit au comité en 1995:
Je demande que l'on résiste à cette idée noire actuelle d'envisager l'euthanasie et l'aide au suicide comme une solution. Il n'y a aucune place dans les sociétés civilisées pour une telle chose. Arrêtons de parler de tuer et reformulons notre engagement les uns à l'égard des autres, à l'égard de la vie, à l'égard de l'indépendance.
Il vous dirait que cela fait peur à l'heure actuelle d'être handicapé en Amérique du Nord. La question qu'il nous pose est la suivante: «Est-ce que je serai le bienvenu dans la société?»
Il vous dirait qu'il n'est pas moins un homme maintenant qu'auparavant après des années de maladie dégénérative. Il a dit que son humanité demeurait intacte parce qu'il portait l'image de Dieu; aucun handicap, aucune démence, aucune difformité, aucune maladie incurable ni l'âge ne pourraient le dépouiller de cette image. L'an prochain il sera peut-être alité ou paralysé, mais il estime que personne ne pourrait le priver de la place qu'il a le droit d'occuper à titre de créature de Dieu.
En regardant cet article, vous devrez penser à tous ces enfants qui ont été tués au Canada parce que leur vie n'avait pas de valeur aux yeux de certains. En leur nom, au nom de la justice, nous ne devons pas permettre que nos lois soient modifiées pour permettre à quiconque de prendre la vie de ceux qui sont considérés comme étant moins importants que nous, qui n'avons pas de handicap. Nous ne pouvons permettre que soit changée cette loi.
Faute de temps, je vais m'arrêter, sans avoir vraiment dit tout ce que je voulais dire. Pour des enfants comme Katie Lynn Baker, morte de faim et négligée par sa mère, pour Antoine Blais, noyé par sa mère, pour Tracy Latimer, dont le père a réfléchi pendant 11 jours aux différents moyens de la tuer, avec une arme à feu, ou des valium, pour des enfants comme Lisa Thompson, dont la mère a essayé de lui donner une dose excessive de barbituriques, pour les policiers et pour les avocats qui décriront ces actes comme des actes d'amour, nous lançons un défi. Ce défi se trouve dans une dernière et courte citation de Teague Johnson, dont vous avez la description à l'annexe. Teague est décédé en 1998. Teague avait 11 ans et était gravement atteint de paralysie cérébrale lorsqu'on lui a parlé du meurtre de Tracy Latimer. C'est alors qu'il a écrit sur son tableau d'épellation les mots suivants:
Je ne peux ni marcher, ni parler, ni me nourrir moi-même. Mais je ne «souffre» pas de paralysie cérébrale. Je me sers d'un fauteuil roulant, mais je ne suis pas «confiné» à un fauteuil roulant. J'ai de la douleur, mais nul besoin qu'on me «soulage de ma misère».
Mon corps n'est pas mon ennemi. C'est lui qui me donne le plaisir d'écouter Mozart, de connaître Shakespeare, de déguster une bouillabaisse et de câliner maman.
La vie est un cadeau précieux. La vie appartient à celui à qui elle a été donnée. Pas à ses parents, ni à l'État. La vie de Tracy était la sienne, pour qu'elle en fasse ce qu'elle pouvait.
Ma vie sera merveilleuse.
Nous vous présentons ces commentaires, ces citations et nos graves préoccupations relatives à tout changement ou à l'ajout d'une troisième catégorie d'homicide. Nous avons parlé de tous les autres sujets et des recommandations unanimes et nous nous sommes efforcés de vous présenter le fruit d'une partie de nos recherches, y compris notre procuration pour soins de santé que vous trouverez à la fin de notre mémoire. Je suis désolée d'avoir à partir avant les questions et je vous remercie beaucoup de nous avoir écoutés aujourd'hui.
La présidente: Merci, madame Jeffs. Nous accueillons maintenant deux témoins de la Care-in-Dying Coalition.
M. Mark Cameron, coordonnateur, Care-in-Dying Coalition: La Care-in-Dying Coalition/Canadian Coalition Against Euthanasia est une coalition de 27 organismes du Canada représentant toute une variété de confessions religieuses, de groupes communautaires et d'organismes s'intéressant aux soins de santé.
Nous avons une autre catégorie de membres, qui nous donnent leur soutien. Il s'agit de citoyens importants qui sont spécialistes dans leur domaine, comme le Dr Ayoub, qui est l'oncologiste de l'Hôpital Notre-Dame de Montréal, professeur de médecine à l'Université de Montréal et à l'université McGill et directeur de l'enseignement au Centre hospitalier universitaire. Le Dr Ayoub nous donnera son point de vue à titre de praticien des soins palliatifs.
La coalition estime que chaque personne a sa dignité et sa valeur intrinsèques et milite pour des soins compatissants, justes et respectueux pour les mourants. Ce sont ces convictions qui nous mènent à nous opposer aux efforts visant à légaliser l'euthanasie et le suicide assisté et à réclamer fortement un accès accru aux soins palliatifs et à des traitements de fin de vie respectueux pour toute personne.
La Care-in-Dying Coalition a été créée en 1994, avant le rapport «De la vie et de la mort», et nous avons suivi de près la publication du rapport et l'accueil qu'il a reçu depuis. À notre avis, il y avait bien quelques lacunes dans le rapport de 1995, mais il contenait beaucoup d'excellentes recommandations dans le domaine des soins en fin de vie, et il s'agit d'un document marquant, fondé sur d'excellentes recherches.
Il convient maintenant de faire un suivi du rapport et de voir comment les gouvernements et d'autres ont réagi à ses recommandations unanimes. À notre avis, toutefois, le rapport devrait porter sur les recommandations unanimes relatives aux soins palliatifs plutôt que sur les changements législatifs controversés se rapportant plutôt à l'euthanasie et au suicide assisté. Comment se fait-il que dans les discussions sur la fin de la vie, c'est la charrette de l'euthanasie et du suicide assisté qui est mise devant les boeufs des soins palliatifs? Ou alors, comment se fait-il que tout le monde connaît le Dr Jack Kevorkian, alors que Mme Cicely Saunders, qui a fondé le mouvement moderne des soins palliatifs hospitaliers, est presque inconnue en dehors des milieux professionnels? Surtout quand on pense que la plupart d'entre nous, à la fin de leur vie, préféreraient être soignés par le Dr Saunders ou le Dr Ayoub, plutôt que par le Dr Kevorkian.
La Care-in-Dying Coalition est ravie que dans sa mise à jour le Sénat ait décidé de se concentrer sur les recommandations unanimes du rapport «De la vie et de la mort», dont bon nombre portaient sur les soins palliatifs, plutôt que de rouvrir le débat controversé sur l'euthanasie et le suicide assisté. Nous espérons qu'en préparant son rapport le comité maintiendra cet équilibre et consacrera davantage de son attention aux soins palliatifs qu'à une modification possible du Code criminel.
Le rapport «De la vie et de la mort» présentait des recommandations unanimes dans divers domaines importants: les soins palliatifs, le soulagement de la douleur et la sédation, le maintien et le retrait des traitements de survie et les directives préalables. La coalition appuie la grande majorité des recommandations du rapport sur ces questions, mais nous savons qu'on a fait peu de progrès dans leur mise en oeuvre, surtout pour ce qui est d'offrir des soins palliatifs et de bonnes méthodes de soulagement de la douleur et de sédation.
Le comité a demandé que les gouvernements fassent des soins palliatifs une priorité dans la restructuration des soins de santé. Il semble qu'en fait le contraire se soit produit. À cause des compressions budgétaires des dernières années, dans bien des provinces, les soins palliatifs ont été la victime de compressions disproportionnées, et seulement quatre provinces ont fait des soins palliatifs une partie essentielle de leur système de soins de santé.
Il faut augmenter la formation en soins palliatifs. Pourtant, nous constatons que la majorité des facultés de médecine au Canada n'offrent toujours pas le certificat en médecine palliative créé par le Collège royal des médecins et chirurgiens et par le Collège des omnipraticiens du Canada, encore une fois surtout faute d'argent.
Le comité a demandé qu'on adopte une démarche intégrée dans le domaine des soins de santé. Pourtant, en dehors de quelques centres urbains, il y a peu de coordination entre les centres de soins palliatifs des autres secteurs du système de soins de santé; et ce qui est plus étonnant, c'est qu'il y a eu très peu de progrès dans le domaine des soins à domicile, qui sont essentiels pour les patients qui veulent mourir chez eux, entourés de leur famille.
Le comité recommande une augmentation et une amélioration des recherches en soins palliatifs, surtout dans le domaine du soulagement de la douleur et du contrôle des symptômes. Dans ces cas-là aussi, la réaction a été décevante. Les principaux organismes subventionnaires, soit le Conseil de recherches médicales et l'Institut national du cancer du Canada ne fournissent qu'une fraction infime du financement de la recherche en soins palliatifs, et les nouveaux Instituts canadiens de recherche en santé n'ont aucun programme dans le domaine des soins en fin de vie ou des soins palliatifs.
Il ne semble y avoir eu de progrès importants que dans un seul domaine, celui de la création de normes nationales. Tout le mérite en revient aux organismes professionnels, comme l'Association canadienne des soins palliatifs, qui ont travaillé à l'élaboration de normes, avec bien peu d'appui de Santé Canada ou d'autres ministères de la Santé.
Cette inertie dans le domaine des soins palliatifs est inacceptable, et nous estimons qu'elle contribue à une fausse et dangereuse dichotomie dans ce débat, qui fait en sorte qu'aux yeux de bien des gens le suicide assisté et l'euthanasie sont la seule autre option, si on ne veut pas mourir dans la douleur et sans dignité.
Dans le domaine du soulagement de la douleur, de la sédation et de l'abstention ou de l'interruption de traitements de survie, le rapport «De la vie et de la mort» recommandait que le Code criminel du Canada soit modifié de manière à établir la légitimité du soulagement de la douleur, même s'il peut avoir pour effet secondaire de précipiter la mort, et décrivait les circonstances dans lesquelles on peut s'abstenir de donner un traitement ou l'interrompre, légitimement. Nous reconnaissons que le Code criminel peut comporter des ambiguïtés qu'il faudrait clarifier et, par conséquent, nous appuyons les intentions à l'origine d'initiatives comme le projet de loi S-2, destiné à clarifier les circonstances de l'abstention ou de l'interruption d'un traitement, l'emploi approprié de médicaments destinés à soulager la douleur, et à distinguer ces démarches de l'euthanasie et du suicide assisté. Nous avons toutefois de graves préoccupations au sujet du libellé du projet de loi S-2, qui dans certaines circonstances, à notre avis, pourrait être interprété comme permettant l'euthanasie.
Au sujet d'une autre recommandation législative du rapport du Sénat, le comité a recommandé à l'unanimité que le Code criminel soit modifié pour alléger les peines dans les cas où peuvent être invoqués l'élément essentiel de compassion ou de pitié. La coalition s'y est opposée et continue de s'opposer à cette recommandation du Sénat. Il peut y avoir de bonnes raisons de revoir les dispositions obligatoires relatives à la détermination de la peine, mais il est extrêmement important de s'assurer que les changements s'appliquent à tous les cas de meurtre au second degré, et non pas seulement aux cas où on allègue un motif de compassion, comme le disait M. Scher dans son exposé.
Le 30 janvier 1998, à la lumière du débat entourant l'affaire Latimer, notre coalition a adressé une lettre à l'honorable Anne McLellan, l'exhortant à ne pas modifier la loi à ce sujet, et sept membres de la Care-in-Dying Coalition sont des intervenants dans l'affaire Latimer, faisant l'objet d'un appel devant la Cour suprême du Canada.
Alors que la coalition a des préoccupations au sujet de certaines questions juridiques découlant du rapport «De la vie et de la mort», dont nous parlons dans le débat sur le projet de loi S-2 et dans le cadre de l'appel dans l'affaire Latimer, nous devons dire que ce qui nous préoccupe le plus, c'est que ce débat sur ces questions juridiques controversées puisse éclipser la nécessité d'agir dans le domaine des soins palliatifs.
Nous pensons que les recommandations pertinentes présentées à ce comité par le Dr Chochinov, du Département de psychiatrie de l'Université du Manitoba, étaient excellentes, et, avec de légères modifications, nous voudrions les présenter comme nôtres.
Le Sénat doit donner son appui à un financement réservé, par l'intermédiaire du Conseil de recherches médicales, des Instituts canadiens de recherche en santé et d'autres organismes, dans le but d'encourager la formation en matière de soins palliatifs, et la recherche sur les soins palliatifs et les soins en fin de vie. Tous les établissements d'enseignement de la médecine et les organismes d'accréditation devraient fournir la formation et l'évaluation dans la discipline des soins en fin de vie.
Tous les établissements de soins de santé, y compris les établissements d'hébergement et de soins de longue durée, devraient prouver leur conformité aux normes relatives aux soins en fin de vie. Santé Canada devrait être tenu de produire un rapport annuel sur l'état et l'avancement des soins en fin de vie, à l'échelle nationale.
La recommandation visant à renommer le rapport «Le Rapport du Sénat sur les soins en fin de vie au Canada» nous plaît particulièrement. Nous pensons qu'on insiste alors sur ce qu'il faut. On éviterait que les médias ne détournent le débat. Plutôt que de se concentrer sur l'euthanasie et le suicide assisté, on devrait se concentrer sur le traitement des mourants.
Nous pensons aussi que nombre des recommandations détaillées de l'Association catholique canadienne de la santé -- une de nos organisations membres qui comparaîtra ici demain -- sont excellentes et complètent certaines de nos recommandations fondamentales.
Nous pensons que le manque d'accès aux soins palliatifs au Canada est une crise grave. C'est cette crise, de même que le sensationnalisme des médias, qui nourrit la demande pour ce qui est de l'euthanasie et du suicide assisté. Nous nous opposons à l'euthanasie et au suicide assisté, qui sont incompatibles avec la dignité humaine et le respect pour la vie humaine. Nous tenons à affirmer la valeur de la vie humaine des membres les plus vulnérables de notre société, comme les malades, les handicapés et les personnes âgées, et nous voulons nous assurer qu'il y ait des défenseurs efficaces des droits de ceux qui ne peuvent parler pour eux-mêmes. Nous demandons au Sénat de s'attaquer au coeur du problème des soins en fin de vie en présentant un rapport solide, en exigeant que ses excellentes recommandations unanimes dans le domaine des soins palliatifs et du soulagement de la douleur soient mises en oeuvre par les gouvernements, de façon urgente et prioritaire.
Sur ce, je donne la parole au Dr Ayoub.
[Français]
Dr. Joseph Ayoub, oncologue, Institut du cancer de Montréal: Je concentrerai ma présentation sur les progrès et les lacunes dans l'implantation des soins palliatifs au Canada.
Au cours des dernières années, et suite à la recommandation du comité spécial du Sénat sur l'euthanasie et l'aide au suicide et des gouvernements d'accorder une grande priorité aux programmes de soins palliatifs dans la restructuration du système de santé, nous assistons à l'essor des unités de soins palliatifs intra et extrahospitalières à travers tout le Canada.
Certains centres hospitaliers ont par contre adopté un modèle sans aucune unité géographique et axé plutôt sur des services de consultation auprès d'une équipe interdisciplinaire élargie. Cependant, l'objectif demeure d'entourer les personnes en fin de vie d'une chaleur humaine et surnaturelle, en plus de leur octroyer des soins médicaux compétents pour soulager la souffrance physique et autres symptômes importants reliés à leur maladie de base. Le défi actuel réside dans l'établissement d'un continuum optimal de soins et de services destinés à une meilleure approche globale des personnes en fin de vie.
Le comité spécial du Sénat avait en effet recommandé l'adoption d'une approche intégrée des soins palliatifs. Ceci reste encore à être mis en pratique. Ainsi, il existe une coordination sous-optimale des interventions entre les centres hospitaliers et les centre locaux de services communautaires. Quant aux services ambulatoires en soins palliatifs, ils sont uniquement en voie d'être développés. De plus, les ressources allouées pour le maintien à domicile des personnes désirant mourir chez elles sont souvent insuffisantes. On note donc une faiblesse des services de répit aux aidants naturels.
De toute façon, l'accès aux différents services est inégal d'un endroit à l'autre, créant ainsi des disparités régionales. Ces lacunes produisent souvent un encombrement du service des urgences et, conséquemment, l'hospitalisation en lit de courte durée ou en soins prolongés d'un bon nombre de personnes en fin de vie. C'est dans ce contexte que plusieurs correctifs sont présentement proposés, notamment dans la création de centres de jour en soins palliatifs et le maintien à domicile optimal pour les patients en perte d'autonomie.
Quant aux activités de recherche et de formation médicale prônées par le comité spécial du Sénat, elles sont prises en charge par les unités suprarégionales et universitaires. Le programme québécois de lutte contre le cancer, par exemple, précise les critères suprarégionaux suivants: la participation à des activités de recherche, la responsabilité de l'enseignement permettant d'être à la fine pointe des découvertes thérapeutiques cliniques et l'obligation de rendre son expertise facilement accessible aux intervenants régionaux ou locaux appelés à donner des soins de fin de vie.
Les universités canadiennes ont pris acte de la nécessité d'améliorer la formation des professionnels de la santé dans tous les aspects des soins palliatifs. C'est ainsi, par exemple, que l'Université de Montréal, dès juillet 1999, oblige les résidants en médecine familiale à suivre un stage de quatre semaines dans une unité de soins palliatifs. De plus, le Collège des médecins de famille du Canada ainsi que le Collège Royal des médecins et chirurgiens du Canada délivrent dès juillet 1999 des certificats de compétence en médecine palliative aux résidants qui suivent un an de formation dans un centre accrédité.
Finalement, les cours de formation et les congrès en soins palliatifs abondent un peu partout au Canada, permettant ainsi au plus grand nombre de professionnels de la santé d'acquérir les connaissances nécessaires pour prendre soin de ces patients.
Je voudrais conclure en mentionnant que l'expérience des soins palliatifs nous a fait prendre conscience d'un fait: seul l'amour permet d'honorer la dignité de la vie humaine. La personne qui va mourir n'a pas uniquement besoin de notre compétence médicale, elle désire aussi une présence, de l'affection, une main tendue. Si nous sommes capables de lui transmettre l'espérance qui nous anime, une sérénité s'installe en elle et elle n'a plus peur de la mort. Pour cela, il faut que les professionnels de la santé et les membres de la famille soient prêts à faire l'effort et à mettre le temps nécessaire pour l'accompagnement de la personne en fin de vie. Si on y arrive, la question de l'euthanasie devient futile.
Tel que l'a mentionné Mme Thérèse Vanier, c'est au moment où les médecins traitants reconnaissent qu'il n'y a rien de plus à faire activement que tout reste encore à faire.
[Traduction]
La présidente: Merci. Monsieur Cameron, avant de passer au témoin suivant, j'aimerais préciser que c'est moi qui ai déposé le projet de loi S-2.
M. Cameron: Oui, je le sais.
La présidente: Je voudrais aussi ajouter ceci pour le bénéfice de tous nos auditeurs: je ne demande pas que le projet de loi S-2 soit l'alpha et l'oméga, mais je voudrais qu'il soit aussi bon que possible, et c'est pourquoi j'accueillerai avec plaisir tout amendement qu'on pourra proposer.
M. Cameron: Nous avons préparé quelque chose sur le projet de loi S-2, et nous le ferons distribuer à tous les membres du comité.
La présidente: Merci beaucoup.
Nous accueillons maintenant M. John Mahony, qui se joint à nous malgré le bref préavis.
M. James Mahony, Alberta Life Foundation: Mesdames et messieurs, d'entrée de jeu j'avoue que je suis très impressionné par la teneur des exposés d'aujourd'hui. J'essaierai de faire aussi bien que mes collègues de la table ronde.
Je vais m'attarder sur la question posée par Peter Ryan: est-ce qu'un jugement d'homicide par compassion peut résulter d'une omission? C'est ce que j'ai tendance à croire. À mon avis, le rapport n'a peut-être pas exploré la question à fond. En fait, je dirais même que cette question deviendra le champs de bataille, car elle laisse la porte grande ouverte aux abus. On m'a expliqué à maintes reprises que dans ce domaine ce n'était ni tout blanc ni tout noir, mais surtout très gris. Je comprends.
Je me reporterai aujourd'hui à une des recommandations du rapport, soit la recommandation unanime du comité disant que les provinces canadiennes qui n'ont pas encore adopté de loi sur les directives préalables le fassent. Dans le cadre de la question de l'homicide par compassion, le lien entre l'euthanasie passive et les directives préalables est énorme. Je vais creuser le sujet un peu plus.
Le corps médical, le milieu des soins de santé et ceux qui oeuvrent dans les hôpitaux et dans les centres de soins à qui j'ai parlé approuvent de façon générale le recours aux directives préalables -- que l'on appelle directives personnelles en Alberta -- et ce, à hauteur de presque 100 p. 100. Je suis ici comme porte-parole de l'Alberta Life Foundation et aussi en mon nom personnel, ce qui ne représente pas nécessairement une grande partie de la population, mais je n'hésite pas à dire que mon point de vue est considéré comme une hérésie dans le milieu médical. J'ai parlé à beaucoup de médecins de l'Ouest du Canada, et surtout en Alberta, et j'ai constaté que très peu d'entre eux sont d'accord avec moi. Je suis d'avis que les directives préalables médicales, appelées aussi ailleurs les directives personnelles, sont une erreur, car elles peuvent mener en bout de piste dans bien des cas à la pratique de l'euthanasie passive.
Par l'euthanasie passive, j'entends ce dont parlait M. Ryan, soit essentiellement la déshydratation des patients, ce qui entraîne leur mort. Parler de la nutrition et de l'hydratation comme d'un traitement médical pose problème, pour les raisons que M. Ryan a établies. Pour parler franc, il s'agit après tout de nourriture et d'eau. Dès lors que l'on considère les choses nécessaires à la vie comme étant un traitement médical, il devient par conséquent relativement simple de retirer cette nécessité en prétendant qu'il s'agit d'un traitement médical. C'est particulièrement le cas là où le patient a déjà signé des directives préalables.
Je ne sais pas si la loi que l'Alberta a adoptée représentait une réponse directe à la recommandation du comité. La loi «Personal Directives Act» est à bien des égards semblable, quoique non identique, aux lois adoptées ailleurs au Canada. Je ne me propose pas de les passer toutes au peigne fin. Au moins la moitié, voire plus, des provinces canadiennes ont adopté des lois sur les directives préalables. En Ontario, je crois que cette loi s'appelle la Loi sur la prise de décisions au nom d'autrui. Quoi qu'il en soit, j'ai étudié pendant quelques années la question, et plus particulièrement les directives préalables et les lois qui les permettent. Or, plus j'étudie la question, et plus je suis préoccupé. Cela ne semble peut-être pas pertinent pour votre comité, mais la question me préoccupe particulièrement du fait que le comité semble croire que les directives préalables et le recours à ces directives pourraient éventuellement contribuer à résoudre le problème partiellement ou complètement.
De mon point de vue, la raison d'être des directives préalables, c'est le retrait des soins, particulièrement dans les cas où il en résulterait la mort du patient. L'une des expressions que l'on a utilisées pour décrire certaines des lois sur les directives préalables au Canada et aux États-Unis -- mais on ne l'a pas encore mentionnée aujourd'hui devant vous -- c'est la loi sur la mort par choix. Vous avez certainement, la plupart d'entre vous, entendu cette expression lorsque l'on parle des lois qui servent à légaliser ou à décriminaliser l'euthanasie ou l'aide au suicide. Je suis d'accord, mais je crois que cette expression pourrait également s'appliquer à la loi sur les directives personnelles de l'Alberta.
J'ai dit que la raison d'être de la loi, c'était le retrait des soins, particulièrement dans les cas où la mort en résulterait. Je crois également que la responsabilité professionnelle, c'est-à-dire la protection contre des poursuites, préoccupe particulièrement les associations de soins de santé. Certaines des associations médicales ont dit officiellement appuyer cette loi. Ce n'est pas faire preuve de trop de cynisme que d'en parler. Très peu de médecins se prononceront officiellement ou appuieront la loi pour cette raison, mais je crois que c'est un des éléments clés qui expliquent leur appui.
Laissez-moi digresser encore un peu: en Alberta, l'article 28 de la loi sur les directives personnelles protège le personnel soignant. Je crois que l'on parle dans la loi de fournisseurs de services médicaux, ce qui inclut bien sûr non seulement les médecins, mais aussi les autres professionnels de la santé, comme les infirmières. À mon avis, et de l'avis de certains à qui j'ai parlé, les préoccupations quant à la responsabilité professionnelle sont un des aspects importants de ces mesures législatives qui trouvent leur appui dans la population canadienne ou américaine. D'ailleurs, la première personne qui m'en ait parlé, c'était un médecin qui pratique aujourd'hui en Alberta. Il m'a expliqué qu'aux États-Unis ce qui motivait l'appui à la loi, c'était la protection qu'on offrait aux médecins contre les poursuites. Lorsque je lui ai demandé si la situation était différente au Canada, il m'a répondu qu'ici nous faisions preuve d'un peu plus d'altruisme.
En ce qui concerne les médecins canadiens, je ne remets pas en question les motifs de ceux qui appuient ces initiatives. Je sais que beaucoup de médecins et d'infirmières sont d'accord avec ce type de loi, parce qu'ils croient que cela équivaut à protéger le bien-être du patient, mais je répète que ce n'est pas faire preuve d'un trop grand cynisme que d'affirmer que beaucoup d'entre eux sont aussi motivés par des préoccupations concernant leurs responsabilités professionnelles.
En outre, il y a une autre chose qui les motive, et j'en ai parlé plus tôt en mentionnant la loi sur la mort par choix. Dans certains cas, je crois même que l'on peut parler de souhait de la mort de la part des patients. Un rapport a d'ailleurs été publié là-dessus en 1993 par la société pour la protection des enfants à naître de la Grande-Bretagne. Dans ce rapport, on décrivait longuement les directives préalables. On parlait même notamment de «refus préalable». Autrement dit, on parle souvent en Grande-Bretagne d'une directive préalable comme étant un refus préalable d'être traité, ce qui, à mon avis, vient contredire l'affirmation selon laquelle les directives ne sont rien de plus qu'un choix de plus que l'on offre aux patients en matière de soins de santé. À mon avis, la directive préalable constitue très souvent une façon d'éliminer les soins de santé.
Quelqu'un a mentionné brièvement la création d'un régime médical à deux vitesses. Au rythme auquel on adopte les lois au Canada et auquel le milieu médical adhère aux directives préalables, je pense que le développement d'un régime médical à deux vitesses ou d'un nouveau régime de soins de santé sera accéléré par le recours aux directives préalables, pour la simple raison que ces directives sont ni plus ni moins la meilleure façon et la façon la plus efficace de gérer les coûts en matière de soins de santé. Autrement dit, les directives ne sont ni plus ni moins qu'un document décrivant ce que le patient refuse, c'est-à-dire quelles formes de soins de santé il refuse de recevoir à un moment donné de sa vie.
En Alberta, il y a une chose dont on parle peut-être plus souvent que dans les autres provinces: dans les hôpitaux, les coûts semblent en voie de devenir le facteur principal dont on tient compte aujourd'hui avant de déterminer la politique à suivre et avant de prendre les décisions. Je vous renvoie à la loi américaine appelée «Patient Self-Determination Act» en vertu de laquelle si un hôpital admet un patient sans lui offrir à son arrivée la possibilité de signer une directive préalable, il peut éventuellement perdre ses fonds fédéraux. Étant donné la taille de certains des hôpitaux américains et l'ampleur des budgets dont on parle, c'est toute une épée de Damoclès que l'on maintient au-dessus de la tête des administrateurs des hôpitaux! À mon point de vue, c'est encore une fois lié aux coûts.
Je ne veux pas laisser entendre que tous ceux qui sont d'accord avec les directives préalables sont motivés uniquement par les coûts ou par leur budget. Tout ce que je dis, c'est qu'il ne faut pas nier la possibilité bien réelle que ces dispositions, qui, dans bien des cas, avaient été suggérées par des gens qui s'inquiétaient sincèrement du bien-être du patient, puissent en bout de piste se transformer en outils de contrôle des coûts. Cela pourrait devenir un outil de gestion budgétaire de plus dans l'arsenal des administrateurs d'hôpitaux.
Pour revenir sur ce que l'on a dit plus tôt au sujet d'un régime de santé à deux vitesse, je me suis posé la question de façon très sincère. Je ne suis pas ici à titre d'administrateur d'hôpital ou de médecin. D'ailleurs, le débat ne devrait pas être monopolisé par les professionnels de la santé. Toutefois, certains des colloques et conférences auxquels j'ai assisté en Alberta étaient fortement dominés par les professionnels de la santé, au point que certains d'entre nous de l'extérieur se demandaient si leur opinion avait quelque importance.
Il est sain d'écouter ceux qui sont à l'extérieur du système de soins de santé. Si, comme avocat, je devais affirmer que seuls les avocats doivent régir leurs confrères, je serais tourné en ridicule. Nous avons un ordre des avocats en Alberta, mais nous sommes tout de même surveillés de très près par la population et par les gouvernements. Toute suggestion disant que seuls des avocats devraient surveiller les actes de leurs confrères serait immédiatement tournée en dérision.
Dans le cas qui nous occupe, il est sain d'aller voir ce qu'en pensent ceux qui sont à l'extérieur du régime de santé, particulièrement dans les cas où, comme pour la loi albertaine sur les directives personnelles, la protection contre les poursuites n'est accordée expressément qu'aux professionnels de la santé. Cela ne veut pas dire que les autres dispositions de la loi ne protègent pas d'autres individus aussi; il existe d'autres dispositions de ce genre, et j'y viendrai, mais ce que je pense, c'est que ces dispositions ont été adoptées pour protéger les professionnels de la santé, qui seront ceux qui débrancheront les respirateurs la plupart du temps, même si c'est sur les instructions de leurs patients.
Cette loi-ci, tout comme les autres lois sur les directives personnelles ou préalables que j'ai examinées, ouvre grand la porte aux conflits d'intérêts. Prenons un exemple: un bénéficiaire d'assurance-vie, qui est également le mandataire nommé par le signataire d'une directive, est d'après la loi libre de toute poursuite au civil s'il débranche le respirateur. Il en va de même pour les légataires, c'est-à-dire ceux qui héritent en vertu d'un testament. Imaginez une loi qui dirait à une personne: «Vous avez le pouvoir et l'autorisation de débrancher un autre être humain de tout équipement de maintien en vie, avec comme résultat immédiat sa mort, mais il se trouve aussi que le testament vous nommera légataire, ou encore que vous allez hériter de son assurance-vie»; elle porterait en elle les germes d'un conflit d'intérêts. C'est ce que fait cette loi-ci. Les journaux n'en ont en tout cas pas parlé en Alberta. Je viens de vous parler de deux conflits que la loi entraîne, mais à mon avis il y en a beaucoup d'autres.
Pour continuer au sujet des directives préalables, il faut comprendre que l'un des aspects des soins de santé d'aujourd'hui, c'est le consentement en connaissance de cause. On en parle assez souvent, particulièrement lorsqu'il est question de décisions prises actuellement en matière de soins de santé. Autrement dit, si je dois subir une chirurgie, on m'informe des risques possibles, mais aussi des avantages que je pourrais en retirer, après quoi je prends ma décision. Dans le cas des directives personnelles ou préalables, on demande au patient de signer un formulaire qui donne des années, voire des décennies, à l'avance à l'agent qui s'occupera de lui assurer des soins de santé, ainsi qu'au personnel médical qui agira sur les instructions de cet agent, les instructions et le consentement voulus en prévision de traitements médicaux.
Dans toute autre situation, nous nous demanderions si le consentement accordé se base sur de l'information d'actualité. Autrement dit, si on me propose aujourd'hui de subir une chirurgie, l'information qu'on me donne est-elle d'actualité?
Or, une directive préalable constitue ni plus ni moins qu'un consentement général. C'est un chèque en blanc destiné au traitement médical, qui, dans certains cas, ne s'appliquera que dans de nombreuses années. Si la personne qui donne son consentement souffre d'une maladie pour laquelle elle devrait recevoir des traitements imminents, il est probable que les renseignements qu'elle reçoit seront d'actualité; mais dans bien des circonstances il faudra des années avant que l'on ne vienne à traiter la personne qui a signé le formulaire. Toutefois, elle aura déjà donné son consentement.
Ce que j'essaie de vous faire comprendre, c'est que la directive préalable ne constitue pas véritablement un consentement réel ou contemporain à l'intervention. C'est ni plus ni moins qu'un formulaire de consentement anticipé et, je le répète, un consentement général accordé de nombreuses années à l'avance, souvent longtemps avant que le patient n'ait contracté une maladie ou subi un accident.
Ce n'est là qu'une des nombreuses réserves que j'ai au sujet de ces documents. Si je devais en cibler une seule comme étant la plus importante, je dirais que les lois sur les directives préalables reviennent à permettre de choisir la mort et de la faciliter.
Peter Ryan s'est demandé si une omission pouvait être considérée comme un homicide par compassion. J'irais jusqu'à dire que dans bien des circonstances c'est ce à quoi serviront ces documents. Dans le rapport britannique que j'ai mentionné, qui a été publié en 1993, on parlait de «idéation suicidaire», et on se demandait ce qui pouvait empêcher un suicidaire de fabriquer simplement un de ces documents, puis de laisser la nature suivre son cours. Dans bien des cas, on pourrait parler d'intention suicidaire.
Ce qui me préoccupe, c'est qu'on semble respecter de moins en moins la vie humaine, ici au Canada. Je sais que, pour certains, l'autonomie et le choix personnels supplantent tous les autres facteurs et que l'autonomie personnelle est soit la seule chose dont il faut tenir compte, soit la plus importante. Toutefois, il y a d'autres facteurs qui entrent en jeu, outre l'autonomie et le choix personnels. Dans les cas où des gens prennent des décisions qui peuvent entraîner leur propre mort, il faudrait pouvoir mettre les choses en perspective et pondérer leur volonté et le respect de la vie.
Si, après avoir lu le rapport, j'étais persuadé que l'autonomie et le choix personnels n'étaient pas les facteurs dominants dans le cas qui nous occupe ici, je ne suis pas sûr que je mentionnerais ce qui suit; toutefois, la façon dont j'interprète le rapport me laisse croire que l'on respecte la vie humaine, mais qu'il y a également d'autres facteurs que l'on fait intervenir dans l'équation. Dans ce débat, l'autonomie et le choix personnels ne sont pas les facteurs les plus importants et ne devraient pas orienter le débat.
La présidente: Merci. Avant de passer aux questions, le sénateur Corbin a demandé à invoquer le Règlement.
Le sénateur Corbin: En effet. On présente la recommandation du rapport du 6 juin 1995 dont il est question aujourd'hui comme étant unanime. Toutefois, le mercredi 28 juin 1995 j'ai pris la parole au Sénat et j'ai dit ce qui suit:
[Français]
[...] je veux aujourd'hui me dissocier de l'opinion ou de la recommandation unanime à l'effet que le ministre de la Justice, et c'était une de nos recommandations, je le dis bien, devrait considérer d'établir un troisième degré de meurtre, le meurtre par compassion, de façon à réduire la peine.
Je trouve que s'il y a «compassion» dans la commission d'un meurtre, un jury et un juge sauront faire la part des choses. Mais de là à dire que nous devrions établir une troisième catégorie de meurtre, je pense que c'est peut-être inviter certains individus à se servir de ce qui est, au fond, une défense subséquente, comme d'un motif pour commettre un meurtre. Je pense que cela entraîne une dégradation du respect qui est dû à la vie.
Je m'excuse auprès de mes collègues, auprès de la présidente et de la vice-présidente et des autres membres du comité, j'aurais dû affirmer cela au cours de l'étude du texte. J'étais absent la dernière semaine. J'avais l'intention de revenir sur la question. J'étais absent, donc j'ai manqué l'occasion. Je veux, d'abord et avant tout, vivre en paix avec ma propre conscience. C'est pour cette raison qu'aujourd'hui, je fais cette affirmation.
Les recommandations de la majorité dans le rapport sont aussi mes recommandations sur tous les points, sauf sur celui dont je viens de parler.
[Traduction]
Je dois en accepter les conséquences, mais j'ai bel et bien déclaré cela au Sénat. Je comprends que l'on parle constamment d'une recommandation unanime de la part du comité, puisqu'il y avait unanimité au moment du dépôt du rapport. Toutefois, comme j'avais été absent, je n'avais pu prendre part au débat ni à l'élaboration de cette recommandation. Si j'avais été présent au comité, je ne l'aurais pas appuyée. Voilà ce que j'avais à dire.
La présidente: Merci, sénateur Corbin. J'étais été moi-même au Sénat lorsque vous avez apporté cette précision avec beaucoup de passion.
Le sénateur Beaudoin: De façon générale, êtes-vous d'accord avec les termes que nous avons choisis? J'ai écouté avec soin toutes vos propositions. Il saute aux yeux que vous n'acceptez pas la suggestion de créer la catégorie de meurtre au troisième degré. J'en ai pris bonne note, car cela me semble très important.
[Français]
Docteur Ayoub, êtes-vous d'accord avec notre lexique, et sinon, pourquoi? J'ai toujours dit que si nous définissons les termes au début d'une discussion, nous gagnons des heures, des jours et des mois de discussions. Nous nous apercevons souvent, après toutes ces discussions, que nous n'avions pas les mêmes définitions.
Vous avez livré un plaidoyer enlevant sur les soins palliatifs. Les membres du comité sont certainement tous sur la même longueur d'onde sur cette question. S'il y a un point où nous sommes tous d'accord, c'est bien celui-là. Vous prônez le développement des soins palliatifs, mais avez-vous des suggestions à nous faire à ce sujet? Ces soins sont dans une très grande mesure de compétence provinciale. Nous allons en traiter dans notre rapport du mois de juin, mais ce serait peut-être une bonne chose de connaître vos vues là-dessus afin de pouvoir rejoindre les autorités provinciales.
M. Ayoub: Le point important jusqu'à présent est l'absence de continuum dans l'administrations des soins palliatifs. De bonnes unités sont en place, mais il n'y a pas de liens entre ces unités, les centres locaux communautaires et les soins à domicile. Le manque de ressources financières est la raison de cette absence, d'où l'incapacité d'accorder du répit aux familles des malades. S'il y avait de meilleures ressources, on pourrait établir cette continuité entre les différentes sections de la prise en charge globale du patient en fin de vie.
Le sénateur Beaudoin: Dans le domaine des soins palliatifs, je ne pense pas que nous parlions de législation, nous dirons tout simplement qu'il faut les développer. Les provinces doivent prendre leurs responsabilités. Peut-être suggérerons-nous une législation, mais cela ne relève pas de nous.
Vous dites qu'il faut assurer une certaine continuité, c'est vrai. Il faut aussi assurer la collaboration entre le fédéral et les provinces. Sur la question des ressources, vous êtes bien placé pour en parler puisque vous êtes à l'hôpital tous les jours, existe-t-il un problème particulier à ce sujet?
[Traduction]
La présidente: Monsieur Mahony, en ce qui concerne les directives préalables, je dois vous dire que la situation est tout autre dans la province du Manitoba. Ce ne sont pas les médecins qui ont demandé le dépôt d'une mesure législative sur les directives préalables, mais plutôt la «Manitoba Society for Seniors» et les avocats. À vrai dire, les médecins n'ont aucunement pris part au débat. Ils se sont intéressés à la question après coup, et d'une façon générale ils appuyaient la loi sur les directives préalables, car, à leur avis, elle établissait plus clairement ce qu'ils pouvaient faire et ne pas faire. J'aimerais savoir ce que vous pensez de cela.
M. Mahony: On m'a souvent dit cela au sujet de la clarté. Certains affirment que, surtout à l'hôpital, lorsque la famille est présente, il y a souvent des conflits entre les différents membres de la famille. Il y a peut-être des factions en conflit au sein de la famille, un camp voulant que le patient soit débranché alors que l'autre souhaite qu'on le maintienne en vie. Certains estiment qu'une loi sur les directives préalables permettrait de clarifier ce genre de situation et de laisser une seule personne prendre la décision.
Pour ma part, j'estime que légiférer n'est pas toujours la solution, surtout lorsqu'il s'agit de relations familiales, lorsqu'il y a non seulement des conflits ouverts, mais aussi des conflits latents, dont certains couvent depuis des années. Si quelqu'un entre dans la chambre d'hôpital en disant: «J'ai les directives préalables de papa. C'est moi qui décide», il y aura autant de conflits qu'en l'absence de telles directives, sinon davantage, car alors les parties engageront des avocats.
Étant moi-même avocat et ayant pratiqué le droit, je sais ce que peuvent faire les familles et je sais que les possibilités de conflits sont presque infinies. Je suis d'accord pour dire que la situation qui prévalait auparavant n'était pas idéale. Lorsque deux ou trois personnes de chaque côté du lit d'hôpital donnent des instructions contradictoires au médecin, c'est une sale affaire. Mais comme un profane me l'a déjà fait remarquer, mourir est une sale affaire. Je ne crois pas que des directives préalables ou des directives personnelles, quel que soit le terme employé dans la loi provinciale, amélioreront ou corrigeront ce genre de situation, mais elles pourraient préciser la responsabilité. Nous revoilà au coeur du problème. Les directives préalables peuvent nous aider à mieux définir la responsabilité. Pour ce qui est de résoudre les conflits et d'améliorer la situation qui existe dans certaines chambres d'hôpital où un patient est mourant, je ne crois pas que ce soit la solution.
La présidente: Vous semblez laisser entendre que les directives préalables sont gravées dans le marbre. J'ai changé mon testament au moins six fois dans ma vie; aux diverses étapes de la vie de mes enfants, j'ai modifié mon testament en conséquence. J'ai aussi changé mes directives préalables trois fois depuis que j'ai signé le premier document, au Manitoba. Il est important de préciser que les directives préalables ne constituent pas un document statique; en fait, comme un testament, c'est un document qui évolue.
M. Mahony: Sénateur, vous êtes très consciencieuse, et je le dis sans vouloir être facétieux ou sarcastique. La plupart des gens ne sont pas aussi consciencieux que vous. Étant moi-même avocat, il y a environ deux ans, un ancien client de mon père a communiqué avec moi. Il avait fait son testament en 1958. Pendant 30 ans, son testament est resté inchangé. Comme pour tout le reste, quelques- uns seront consciencieux et actualiseront leurs directives et leurs testaments, mais bien des gens ne le feront pas. La différence, c'est que si j'oublie de mettre à jour mon testament, cela n'influera généralement que sur la disposition de biens et d'argent. En revanche, lorsqu'une personne néglige d'actualiser ses directives préalables, cela peut très bien déterminer comment se déroulera la fin de sa vie.
Les enjeux sont beaucoup plus élevés dans le cas des directives préalables. C'est une question de vie et de mort. Le testament ordinaire et la procuration ne traitent que de biens, alors que les directives préalables traitent de la vie humaine, un enjeu beaucoup trop important pour qu'on le limite à un seul document.
Les directives préalables tentent de résumer en quelques lignes les souhaits d'une personne sur sa vie et sa mort, souhaits qui évoluent constamment. Nous avons tous connu des moments dans notre vie pendant lesquels nous avons été déprimés et désespérés, mais nous avons aussi des moments où nous sommes prêts à vivre malgré tout. Dans bien des cas, ceux qui signent des directives préalables n'auront pas la possibilité de choisir la vie.
L'article 11 de la loi sur les directives personnelles de l'Alberta, cette loi n'étant qu'une parmi tant d'autres, prévoit que seule une personne qui comprend la nature et les effets de la révocation d'une directive peut la révoquer. Essentiellement, l'aptitude est une condition préalable à la révocation. Autrement dit, si vous n'avez pas la capacité mentale de révoquer vos directives, vous ne pourrez le faire. Cela équivaut à dire qu'à partir d'un certain moment les directives deviennent permanentes.
Pour en revenir à l'enjeu, dans le cas des directives préalables il s'agit de vie et de mort, et non pas de biens. Si mon père, ma mère ou l'oncle Sam oublie de m'inclure dans son testament, personne n'en mourra. Je serai triste de ne pas avoir la maison, mais ce n'est pas une question de vie ou de mort. Les directives préalables signifient souvent la vie ou la mort; bon nombre de ces directives se transformeront en peine de mort pour ceux qui auraient voulu les révoquer, mais qui n'ont pas été aussi consciencieux que vous.
La présidente: J'ai quelques questions à poser sur l'alimentation et l'hydratation artificielles, surtout concernant l'alimentation et l'hydratation forcées. Nous savons tous que l'alimentation et l'hydratation artificielles d'un patient se font par voie intraveineuse ou par un shunt. On ne peut forcer une personne à s'alimenter par la bouche. Cela constitue des voies de fait aux termes du Code criminel du Canada. Pourquoi l'alimentation forcée d'un patient par un tube ne constitue-t-elle pas des voies de fait?
M. Schadenberg: Dans mon mémoire, je parle de l'alimentation et de l'hydratation artificielles relativement aux souhaits et aux besoins. C'est une préoccupation surtout pour les personnes incapables. Toutefois, c'est différent si l'alimentation et l'hydratation sont un traitement médical. Ce traitement est administré aux personnes dépressives et à celles qui, en raison d'une maladie permanente ou non, se demandent si elles veulent continuer à vivre.
Lorsque l'alimentation et l'hydratation artificielles sont un traitement médical, on peut renoncer à ce traitement ou l'interrompre. Le patient qui est capable de décider qu'il ne veut plus d'aliments ou de liquides pourra le lendemain se raviser si les circonstances changent. Il a la capacité de décider.
La situation est bien différente pour les personnes incapables. Les personnes dans un état végétatif persistant, qui ont de graves handicaps et pour qui l'alimentation et l'hydratation artificielles sont considérées comme un traitement médical, surtout celles qui ont donné, avant de devenir incapables, des directives préalables dans lesquelles elles renonçaient au traitement médical dans une telle situation, pourraient voir leur alimentation et hydratation artificielles interrompues et mourir de faim et de déshydratation.
L'oxygène, c'est autre chose. Si on vous prive d'oxygène et que vous mourez, vous mourez de la maladie dont vous souffrez. L'oxygène est toujours disponible, sans intervention particulière. Nous avons toujours besoin d'aliments et de liquides aussi, mais ils doivent être pris ou administrés d'une façon ou d'une autre, à la cuiller, par un tube ou autrement.
Par conséquent, ce serait mettre en danger la vie des incapables que de définir l'alimentation et l'hydratation artificielles comme un traitement médical plutôt que comme des soins normaux. Comme je l'ai dit dans mon exposé, les soins sont dispensés en fonction des besoins. Par conséquent, nous n'alimenterons pas de force quelqu'un qui meurt. La question n'est pas de savoir s'il faut permettre à celui dont le corps cesse de fonctionner de mourir naturellement. La question est plutôt de savoir si on permet aux membres des familles des incapables qui ne sont pas mourants de les laisser mourir plus rapidement à l'aide de cette méthode.
M. Cameron: La comparaison avec l'alimentation forcée n'est pas la meilleure, car l'alimentation forcée implique l'absence de consentement, la décision d'agir délibérément contre le gré du patient. Généralement, lorsqu'il y a alimentation et hydratation artificielles, le patient n'est pas conscient. Ce sont des patients dont le corps cesse graduellement de fonctionner, dont le métabolisme a cessé. Dans ces cas, l'alimentation et l'hydratation peuvent devenir pénibles.
Le critère est le même pour l'alimentation et l'hydratation artificielles que pour les autres traitements: les bienfaits sont-ils supérieurs au fardeau que représente le traitement?
L'alimentation et l'hydratation artificielles peuvent devenir pénibles dans certaines circonstances, mais elles sont généralement un besoin ordinaire. Ce n'est pas un traitement extraordinaire, à moins que vous n'en soyez à la phase terminale, que votre corps ne rejette les aliments et les liquides. En général, je ne crois pas que cela puisse constituer un traitement extraordinaire, car tous ont un besoin inhérent d'aliments et de liquides. Cela ne sera pas considéré comme un traitement forcé, à moins que vous n'agissiez contre le gré du patient. À mon avis, la plupart des patients souhaiteraient être alimentés s'ils étaient inconscients. On présume que l'alimentation et l'hydratation se poursuivront à moins d'un ordre contraire clairement exprimé.
La présidente: Je crois que je vous comprends, mais il m'apparaît nécessaire de préciser qu'il s'agit d'un traitement médical. Faire une perfusion intraveineuse ou insérer un shunt dans l'épaule d'un patient, c'est un traitement médical. C'est une intrusion dans le corps du patient.
M. Cameron: L'insertion d'un shunt est peut-être un traitement médical, mais l'alimentation et l'hydratation...
La présidente: Mais elles ne peuvent se faire sans shunt.
M. Cameron: Le moyen employé est un moyen médical, mais il sert une fin nécessaire à la vie. Le fait d'employer une technique médicale pour arriver à cette fin ne signifie pas que la fin est médicale. La fin est la satisfaction d'un besoin, et on présume que c'est ce que voudrait tout être humain. C'est seulement la méthode qui est médicale, et non pas les raisons pour lesquelles le traitement est administré.
La présidente: D'après mon expérience auprès de mes parents mourants, je sais que pendant leur agonie ils ne voulaient ni manger, ni boire. Il ne m'est jamais venu à l'esprit de les alimenter ou de les hydrater artificiellement, puisqu'il était clair qu'ils pouvaient le faire naturellement et qu'ils avaient choisi de ne pas le faire.
M. Cameron: C'est une question de consentement. Cette situation est différente. Je ne parle pas de patients qui renoncent à un traitement. Je parle plutôt de l'interruption d'un traitement sans le consentement du malade.
La présidente: Puisqu'il n'y a pas d'autres questions, je remercie tous les témoins que nous avons accueillis cet après-midi. Nous vous savons gré de vos témoignages.
La séance est levée.